« Amérique en guerre »
par Pierre Haski, Pascal Blanchard et Farid Abdelouahab
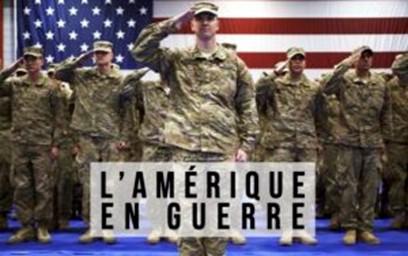
Aux côtés du journaliste Pierre Haski, les historiens Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard cosignent le documentaire L’Amérique en guerre, diffusé en direct sur ARTE le 11 mars 2025, et analysent l’identité guerrière des États-Unis, première puissance mondiale dont le rôle de « gendarme du monde » est aujourd’hui en débat. L’Amérique en guerre retrace cette histoire militaire ininterrompue depuis 250 ans, à l’heure où Donald Trump retrouve la Maison-Blanche avec une vision expansionniste. Les auteurs mettent en lumière un fait souvent oublié : aucun pays n’a été en guerre autant que les États-Unis. La guerre est au cœur de son identité nationale, une matrice essentielle qui a façonné son histoire interne – de la Révolution américaine à la Guerre de Sécession et aux guerres indiennes – et leur politique extérieure, marquée par des interventions successives. Dès 1917, les États-Unis se positionnent comme une puissance mondiale et, avec leur industrie militaire, imposent leur hégémonie durant la Seconde Guerre mondiale. Après Hiroshima et Nagasaki, le pays adopte une posture ambivalente, oscillant entre « libérateur » et « conquérant ». Le documentaire explore cette dualité à travers les grandes étapes de l’histoire américaine, une trentaine de témoins et d’experts interviewés sur tous les continents, et s’interroge sur l’avenir de cette puissance militaire dans un monde en pleine recomposition géopolitique. En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, une présentation de ce documentaire-événement disponible sur Arte.tv dès le 4 mars 2025, et en avant-première à Lille le 28 février 2025 (inscriptions closes), à Paris le 3 mars 2025 (sur inscription à marianne@hikarigroupe.com) et enfin le 6 mars 2025 à Strasbourg (sur inscription).
Les États-Unis sont en guerre de manière quasiment continue depuis 150 ans. Depuis la Guerre de Sécession. La guerre n’est plus, dans la vision géopolitique de l’Amérique, un accident, c’est la redéfinition permanente de la « Frontière », mais aussi un débat permanent entre une volonté isolationniste et un désir impérialiste (sous des formes multiples). C’est une nouvelle normalité qui a fini par s’imposer et infuser à tous les étages de la société américaine. Cette identité guerrière et la culture militaire qu’elle a façonnée sont désormais une matrice essentielle du logiciel politique américain. Et une clé de lecture majeure des crises actuelles et à venir. Plusieurs centaines de conflits et d’interventions militaires (visibles, invisibles, légales, libératrices, intérieures, secrètes, coloniales, dans l’espace… ou nucléaires) peut être comptabilisée depuis la Guerre d’indépendance (1775-1783) et la Guerre de Sécession (1861-1865). Dès les origines, l’Amérique se fabrique dans la guerre. Guerre intérieure et expansion de la « Frontière » à l’Ouest, guerre d’Indépendance, rachat de la Louisiane à la France et, à partir de 1846, elle s’empare de la moitié du territoire mexicain : la Californie, le Nevada, l’Utah, l’Arizona ou le Nouveau-Mexique… Lorsque, 15 ans plus tard, la Guerre de Sécession commence, elle devient la matrice de cette Nation.
Depuis, l’Empire américain n’a jamais cessé d’être en guerre (ou en paix après une guerre), dans le monde, en Europe, dans le Pacifique, en Afrique, dans l’espace, dans les deux guerres mondiales, au Viêt-Nam, en Irak, et tout au long de la première Guerre froide avec l’URSS et désormais à travers une seconde Guerre froide qui se déroule dans la zone Asie-Pacifique avec la Chine, au Moyen-Orient contre l’Iran ou face au Hamas, et bien sûr en Europe, en Ukraine, face à Poutine. Cette histoire est au cœur de l’identité de l’Amérique (et des enjeux électoraux majeurs, sous Wilson, Roosevelt, Johnson, Truman…) et touche toutes les strates de sa culture — et la nôtre… — à la mythologie occidentale, portant de nombreux paradoxes ; comprendre cette identité, c’est comprendre le présent et comprendre que l’Amérique a pour nécessité d’être dans un rapport de force (conquérant ou libérateur) avec le reste du monde. Plusieurs fronts aujourd’hui marquent un tournant majeur : l’Ukraine, Taiwan et le Moyen-Orient. Et demain, un quatrième en gestation, Panama… et des revendications sur le Canada et le Groenland.
Si le retour de la guerre en Europe mobilise l’attention et les moyens américains, c’est le « front » dans la zone indo-pacifique qui constitue la priorité des décideurs à Washington : la Chine est perçue comme la grande rivale stratégique du XXIe siècle. Une menace plus sérieuse encore que l’était l’URSS au XXe siècle, car la Chine est non seulement un rival militaire et idéologique, mais a connu depuis le début du siècle une réussite économique qui en a fait une puissance globale. Pour tenter de trouver un sens plus profond à la situation présente en saisissant la nature profonde, politique et culturelle, de la plus grande puissance mondiale depuis plus d’un siècle, il est essentiel de retourner en arrière et de suivre, pas à pas, l’évolution du pouvoir américain à travers ses ambitions, ses stratégies et actions militaires incessantes… Comprendre, grâce à l’histoire, pourquoi et comment l’Amérique porte une culture qui valorise la guerre, qui embrasse le bellicisme dans toute sa société, qui voue plus de la moitié de son budget fédéral aux conflits, à l’armement et à la militarisation de la culture. Un pays au premier rang mondial de l’exportation de munitions et qui, aussi et paradoxalement, a parfois et indéniablement libéré des pays de la botte de régimes les plus sanglants…
Depuis le dernier tiers du XIXe siècle – moment fondateur qui, en redéfinissant la Nation, préfigure également les luttes politiques et sociales ultérieures – l’Amérique s’inscrit dans une dynamique de conflits internes. Dès l’indépendance, le Nord et le Sud s’affrontent sur des questions déterminantes telles que l’esclavage et l’unité nationale. La victoire du Nord, obtenue au prix de plus de 600 000 vies, amorce une série de conquêtes intérieures, notamment contre les populations autochtones, et le massacre de Wounded Knee (1890) demeure un symbole poignant des divisions internes. En 1898, la fin des guerres indiennes et le déclenchement des guerres hispano-américaines ouvrent une ère d’expansion impériale sur des territoires tels que Cuba, Porto Rico, Guam et les Philippines – ces dernières intégrées comme une « colonie » de l’empire naissant. Par la suite, l’Amérique impose son aire d’influence sur l’ensemble du continent, se réservant le droit d’intervenir militairement au Nicaragua, d’occuper Haïti, de soutenir des révolutions à Cuba et à Panama, ou encore de négocier des conflits frontaliers, notamment entre le Venezuela et le Guyana.
Longtemps isolationnistes, les États-Unis entrent en guerre en 1917, après le torpillage de navires et la menace d’une alliance entre l’Allemagne et le Mexique. Le président Wilson proclame alors : « L’Amérique doit donner son sang pour les principes qui l’ont fait naître. » En 1918, alors que l’industrie et la marine américaines connaissent un essor sans précédent, le pays se distingue sur les champs de bataille européens. La victoire, confirmée par le Congrès de Versailles, propulse les États-Unis au rang de puissance-monde, même si le rejet de la Société des Nations annonce un repli temporaire vers l’isolationnisme. Durant l’entre-deux-guerres, Washington réduit son engagement en refusant d’intervenir dans des conflits étrangers – que ce soit en Mandchourie, en Éthiopie, en Espagne ou lors des premières agressions en Europe – jusqu’à ce que l’attaque de Pearl Harbor en 1941 impose une mobilisation totale. Du débarquement en Normandie (1944) aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki (1945), la Seconde Guerre mondiale réaffirme la puissance militaire et économique des États-Unis ainsi que leur leadership naissant au sein de l’ONU.
La Guerre froide propulse l’Amérique au rang de puissance hégémonique et légitime ses multiples interventions sous le couvert de la lutte contre le communisme. Dès les années 1950, Washington s’engage dans des conflits indirects – soutien à des dictatures anti-communistes et financement de guérillas – avant de mener des opérations directes au Vietnam et en Afghanistan. La guerre de Corée (1950-1953) et, plus tard, le conflit vietnamien (1955-1975) illustrent les limites d’un interventionnisme motivé par la lutte contre le communisme, la chute de Saigon en 1975 résonnant encore avec l’évacuation chaotique de Kaboul en 2021. La chute de l’URSS en 1991, suivie de la guerre du Golfe et des interventions en Yougoslavie, conforte son rôle de « gendarme du monde ».
Simultanément, l’après-Seconde Guerre mondiale met en lumière les profondes divisions qui traversent la société américaine. Le retour de centaines de milliers de soldats noirs, confrontés à une ségrégation implacable, catalyse une lutte pour l’égalité, illustrée par l’arrêt Brown v. Board of Education (1954) et par les affrontements violents à Selma (1965). Parallèlement, la question migratoire s’exacerbe dès les années 1950, alors que les expulsions massives de migrants mexicains et la construction du mur nourrissent l’idée d’une « guerre raciale ». De plus, la tradition des armes, héritée de la Révolution américaine, se voit investie d’une dimension identitaire. Depuis les années 1970, la National Rifle Association, fondée en 1871, transforme le débat sur le port d’armes en un enjeu politique majeur, faisant de l’arme un symbole de liberté et de résistance.
Le 11 septembre 2001 marque une rupture décisive. L’onde de choc de ces attentats propulse les États-Unis dans une nouvelle ère militaire, désormais orientée contre les « axes du mal » et le terrorisme d’Al-Qaïda. L’intervention en Afghanistan (2001), suivie de celle en Irak (2003) sous prétexte des armes de destruction massive, ainsi que les opérations contre Daech en Syrie et en Irak dès 2014, mobilisent des ressources considérables et redéfinissent durablement la stratégie militaire américaine. Parallèlement, l’attention se porte désormais vers la zone indo-pacifique, face à la menace grandissante que représente la Chine autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale, annonçant ainsi une « Nouvelle Guerre froide » où la confrontation militaire et les sanctions technologiques pourraient marquer un tournant géopolitique majeur.
La culture populaire, notamment à travers Hollywood, joue un rôle déterminant dans la construction de ce mythe guerrier, véhiculant l’image d’une Amérique héroïque même en cas d’échec. Films, romans, jeux vidéo et médias participent aujourd’hui à redéfinir le champ de bataille, qui s’étend désormais à la cyberguerre et à la désinformation. Cette évolution témoigne d’un nouvel ordre conflictuel où l’influence américaine s’exerce autant par la force des armes que par la domination des récits.
Cela fait plus de deux siècles que les États-Unis construisent ainsi leur nation et modèlent les frontières en engageant des rapports de force en différents endroits du monde : tour à tour « libérateurs » ou « agresseurs ». Se déploie le panorama d’une histoire tout à la fois colonialiste, impérialiste, libératrice, démocratique, souvent hollywoodienne, toujours guerrière, sur les théâtres des opérations au Japon, à Hawaï, en France, aux Philippines, en Afghanistan, en Tunisie, dans l’espace, au Nicaragua, au Liban, à Haïti, en Corée, au Cambodge, ou bien en Somalie (la liste est longue), mais aussi à l’arrière, dans les méandres des guerres secrètes de la CIA ou en marge des fronts les plus médiatiques.
C’est l’incroyable Histoire d’un pays-continent qui a traversé le dernier siècle avec des victoires éclatantes et de sanglants revers (Viêtnam, Afghanistan, Irak…), qui a provoqué injustices et délivrances en même temps avec ses forces militaires, qui a incontestablement changé le cours de notre civilisation et l’évolution des sociétés modernes : les effets s’en répercutent, aujourd’hui même, dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Il est important d’éclairer cette histoire au cœur de l’identité de la culture et de la mythologie occidentale, avec ses nombreux paradoxes et ses effets sur le monde et la « vieille Europe ».
Comprendre cette identité, c’est comprendre l’Amérique en 2025, c’est regarder autrement la « nouvelle politique » américaine de Donald Trump à l’aune de son mandat qui commence. C'est aussi comprendre les nouveaux défis géopolitiques auxquels est confrontée aujourd'hui l'Europe, poussée à repenser sa propre stratégie de défense qui jusqu'alors s'appuyait sur l'allié américain. La France, en particulier, voit son armée redéfinir ses priorités. Privée de son ancrage traditionnel en Afrique, elle réinvestit désormais le théâtre européen. Son déploiement massif en Roumanie et les perspectives d’un engagement en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu témoignent de ce basculement. Cette réorientation s’accompagne également d’enjeux nucléaires cruciaux : face à l’incertitude autour du parapluie américain, Friedrich Merz, pressenti comme le prochain chancelier allemand, plaide pour un rapprochement stratégique avec la France et le Royaume-Uni. Cette dynamique marque l’émergence d’un nouvel équilibre des forces en Europe, tout en révélant les tensions et recompositions profondes qui redessinent les liens entre les États-Unis, l’UE et l’OTAN, mais aussi les enjeux dans la zone indo-pacifique, au Moyen-Orient ou sur le continent américain (Panama, Groenland, Canada...) qui sont, eux aussi, au cœur de ce documentaire.
