« Tracer des frontières »
par Jean-Baptiste Veber
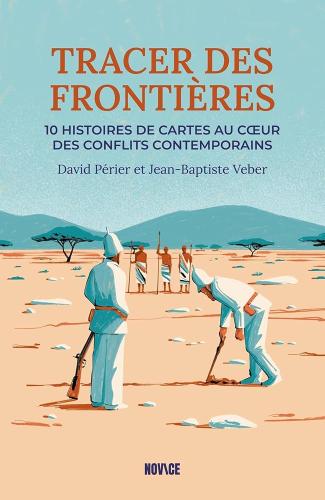
David Périer, géographe, professeur en classes préparatoires et rédacteur pour le magazine l'Éléphant, et Jean-Baptiste Veber, écrivain, historien, professeur d'histoire-géographie dans le secondaire et en classes préparatoires, mènent depuis plusieurs années une réflexion croisée sur les représentations de l’espace, les récits politiques et les enjeux contemporains liés aux territoires. Leur approche, à la jonction de l’histoire et de la géographie, propose une lecture critique des frontières comme constructions humaines : situées, contestées, parfois imposées, elles incarnent autant de rapports de force que de mémoires collectives. Des confins sahariens aux réserves amérindiennes, des zones économiques exclusives issues de Montego Bay à l’enclave russe de Kaliningrad, leurs analyses montrent comment les cartes héritées du passé structurent encore, en profondeur, les tensions du présent. En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, Jean-Baptiste Veber présente leur ouvrage Tracer des frontières (Éditions Novices, 2025), un essai de géopolitique accessible et rigoureux, construit autour de dix cartes et autant d’histoires de territoires. À travers ce livre, ils interrogent les logiques – politiques, historiques, mémorielles – qui président au découpage du monde. Pourquoi trace-t-on des frontières ? D’où vient la légitimité de ces lignes ? Quelles histoires, quels conflits, quelles aspirations portent-elles ? Une réflexion nécessaire sur les géographies invisibles, les héritages coloniaux et les équilibres fragiles qui continuent de façonner les relations internationales.
L’écriture de « Tracer des frontières » a démarré à cause d’un questionnement d’actualité : qui détient la légitimité de partager le monde ? Cette interrogation en entraîne beaucoup d’autres : d’où provient la volonté de découper la planète ? Pourquoi divise-t-on les peuples et les territoires avec des frontières ? À quand remonte le phénomène ? Est-ce un processus naturel, humain, historique, géographique ? Les réponses à ces questions sont multiples. Elles peuvent paraître contradictoires. Il est aussi possible d’établir des complémentarités. Personne ne détient la légitimité de tracer les frontières. Elles résultent toujours de compromis, de la prise en compte de plusieurs réalités, humaines, naturelles, historiques, géographiques.
Il n’existe pas de « frontières types », seulement sur le papier. C’est un concept juridique sorti de cabinets diplomatiques, qui voulait à l’origine s’adapter à la diversité des territoires. Il existe autant de frontières que de peuples, même que de « couple » de peuples, de part et d’autre des limites dessinées par le temps, l’espace, les équilibres géopolitiques régionaux, mondiaux.
On ne peut se fonder sur une seule loi pour expliquer la frontiérisation du monde, il faut en convoquer plusieurs : la loi du plus fort et celle du plus faible (nombreux sont ceux qui veulent le protéger), la volonté d’établir la paix, les impérialismes nationaux, matériels, la quête de justice dans les relations nationales et internationales, les égoïsmes et cupidités des élites, des peuples, les aspirations à la liberté, à se découvrir une mère patrie, à obtenir l’indépendance, à croire dans le progrès...
Les frontières ont mauvaise presse pour plusieurs raisons, qui s’entendent tout à fait – guerres, spoliations, acculturations… Mais elles n’ont peut-être pas aussi bonne réputation qu’elles le mériteraient, tant elles peuvent se justifier, et parfois être acceptées en dépit de l’histoire, appropriées malgré la géographie, aimées malgré – ou grâce – à des mémoires anciennes, douloureuses, vivantes.
La démarche adoptée pour comprendre le sujet mêle étroitement l’histoire et la géographie. Le livre est construit dans une perspective géo-historique : partir de la géographie d’un lieu, d’une carte, en l’occurrence de cartes de frontières, pour les historiciser et montrer l’articulation entre temps et espace à l’origine des situations contemporaines.
En exergue de l’ouvrage, comme un rappel de l’esprit qu’on a voulu imprimer au livre, figure une citation de Michel Foucher : « Les frontières sont du temps inscrit dans l’espace ; elles restent des buttes-témoins du passé ou des fronts vifs, selon les conjonctures locales, toujours des lieux de mémoire et parfois de ressentiment. »[1] Après une introduction présentant la notion juridique et ses implications géographiques actuelles, puis la dimension historique relativement récente des frontières, telles que pratiquées par les puissances établies ou celles qui cherchent à le devenir, dans le concert des nations contemporaines, les auteurs déclinent le sujet en trois sous-thèmes qui distinguent différentes sortes de frontières.
Ils identifient des délimitations insolites, étranges, étonnantes, qui n’en revêtent pas moins une importance majeure, comme les frontières africaines héritées des colonisations et décolonisations, les frontières intérieures aux États-Unis des réserves amérindiennes ou encore le nouvel horizon des frontières apparut dans les années 1970 avec la conférence de Montego Bay et l’invention des ZEE.
Ils s’intéressent ensuite à des frontières qui sont objets de controverses, de désaccords, parfois jusqu’à l’affrontement, économique ou militaire, jusqu’à la guerre : tensions entre le Maroc et l’Algérie au sujet de leurs confins sahariens, conflits insolubles entre Israéliens et Palestiniens, crispations nationalistes autour du désert d’Atacama entre le Chili, le Pérou et la Bolivie.
Ils étudient enfin des frontières tracées par un ou plusieurs acteurs extérieurs à la région, imposées en dépit des peuples, de l’histoire et de la géographie, pourtant acceptées de nos jours : catégorie dans laquelle on retrouve les frontières africaines, où l’on s’intéresse aussi aux frontières du Moyen-Orient, résultant du démembrement de l’Empire ottoman, et enfin, en manière de conclusion, pour montrer l’actualité brulante et complexe du sujet, la frontière de l’enclave russe de Kaliningrad dans l’Union Européenne, comme une réincarnation improbable de la Guerre Froide.
[1] Michel Foucher, Les frontières, CNRS Éditions, Documentation photographique, dossier N° 8133, 2020.
SOMMAIRE
Introduction
Des frontières de sables et de papier en Afrique ?
Les réserves amérindiennes, des frontières intérieures aux États-Unis ?
Découper les mers : les frontières maritimes en mer d’Asie orientale
Le Maroc, un État ancien aux frontières récentes
Triangle de tensions frontalières autour du désert d’Atacama
Le Cabinda angolais, une enclave africaine à proximité de l’embouchure du fleuve Congo
Le dépeçage du Moyen-Orient ottoman
Israël et Palestine, de sacrées frontières
Chypre écartelée par une frontière intérieure imposée de l’extérieur
L’enclave de Kaliningrad-Königsberg
Notes
