Les occupants : les Américains pendant l’occupation au Japon
par Michael Lucken
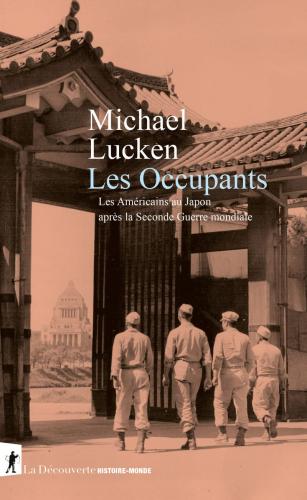
En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, l’historien Michael Lucken présente son nouvel ouvrage Les occupants : les Américains pendant l’occupation au Japon (La Découverte, 2025). Michael Lucken est professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), historien de l’art et historien spécialiste du Japon contemporain. Il a notamment publié Les Japonais et la Guerre, 1937-1952 (Fayard, 2013, prix Thiers 2014) et Le Japon grec. Culture et possession (Gallimard, 2019, Grand Prix des Rendez-vous de l'histoire à Blois). Dans cette tribune, le chercheur revient sur la doctrine, les modalités et les conséquences de l’occupation américaine au Japon, qui s’est déroulée de 1945 à 1952. Cette enquête inédite dans le milieu francophone expose la mise en place d’un gouvernement militaire sous commandement états-unien qui a donné lieu à l’actuelle Constitution nippone. D’après l’auteur, l’administration du Japon par Washington est organisée selon une doctrine pragmatique : il s’agit de planifier l’occupation pour une intégration efficace au modèle démocratique libéral et d’optimiser le contrôle exercé par les États-Unis dans le Pacifique. Cet appareil institutionnel et militaire s’accompagne d’une politique culturelle : l’américanisation des esprits et des pratiques fait partie de la stratégie d’occupation. Si les méthodes côté états-unien sont analysées, l’auteur couvre aussi la réception non-violente de ces mesures par les élites et la population japonaises. À travers cette étude de cas, Micheal Lucken raconte l’histoire contemporaine du monde sous hégémonie américaine, à l’heure où celle-ci est largement contestée, mais toujours invaincue.
Une leçon pour le présent
Deux ennemis implacables. L’un, qui se lie avec le IIIᵉ Reich, mène une guerre d’agression terrible en Chine et ailleurs, sacrifie ses hommes au-delà de toute mesure. L’autre, qui emploie sans restriction des bombes incendiaires et atomiques sur des populations civiles. Et pourtant : quelques années plus tard, au début des années 1950, ces deux nations, le Japon et les États-Unis, scellent une alliance qui, depuis, résiste aux événements. Il y a quelque chose d’exceptionnel dans la relation qui s’est nouée entre les deux pays au terme de près de quatre ans de guerre et sept ans d’occupation militaire.
Les États-Unis ont longtemps considéré que ce qu’ils avaient obtenu au Japon pouvait servir de modèle. Leur approche ferme mais sans brutalité aurait permis à la fois d’éviter le retour de la guerre et d’arrimer l’archipel au « monde libre ». Encore au début des années 2000, George W. Bush faisait référence aux succès américains au Japon et en Allemagne pour justifier sa décision d’intervenir en Irak. Mal lui en a pris. Toutefois, la réélection de Donald Trump, en novembre 2024, ouvre une page nouvelle où les États-Unis ne cherchent même plus à masquer la défense de leurs intérêts derrière la promotion de la démocratie. Si bien que l’impression domine, en particulier en Europe, que c’est tout l’équilibre trouvé au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui menace de s’effondrer.
En analysant les dynamiques militaires, politiques et idéologiques de l’occupation américaine du Japon, ce livre entend contribuer au bilan de la période qui s’achève et dresser des perspectives d’avenir : comprendre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué, ce qui est conjoncturel et ce qui est généralisable, ce qui a gardé du sens et ce qui n’en a plus, sont autant de tâches sur lesquelles il nous faut avancer.
L’enquête que nous proposons ici se situe à l’intersection de deux routes extrêmement fréquentées, mais étrangement délaissées dans le monde francophone. La première suit cet épisode fondamental dans l’histoire des États-Unis et de la région Asie-Pacifique qu’est la présence au Japon entre 1945 et 1952 d’un gouvernement militaire américain dirigé par un général ayant le titre de commandant suprême des forces alliées. […] Conduite sous l’autorité du général Douglas MacArthur (1880-1964), elle s’est traduite sur le plan juridique par l’ouverture du procès de Tokyo, à l’issue duquel furent exécutés le général Tōjō Hideki et six autres responsables de la politique d’expansion militaire japonaise. Parallèlement, une nouvelle Constitution fut promulguée, prévoyant le maintien de l’empereur comme symbole de la nation et la renonciation aux armes comme moyen de résoudre les conflits internationaux (article 9). Les conglomérats industriels (zaibatsu) ayant financé l’effort de guerre furent démantelés et le système éducatif profondément remanié afin de transmettre aux jeunes les valeurs démocratiques. L’occupation s’achève en avril 1952 par l’entrée en vigueur des traités de San Francisco qui redonnent au gouvernement japonais sa souveraineté nominale tout en maintenant sine die la présence militaire américaine dans l’archipel. […]
Le pragmatisme américain
La deuxième question que cette étude soulève concerne le pragmatisme américain, car il est couramment admis que la Pax Americana qui s’installe après 1945 en porte le sceau. La politique amorcée sous la houlette de Franklin Roosevelt et poursuivie par l’administration Truman veut en effet avant tout obtenir des résultats : que les initiateurs du conflit ne puissent plus entraîner le monde dans la guerre ; que des institutions de type démocratique soient mises en place dans ces pays ; que les économies et les normes soient unifiées afin de faciliter, mais aussi de contrôler, les échanges. En rupture avec l’idéalisme wilsonien […] cette politique pragmatique ne repose pas tant sur le partage des valeurs et la concertation que sur un alliage savant de planification et de souplesse, de force et de persuasion, de constance dans la direction et d’attention aux opportunités du moment. […]
Des dynamiques impériale, capitaliste et libérale ont bien sûr été également à l’œuvre, mais la réticence de la nation américaine à entrer en guerre malgré les bombardements allemands sur Londres, tout comme le poids extraordinaire pris par l’armée et l’administration durant les années 1940, permettent difficilement de leur accorder un rôle central. […] Ce qui domine au Japon est davantage une professionnalisation de l’occupation – mieux planifiée, plus méthodique, plus efficace –, en rupture avec la logique de représailles et de réparations financières qui prévalait jusqu’alors. […] La façon dont les élites et la population japonaises ont accepté la capitulation et accueilli les armées d’occupation traduit également une forme de pragmatisme. […] Une relation non violente a ainsi vu le jour entre anciens belligérants et, aujourd’hui encore, le Japon porte en lui les traces profondes de l’intervention américaine. […]
Entre contrôle du Pacifique et transformation démocratique
Le manque d’ouvrages de référence en français sur l’occupation américaine du Japon invite à adopter une perspective large, à déployer cette histoire dans le temps et l’espace, à considérer des domaines variés, de la géopolitique au sport, mais toujours en revenant aux documents fondateurs dans lesquels on avisera les récurrences, les formules types, davantage que les événements et les propositions nouvelles. […] L’administration militaire de l’Archipel par les États-Unis a débuté fin août 1945, avec le débarquement des premières troupes états-uniennes à proximité de Tokyo, et pris fin le 28 avril 1952, date d’entrée en vigueur du traité de paix de San Francisco. […] Mais ces bornes consacrées par le droit international sont trop restrictives, que ce soit en amont ou en aval. […] L’occupation américaine repose sur un double projet de contrôle stratégique du Pacifique et de transformation tous azimuts de la société nippone. Elle comprend donc plusieurs facettes. La première et la plus évidente résulte de la soumission du gouvernement impérial à la menace d’une« dévastation totale du sol japonais », pour reprendre les termes utilisés par les Alliés en juillet 1945 dans la déclaration de Potsdam. […] La souveraineté militaire étant un aspect important de l’indépendance des nations, l’impression diffuse que l’occupation n’a jamais vraiment cessé s’est ainsi perpétuée jusqu’à nos jours. […]
La politique de « réorientation des esprits » compose le second volet de notre enquête. Menée conjointement par le SCAP, les agences de renseignement, les fondations privées et les grandes universités américaines, elle cherche à convertir les élites et la jeunesse japonaises, et à travers elles toute la société nippone, aux principes de la démocratie représentative libérale. […]
Ce management de la psychologie sociale est l’une des principales caractéristiques des politiques de rééducation conduites par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au Japon comme ailleurs. […] Même s’il faut bien considérer les spécificités de la situation est-asiatique, l’occupation américaine du Japon reflète des évolutions qui se retrouvent, à des degrés divers, sur les cinq continents. À travers le cas japonais, c’est, comme on l’a déjà dit, au monde contemporain qu’il s’agit de réfléchir.
Les limites de l’américanisation
L’examen de la politique culturelle américaine au Japon après 1945 forme le troisième et dernier pan de cette étude. De façon générale, il est évident que pour les populations concernées une occupation ne se limite pas à la subjugation militaire […]. Dans le Japon d’après-guerre, c’est la taille des GI et de leurs véhicules, les rythmes du jazz, les calories faciles du chocolat et des candies qui ont impressionné. Or ces découvertes, qui provoquent des réactions de peur, de gène, de curiosité, d’excitation, ont des conséquences psychologiques. Elles touchent les sociétés de façon globale et profonde. […]
L’expérience que les Japonais ont faite de la présence alliée ne relève pas seulement d’un régime de contrainte, elle a fait bouger les corps et les consciences. […] À travers la culture, c’est le temps long de l’américanisation qui se dessine. Toutefois, la pénétration de la culture américaine n’est pas, là encore, sans susciter des réactions. Au Japon comme ailleurs, s’expriment des formes de contestation frontale de l’hégémonie des États-Unis et du système politique établi sous leur responsabilité. […] Il faut reconnaitre toutefois que les arguments avancés par les mouvements contestataires n’ont pas réussi à imposer un autre modèle et ont finalement été absorbés dans le marché des idées ouvert par le capitalisme démocratique. La critique de l’Amérique n’a pas débouché sur une autre société. Elle a au contraire contribué à arrimer la jeunesse japonaise aux valeurs libérales promues par les États-Unis.
Ce qui nous conduit à la question suivante, qu’on retrouvera en filigrane tout au long de ce livre. Pour sortir d’un système qui juge de la qualité des réalisations humaines d’après des critères essentiellement quantitatifs (chiffres d’affaires, bénéfices, audiences, records de vente…), caractéristiques du modèle pragmatique contemporain, l’opposition au nom de grands principes s’est révélée hélas inefficace depuis des décennies : faut-il par conséquent revenir aux idéologies tranchées, à l’ultranationalisme, au communisme, ou peut-on imaginer que le pragmatisme se reforme de l’intérieur ?
SOMMAIRE
Introduction. Une leçon pour le présent
Le pragmatisme américain
Entre contrôle du Pacifique et transformation démocratique
Les limites de l'américanisation
1. Une stratégie au long cours
Le Pacifique, lac américain ?
Un enjeu depuis le XIXe siècle
Les conséquences militaires de la victoire américaine après 1945
Le double rôle de MacArthur
L'implosion de l'Empire japonais
Un rôle civilisateur : la folle illusion
Une défaite totale
Une opération planifiée
L'exigence d'une capitulation sans condition, un tournant
Les préparatifs de l'occupation par l'US Army : doctrine et actions
Les plans du département d'État
L'emprise tentaculaire de l'occupation américaine
L'opération Blacklist
L'absence de résistance organisée
Entre fermeture et libération
Un gouvernement indirect
L'organisation du SCAP
La démocratisation : succès américain ou aspiration locale ?
Les gouvernements de collaboration
Une présence sine die ?
Le renversement de cap de 1948
Les traités de San Francisco
Les ambiguïtés de la fin de l'occupation
2. Démocratiser les esprits
Une mission spirituelle
L'héritage protestant
Un réformisme progressiste
De la guerre psychologique à la réorientation idéologique
Une continuité par-delà 1945
Comprendre la "mentalité japonaise'
La logique d'"accompagnement'
Le contrôle de la connaissance
Les centres de documentation de la CIE
La nouvelle bibliothèque nationale de la Diète
Un malaise partagé
L'inavouable censure
Le fonctionnement du Civil Censorship
Detachment
De la répression au renseignement
Le rôle des fondations privées : le cas de la Rockefeller
Le pilotage de la recherche
Une coordination accrue avec l'État
Vers une refonte de la philosophie
Le Séminaire sur les études américaines
Les intellectuels japonais : de la coopération à l'opposition
Un intérêt précoce pour la pensée américaine
Pragmatisme et impérialisme, l'impossible conciliation
3. Succès et limites du modèle américain
Base-ball contre arts martiaux
La dissolution de la Butokukai
Le triomphe du base-ball
Un déséquilibre persistant
Un art paisible
L'engouement américain pour la gravure de création
Un choix contraint
L'échec du mercantilisme américain
Tsurumi Shunsuke et John Dewey : deux regards sur l'art
Que faire de l'héritage classique ?
Le rejet par les Américains du modèle colonial
La place des études classiques au Japon
La philosophie grecque, outil de résistance à l'Amérique
Paix au Viêtnam ! Les mouvements contestataires des années 1960
La création de Ligue pour la paix au Viêtnam (Beheiren)
Entre rejet des États-Unis et coordination transpacifique des luttes
Un grain de sable dans la machine
Conclusion. Un impérialisme réinventé
La domination de l'anglais, hier et aujourd'hui
Un pragmatisme rénové pour une démocratie renouvelée
