« Pour un musée engagé. Transmettre, interroger, inspirer »
par Aurélie Clemente-Ruiz
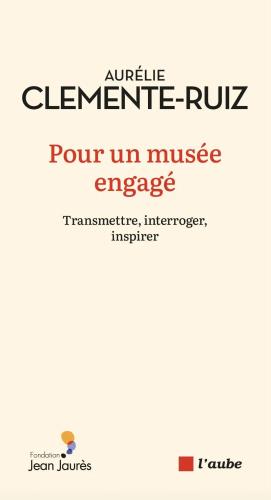
Dans son dernier ouvrage, Pour un musée engagé. Transmettre, interroger, inspirer, paru le 2 septembre 2025 aux éditions de l’Aube, Aurélie Clemente-Ruiz, directrice du Musée de l’Homme, propose une réflexion approfondie sur l’évolution des institutions muséales. D’espaces jadis voués à la contemplation et à la transmission d’un récit historique canonique, les musées tendent aujourd’hui à se redéfinir comme des lieux de dialogue, d’interpellation et d’expérimentation. Ouverture à la justice sociale, sollicitation de l’esprit critique, confrontation aux problématiques du temps présent : autant de dynamiques qui, depuis plusieurs années, réorientent en profondeur la vocation des musées. Ces inflexions, cependant, soulèvent des interrogations majeures : un musée doit-il se maintenir dans une neutralité proclamée ou, au contraire, assumer un positionnement affirmé ? Comment concilier, sans les diluer, l’exigence scientifique, la reconnaissance mémorielle et l’attente croissante de représentativité ? Le Groupe de recherche Achac publie cette semaine, en tribune, l’avant-propos de cet essai, qui éclaire les fondements de cette réflexion sur l’engagement muséal. La démarche d’Aurélie Clemente-Ruiz tire sa force d’une expérience professionnelle particulièrement riche : directrice des expositions à l’Institut du monde arabe, enseignante à la Sorbonne Abu Dhabi, elle devient en 2022 la première femme appelée à diriger le Musée de l’Homme. Ce parcours confère à son analyse une légitimité singulière : nourrie par près de deux décennies d’immersion dans le champ muséal, sa pensée interroge avec acuité le rôle que ces institutions doivent désormais assumer au sein de la cité et dans le façonnement des imaginaires collectifs.
Je travaille dans le monde des musées depuis plus de vingt ans. Vingt années à observer, écouter, apprendre et parfois douter. Car le musée, cette institution que l’on croit immuable, n’a cessé d’évoluer, de se redéfinir, de se repositionner face aux attentes mouvantes de la société. Quand j’ai commencé, le musée était encore perçu par beaucoup comme un sanctuaire silencieux, un conservatoire du passé, réservé à une élite savante ou à des écoliers en sortie pédagogique. C’était un lieu de contemplation, de savoir, de rigueur. Aujourd’hui, il est devenu, ou du moins cherche à devenir, un espace de débat, d’interpellation, d’expérimentation.
Depuis vingt ans, j’ai vu se transformer en profondeur la façon dont on pense, conçoit et habite un musée. Ces anciens temples de la connaissance se sont ouverts à la parole des visiteurs. On ne vient plus seulement y admirer des œuvres ou y lire l’histoire officielle. On y vient pour questionner, confronter, construire ensemble. J’ai vu apparaître des espaces de co-construction des expositions, des parcours pensés avec les publics, des résidences d’artistes. J’ai vu des conservateurs remettre en cause leurs propres pratiques, des équipes muséales se former à l’inclusivité, des artistes venir troubler les récits figés.
Il y a vingt ans, le mot « engagement » n’était pas un adjectif accolé au musée. Aujourd’hui, il l’est souvent – parfois galvaudé, mais parfois assumé avec une véritable sincérité. Engagé pour plus de justice sociale, pour l’environnement, pour la reconnaissance des mémoires plurielles. J’ai vu émerger la question des restitutions, d’abord confidentielle, puis devenue centrale. J’ai entendu des voix longtemps ignorées se frayer un chemin dans la programmation : artistes femmes, artistes issus de communautés invisibilisées… J’ai vu des médiateurs interroger leurs postures, des architectes réfléchir à la manière d’ouvrir physiquement les lieux, des commissaires d’exposition intégrer des récits en rupture avec les canons dominants.
Mais j’ai aussi observé, dans le même temps, des crispations, des oppositions. Le musée est devenu un espace de tensions symboliques : doit-il prendre position ou rester neutre ? Est-il encore possible de raconter une histoire commune sans effacer certaines voix ? Comment concilier exigence scientifique, reconnaissance mémorielle et attente de représentativité ? Ces questions, je les ai vues surgir dans des réunions, des conseils scientifiques, des débats publics. Elles sont devenues omniprésentes, souvent inconfortables, mais nécessaires.
Aujourd’hui, les musées font régulièrement la une de l’actualité. Des œuvres sont prises pour cibles par des militants écologistes, les débats sur la restitution des objets issus de la colonisation s’intensifient, tandis que les coupes budgétaires fragilisent ces institutions. Tout cela montre, d’une part, à quel point les musées sont au carrefour de nombreux enjeux et tensions de l’époque et, d’autre part, que leur rôle ainsi que leur portée symbolique sont de plus en plus complexes à appréhender dans nos sociétés contemporaines.
Dans un contexte politique mouvant, les musées se retrouvent souvent pris en étau. Certains voudraient qu’ils « prennent parti », qu’ils se positionnent sur tel ou tel sujet. Mais leur vocation n’est pas de faire table rase du passé. Au contraire, ils peuvent offrir un espace de mise en perspective, une chance de redonner du sens dans un monde saturé d’informations et de contradictions. À l’instar de l’école, ils sont aujourd’hui au cœur des questions identitaires. Car les musées incarnent une certaine légitimité : ce qu’on y expose, ce qu’on y raconte, participe à définir ce qui est considéré comme noble, fondateur, constitutif de chaque nation, de chaque culture, de chaque récit collectif.
Mais ce rôle de prescripteur n’est plus incontesté. Les musées sont devenus des champs de bataille symboliques. Le débat public se polarise, les extrêmes s’affrontent, chacun appelant à sa manière à la censure ou à la réécriture d’une histoire jugée plus juste, plus vraie, plus représentative. Quels artistes exposer ? Quels récits valoriser ? Ces interrogations traduisent les fractures profondes de notre époque.
En tant qu’observatrice et témoin privilégiée, il m’a semblé essentiel de proposer, à travers cet ouvrage, un portrait du monde muséal tel qu’il se dessine en 2025. Avec ses héritages, ses limites, ses transformations, mais aussi avec l’engagement sincère de nombreuses institutions pour participer à la vie citoyenne. Ce que je propose ici, c’est un état des lieux subjectif, assumé. Celui d’une professionnelle engagée, parfois inquiète, souvent émerveillée, toujours habitée par une même conviction : le musée, s’il accepte de se réinventer, peut encore être l’un des piliers de notre démocratie sensible.
Il ne s’agit pas de clore les débats, mais d’ouvrir un espace de réflexion : et si les musées, plutôt que d’être pris dans les polémiques identitaires, pouvaient incarner une autre ambition – celle de faire société ?
Avant-propos
Introduction. Le musée, une institution en mutation
1. Histoire et évolution du musée
2. Les musées face aux défis de l’accessibilité
3. Un musée n’est jamais neutre
4. Des typologies muséales à réinventer ?
5. De nouvelles formes de narration
6. Pour une muséologie sociale et durable
7. Un engagement politique et social pour agir sur le monde
Et demain ?
