« Renaissance de Harlem et Black Arts Movement »
par Yohann Lucas
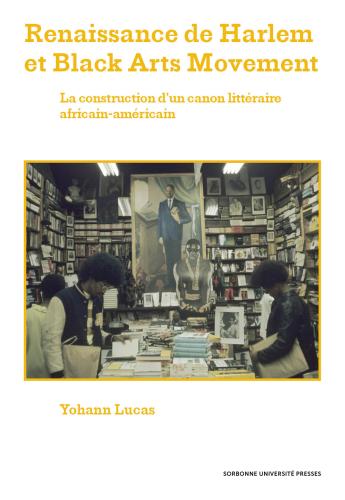
En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, Yohann Lucas, maître de conférences en civilisation des États-Unis à l’université de Rouen, présente son dernier ouvrage Renaissance de Harlem et Black Arts Movement (Sorbonne Université Presses, 2025). Cet essai plonge le lecteur au cœur de la littérature africaine-américaine du XXᵉ siècle et éclaire deux moments d’intense effervescence créative qui ont profondément marqué son histoire. À travers l’étude des œuvres, des revues et des anthologies de ces périodes, l’auteur met en lumière la dynamique foisonnante qui a permis à cette littérature longtemps marginalisée de trouver sa place et d’affirmer sa légitimité. Il montre comment les écrivains et écrivaines, les éditeurs – qu’ils soient issus de grandes maisons blanches ou de structures africaines-américaines indépendantes –, les libraires et les lecteurs ont ensemble contribué à façonner une tradition littéraire mouvante, dont les contours n’ont cessé d’être redéfinis. L’analyse proposée par Yohann Lucas interroge également la mémoire littéraire : pourquoi certains textes ont-ils été sans cesse réédités et transmis, tandis que d’autres, malgré leur importance initiale, ont disparu de la circulation ? Ce questionnement ouvre une réflexion plus large sur les conditions de visibilité et de pérennité des œuvres dans un espace culturel donné. Loin de réduire cette production à une simple chronique des luttes, l’ouvrage montre que la littérature noire étatsunienne a été à la fois une arme politique au service de l’émancipation collective et un formidable laboratoire d’innovations esthétiques et formelles. Elle a nourri la contestation tout en renouvelant profondément les codes littéraires. Destiné autant aux passionnés de littérature qu’aux curieux d’histoire culturelle, ce livre souligne la portée décisive de ces mouvements, qui ont accompagné l’émergence des Black Studies dans les universités américaines à partir de 1968 et confirmé la vitalité d’une tradition désormais reconnue sur la scène internationale.
En 1993, Toni Morrison est la première autrice africaine-américaine à être récompensée du prix Nobel de littérature, événement qui marque une forme d’apogée symbolique en termes de reconnaissance pour la littérature noire états-unienne. Quatre ans plus tard, la maison d’édition W. W. Norton & Company fait paraître la volumineuse Norton Anthology of African American Literature, anthologie qui va peu à peu s’imposer sur les campus aux États-Unis mais aussi à travers le monde comme la référence pour quiconque souhaiterait découvrir cette tradition littéraire. Pour une littérature qui a longtemps été ignorée, oubliée voire méprisée, les éditeurs Henry Louis Gates Jr. et Nellie Y. McKay souhaitent offrir une nouvelle image et donnent alors l’impression d’avoir réuni tous les classiques de la tradition au sein d’un seul volume, fort de plus de 2600 pages et imprimé sur papier bible. Pourtant, il ne s’agit pas du premier volume ayant cherché à compiler et conserver les traces d’une littérature pour le moins éparse car publiée au sein de journaux locaux et régionaux, de magazines éphémères ou d’autres recueils autoédités.
À partir des œuvres publiées au sein de ces magazines et anthologies, Renaissance de Harlem et Black Arts Movement retrace l’histoire d’une partie de la littérature noire états-unienne du vingtième siècle. Les deux périodes qui forment le centre de gravité de l’étude se caractérisent en effet par une ébullition artistique et éditoriale qui a fortement contribué à dessiner les contours de la tradition littéraire africaine-américaine et l’un des enjeux est de comprendre l’évolution ou au contraire la pérennité de l’évaluation littéraire. Ainsi, l’ouvrage de Yohann Lucas ne propose pas simplement une chronique de deux mouvements littéraires mais analyse les mécanismes qui expliquent comment, publication après publication, certains textes sont reproduits et conservés tandis que d’autres sont laissés de côté et progressivement oubliés, offrant ainsi une réflexion sur le faisceau de facteurs qui déterminent la fugacité ou la pérennité des œuvres littéraires au sein d’un espace culturel donné.
L’ouvrage scrute la façon dont les multiples acteurs et actrices de la chaîne du livre – artistes, maisons d’édition états-uniennes blanches ou maisons d’édition africaines-américaines, librairies indépendantes ou encore lecteurs et lectrices – ont façonné les contours d’une tradition littéraire résolument foisonnante. Au gré de cadrages éditoriaux divergents, les anthologistes n’ont cessé par exemple d’étendre ou de réduire le périmètre de la tradition qui laisse alors entrevoir toute sa labilité, fluctuant d’un volume à un autre, d’une époque à une autre. Le plus souvent, la tradition littéraire noire a oscillé entre la volonté d’apporter des renouvellements esthétiques, formels et thématiques d’une part et l’ambition de consolider une voix littéraire et politique à même de soutenir la lutte collective émancipatrice africaine-américaine d’autre part. Non contentes de simplement ménager un espace d’expression à des auteurs et autrices, ces publications noires états-uniennes ont activement participé à la légitimation d’une littérature jusqu’alors minorée, tant en révélant la formidable appétence du public pour ces textes qu’en servant d’appuis pédagogiques aux enseignants et enseignantes au moment de la mise en place des Black Studies Departments sur les campus états-uniens dès 1968.
SOMMAIRE
Introduction
1. Littérature et mouvements
Accélération et réseaux
Mouvement démographique, mobilité sociale et identité mouvante
Se définir et être reconnu
2. Une littérature au croisement du populaire et de l’élitaire
Littérature et sciences sociales
L’impact de la mise en place des départements d’études noires
Une littérature pour tous ? La question d’une avant-garde
3. Horizons et limites éditoriales
L’âpreté du marché éditorial états-unien
Reprendre le contrôle
4. Seuils de lecture
Formats, publics et formes d’autorité
La fabrique de l’authenticité
5. Œuvres en mouvement et en césure
Circulation des œuvres d’un médium à un autre
Césures médiatiques, systémiques et épistémologiques
6. La fabrique de la tradition
Le matériau de la tradition
Assembler, affiner et transformer la tradition
7. Préservation symbolique
Réception initiale des œuvres
La littérature comme espace de préservation
Les prix et distinctions littéraires, entre visibilité et invisibilité
Conclusion
Bibliographie
Index
