« Préface : Les décolonisations africaines de Pierre Haski »
par Pap Ndiaye
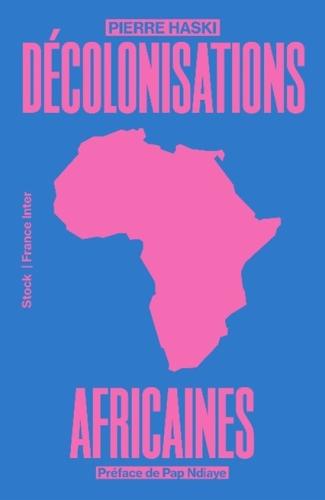
D’abord correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, puis journaliste au sein du quotidien Libération, Pierre Haski a fondé, en 2007, le site d’informations Rue89.com. Il est aujourd’hui chroniqueur géopolitique au Nouvel Obs et au micro de la Matinale de France Inter. Depuis 2017, il préside l’organisation Reporters sans frontières (RSF). Dans son ouvrage Décolonisations africaines (Stock, 2025), adapté du podcast de France Inter, Pierre Haski nous invite à explorer les figures marquantes des indépendances africaines. Après une préface de l’historien Pap Ndiaye, il revient sur plusieurs personnalités décisives de l’histoire des décolonisations : le syndicaliste guinéen Sékou Touré, célèbre pour avoir dit « non » à De Gaulle, le Congolais Patrice Lumumba, devenu le martyr des luttes anticoloniales, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, penseur de la Négritude et homme d’État, ou encore Ahmadou Ahidjo au Cameroun, théâtre d’une décolonisation particulièrement violente orchestrée par la France depuis les hostilités en 1955. Un ouvrage essentiel pour comprendre les enjeux actuels du continent africain et la responsabilité des pays colonisateurs. En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, Pap Ndiaye livre la présentation de ce livre engagé.
Que se passa-t-il pour qu’en vingt ans à peine le continent africain s’émancipât de tutelles européennes qui paraissaient encore si robustes en 1945 ? Avec verve et pédagogie, Pierre Haski nous explique ce tournant historique majeur en centrant son propos sur les « pères » des indépendances, ces personnages charismatiques dont les noms familiers masquent trop souvent la méconnaissance de leurs histoires propres, et des processus par lesquels leurs pays sont devenus indépendants. Issus d’émissions de radio bien accueillies et très écoutées, et auxquelles j’ai eu le plaisir de participer pour certaines d’entre elles, les chapitres de cet ouvrage nous entraînent dans une histoire passionnante qui doit être connue et reconnue.
La décolonisation de l’Afrique est bien une révolution politique, quoique souvent éclipsée par les autres convulsions, les autres fracas, les tragédies du XXe siècle. Ce moment est venu clore une séquence historique longue de trois siècles, qui débuta par l’installation permanente des Européens sur les côtes ouest-africaines à partir du XVIIe siècle (Saint-Louis du Sénégal fut fondée en 1659 par des marchands normands), qui se prolongea par la prise de contrôle de régions de plus en plus étendues, organisées en colonies, avec des fins d’abord commerciales (notamment le commerce d’esclaves), puis politiques, militaires et religieuses. De telle sorte qu’à la fin du XIXe siècle, à l’exception de l’Éthiopie et du Libéria, toute l’Afrique était sous domination coloniale européenne : britannique et française surtout, et aussi portugaise, belge, allemande, italienne, espagnole.
Mais voilà que, dans les années 1950, le système colonial s’effondra comme un château de cartes. Cela, nul ne le prévoyait sérieusement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les pays européens ruinés comptaient encore sur leurs colonies pour se redresser, moyennant des aménagements libéraux, formalisés, côté français, par la Conférence de Brazzaville. « Je ne suis pas devenu le premier des ministres de Sa Majesté pour présider à la liquidation de l’Empire britannique » s’exclamait Churchill en 1942. Cinq ans plus tard, l’Inde de Gandhi prenait son indépendance. Dix ans après l’Inde, le Ghana de Nkrumah hissait fièrement le drapeau de sa souveraineté, frappé de l’étoile noire.
Quels sont les grands facteurs structurels qui permettent de comprendre les trajectoires individuelles et collectives des leaders indépendantistes ?
En premier lieu, il faut considérer les grandes évolutions des sociétés africaines. Dans l’entre-deux-guerres de nouvelles cultures urbaines se firent jour, en contact avec les grands courants culturels et politiques qui traversaient le reste du monde. Cela était vrai dans des villes côtières comme Dakar, ou au bord de grands fleuves comme Léopoldville et Brazzaville. L’intensification des communications maritimes et ferroviaires favorisa l’émergence d’une nouvelle classe urbaine jeune, avide de nouvelles du monde, transmises par les journaux apportés par les marins de passage, et aussi friande de musiques nouvelles : des marins cubains fournissaient des disques de rumba, qui inspirèrent Wendo Kolosoy, mécanicien de bateaux sur le fleuve Congo, l’un des créateurs de la fameuse rumba congolaise. Ces jeunes Africains connaissaient Gandhi, avaient entendu parler de la Harlem Renaissance et du Front populaire. Le syndicalisme était également actif : à Dakar, haut lieu du militantisme syndical, à la fin des années 1930, l’Union des syndicats africains rassemblait plusieurs dizaines de syndicats de branches, rompus à l’art du rapport de force, y compris par la grève. Ces mondes urbains en ébullition furent les terreaux fertiles de la remise en cause du fait colonial.
En second lieu, il convient d’insister sur les temps nouveaux de l’après-Seconde Guerre mondiale. « Hitler nous a fait sortir de la cuisine des Blancs », expliqua crûment une ouvrière africaine-américaine : elle signifiait que, et ses propos sont valables pour les mondes coloniaux, la victoire des Alliés entraîna la remise en cause profonde des théories racistes que le nazisme n’avait pas inventées, mais qu’il avait poussé au paroxysme génocidaire. L’immense édifice du racisme (et de l’antisémitisme) construit « scientifiquement » depuis le XVIIIe siècle venait de subir un coup fatal. Il n’était plus possible de justifier la colonisation au nom de la supériorité de la race blanche. Bien entendu, il ne disparut pas par enchantement, et il subsista encore longtemps un fatras de considérations raciales dans les manuels d’histoire ou les traités de médecine, mais il s’en trouva intrinsèquement délégitimé. La parution de l’essai Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss (1952) représenta en quelque sorte l’acte de décès du racisme scientifique, auquel se substitua un racisme culturel plus insidieux. La création de l’UNESCO marqua institutionnellement l’arrivée des temps nouveaux.
Le chapitre 11 sur les « territoires non-autonomes » de la Charte des Nations Unies ouvrait prudemment la porte aux changements : hors de question d’appeler clairement à la « décolonisation » mais les membres des Nations Unies étaient enjoints à « tenir compte des aspirations politiques des populations et à les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement. » En 1945, en Afrique, les contradictions étaient encore gérables pour les empires.
Il en alla autrement en Asie, soit parce que les colonies d’Indochine et des Indes néerlandaises furent occupées par les Japonais, ce qui nécessita donc pour les Français et les Néerlandais une reconquête militaire très délicate à mener et finalement infructueuse ; soit, dans le cas indien, parce que le mouvement indépendantiste était très avancé avant-guerre et qu’il avait déjà porté, sous la houlette de Gandhi, de rudes coups à la domination britannique. En 1945, le coût militaire et financier de la réaffirmation de son pouvoir colonial dans le sous-continent excédait largement les capacités d’une Grande-Bretagne aux abois.
En troisième lieu, le contexte de la guerre froide : d’un côté l’URSS, auréolée de la victoire de 1945 et de son image anticoloniale frelatée, mettait à profit politique les situations coloniales pour fustiger l’impérialisme bourgeois. C’est ce que répétait, en subordonné dévoué, le Parti communiste français, qui fut certes une pépinière de militants anticolonialistes, mais qui demeura très ambigu à l’égard de leurs initiatives – ce qui entraîna par exemple la démission d’Aimé Césaire, que ce dernier justifia dans son admirable « lettre à Maurice Thorez » d’octobre 1956. Il n’en demeure pas moins que l’existence d’empires coloniaux, même ravaudés, offrait un argument de poids aux communistes, sur les scènes nationales et internationales et leur permettait de pousser commodément leurs pions.
D’un autre côté, les Etats-Unis se trouvaient placés dans une situation délicate : au nom de la lutte contre le communisme, il fallait soutenir les pays européens, y compris militairement : la France n’aurait pas pu s’engager dans la guerre d’Indochine sans un fort soutien américain. Mais ce soutien ne valait pas blanc-seing, car les Américains — dont d’aucuns rappelaient qu’ils tenaient leur propre liberté d’une révolte anticoloniale — n’étaient pas excessivement enthousiastes à l’égard de la colonisation, même si eux-mêmes contrôlaient des territoires ultramarins. Les Etats-Unis étaient favorables aux indépendances, pour peu, naturellement, qu’elles ne conduisent pas à des régimes pro-soviétiques. La France, la Grande-Bretagne et la Belgique se trouvaient régulièrement en difficulté dans les enceintes internationales, isolées face aux communistes et à des alliés américains dubitatifs. Le coût politique de l’empire était de plus en plus pesant. Cela était également vrai pour le Portugal, pays pauvre, qui n’avait toutefois pas à gérer la contradiction entre les principes démocratiques en métropole et la férule coloniale. L’Estado Novo de Salazar liait sa survie à l’empire sur lequel il était arc-bouté. Les guerres d’indépendance des colonies portugaises entrainèrent donc la chute de la dictature.
En quatrième lieu, les mutations économiques ne plaidaient sans doute pas en faveur du maintien en l’état des structures coloniales. Il convient de garder à l’esprit l’essor des relations commerciales entre pays européens et avec les États-Unis, ceci avec l’appui décisif du Plan Marshall, ainsi que la mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1952, laquelle jeta les bases de la Communauté économique européenne cinq ans plus tard. La part des échanges avec le monde colonial, et donc les secteurs dépendants des marchés coloniaux, s’en trouva minorée, pendant que les courants « modernistes » du capitalisme européen avaient le vent en poupe et gagnaient en influence politique. Aux yeux de ses représentants, les empires étaient une butte-témoin d’une grandeur obsolète à laquelle il fallait substituer de nouvelles perspectives politiques et économiques.
Il faut aussi ajouter, dans le monde colonial, le poids accumulé de capital public garantissant les investissements privés (travaux publics, administrations) : dans cette perspective, la décolonisation pouvait paraître comme une bonne affaire pour les finances des États. Ce n’est pas que ces derniers eurent jamais à investir beaucoup pour des Empires finalement « bon marché », pour reprendre l’expression de l’économiste Denis Cogneau. Tout de même, la perspective d’une extension de l’État-providence aux outremers s’avérait coûteuse.
La décolonisation de l’Afrique était inéluctable. Pour autant, sa forme historique était contingente : vitesse d’exécution, cours des événements, sinuosités des trajectoires individuelles... D’autres histoires étaient possibles. Mais aujourd’hui, il faut bien faire avec ce que l’on a, avec ce dont nous avons hérité. L’avenir des relations entre l’Europe, singulièrement la France, et le continent africain, dépend en partie de la manière dont nous construirons le récit des mille fils entremêlés de leur histoire commune. Ce travail est difficile, il réclame du courage politique pour regarder les fantômes dans les yeux. Car nulle part la décolonisation n’a été un chemin de roses. On dit parfois que la Grande-Bretagne a su mieux s’y prendre que la France. Or, il s’agit d’une légende : en Afrique australe, les Britanniques nouèrent des liens solides avec les régimes d’apartheid ; au Kenya, la répression contre la guérilla Mau-Mau au Kenya fut sanglante. Du côté portugais, le régime Salazar mobilisa les conscrits et se lança dans une guerre à outrance en Guinée-Bissau, en Angola et au Mozambique. Au Congo, les autorités belges encouragèrent la sécession du Katanga pour protéger leurs intérêts miniers, ce qui plongea le pays nouvellement indépendant dans une crise politique majeure.
En outre, ce récit n’ira pas sans la création de « coalitions d’acteurs », pour reprendre un souhait d’Achille Mbembe, formulé lors du sommet Afrique-France en 2021, lequel a jeté des ponts encourageants, pour peu que les efforts soient poursuivis parce qu’ils n’ont sens que dans le temps long de l’histoire. La restitution des biens culturels va dans le même sens et doit être amplifiée. Parmi ces acteurs, il y a les puissances publiques bien entendu. Du chemin reste à faire, à l’heure de l’agonie de la Françafrique ! Il y a aussi les historiennes et historiens, en premier lieu africains, qui publient des travaux remarquables : pour les faire connaître, les médiations pédagogiques, muséales, artistiques, sont nécessaires. Il y a enfin les sociétés civiles, vibrantes d’espoirs et de projets comme en témoigne le nombre considérable d’associations, mouvements en tout genre, qui ont éclos ces vingt dernières années et qui ont rejeté les vieux appareils politiques discrédités.
Cependant, faute de débouchés politiques, c’est aujourd’hui le « néo-souverainisme » qui a le vent en poupe en Afrique, que des politiques, voire des militaires putschistes, ont su promouvoir pour fédérer une partie de la jeunesse locale et diasporique. Ces nouveaux dirigeants mettent volontiers en scène un pouvoir viril, à tonalités homophobes, qui dénonce les « valeurs immorales de l’Occident ». Ils s’appuient sur le ressentiment de la jeunesse africaine à l’égard des anciennes puissances coloniales, et le cultivent pour légitimer leur pouvoir. Aux yeux de cette jeunesse, les puissances coloniales sont dans le même sac que les anciens régimes locaux alliés à elles et monopolisés par des élites prédatrices bloquant toute perspective positive pour elle. L’anti-occidentalisme à tonalité vaguement panafricaine est l’une des caractéristiques fondamentales de ce néo-souverainisme. Les optimistes y verront un moment nécessaire du processus d’émancipation politique, une sorte d’essentialisme qui s’effacera à moyen terme. Mais le moment est surtout propice pour des puissances qui guettaient l’opportunité de s’installer, ou se réinstaller, sur le continent, et d’y conforter leurs intérêts. Les Russes fournissent obligeamment de l’aide militaire et sécuritaire aux juntes ouest-africaines, tandis que les Chinois nouent de fructueux contrats d’exploitation minière pour alimenter leur industrie en uranium, lithium et autres précieux minerais. Bien entendu, ils n’ont cure des aspirations des populations locales — c’est pourquoi leur prééminence ne durera pas. Quant aux Occidentaux, ils font le dos rond en attendant des jours meilleurs.
Les décolonisations africaines ont-elles, finalement, débouché sur un échec politique ? La question doit être posée, au vu des évolutions politiques et économiques des nouveaux États. Admettons tout d’abord que les leaders de la décolonisation n’ont, le plus souvent, pas fait de bons chefs d’État. Un Mugabe au Zimbabwe, était, avant l’indépendance, lion et renard : audacieux, charismatique, charmeur, pragmatique. Chef de l’Etat, il se transforma en un dictateur paranoïaque qui ruina son pays. Un Houphoüet-Boigny devint un président autoritaire et mégalomane accroché au pouvoir en dépit de son âge et de sa santé. Excellent orateur, fin politique avant l’indépendance de la Guinée, Sékou Touré s’enferma dans une paranoïa destructrice et engagea son pays dans une dérive totalitaire. Les fonctions d’homme d’État réclament des qualités que n’ont pas, ou rarement, les combattants de l’indépendance, et inversement. Il faut considérer le poids psychique d’années de lutte, parfois de prison, sur des hommes qui, quand les portes du pouvoir s’ouvrent enfin, se sont construits exclusivement en tant que combattants, et pas en tant que bâtisseurs d’États. Pour le dire autrement en reprenant les concepts de la domination légitime selon Max Weber, les qualités nécessaires à la « domination charismatique » ne s’accompagnent pas forcément de celles qu’il faut pour l’exercice de la « domination légale ». Rare sont ceux (Senghor dans une certaine mesure, et surtout la figure exceptionnelle de Mandela) qui échappent à cette fatalité.
Il faut aussi considérer le legs colonial et ses prolongements postcoloniaux : L’Afrique a été, et est toujours, gigantesque pourvoyeuse de matières premières non transformées et de main d’œuvre essentielles à l’économie mondiale, mais les Africains n’en ont retiré que de maigres fruits. S’ajoutent à cela des facteurs géographiques et climatiques : sols peu fertiles, climats peu favorables. La production de valeur ajoutée par des chaînes de valeur significatives, l’invention de modèles de développement durable, la transition démographique : je suis persuadé que les Africains relèveront ces défis, et ils le font déjà au vu des taux de croissance de certains pays, mais le poids de l’histoire est là.
Les convulsions politiques de l’Afrique démontrent une chose très simple : un système de domination (la colonisation et ses divers prolongements post-coloniaux) ne peut pas devenir en quelques années une relation égalitaire. Cette transformation majeure réclame le passage du temps, des efforts soutenus, des archives complètement ouvertes, et des échanges assidus pour éviter la solidification de récits de ressentiment, purement antagonistes et communautaires. Bien entendu, il serait vain et stérile de viser un seul récit unificateur. Les mémoires, les situations culturelles et politiques ne sont pas identiques, et la diversité des récits est une bonne chose. Mais ces récits ont chacun à viser l’universel et la vérité des faits ; ils ont à tisser mille fils de dialogue entre eux. Puisse cet ouvrage y contribuer.
Pap Ndiaye
SOMMAIRE
Préface de Pap Ndiaye Décolonisations africaines - Pierre Haski p.5
Chapitre 1 : Éthiopie, Haïlé Sélassié p.13
Chapitre 2 : Tunisie, Habib Nourguiba p.37
Chapitre 3 : Ghana, Kwame Nkrumah p.67 02 03
Chapitre 4 : Guinée, Ahmed Sékou Touré p.93
Chapitre 5 : Cameroun, Ahmadou Ahidjo p.117
Chapitre 6 : Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny p.147
Chapitre 7 : Congo, Patrice Lumumba p.177
Chapitre 8 : Sénégal, Léopold Sédar Senghor p.207
Chapitre 9 : Mali, Modibo Keïta p.239
Chapitre 10 : Togo, Sylvanus Olympio p.265
Chapitre 11 : Kenya, Jomo Kenyatta p.293
Chapitre 12 : Zimbabwe, Robert Mugabe p.321
Chapitre 13 : Afrique du Sud, Nelson Mandela p.353
Conclusion par Pierre Haski p.358
