Après l’Abolition, Les fantômes noirs de l’esclavage
par Kris Manjapra
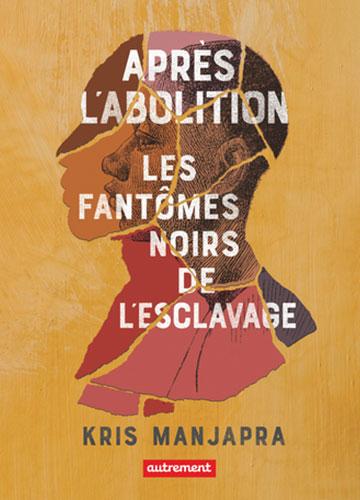
Kris Manjapra est né dans les Caraïbes, d’une famille mixte africaine et indienne, et a grandi au Canada. Diplômé de Harvard, il est spécialiste du postcolonialisme et enseigne désormais l’histoire à l’université Tufts (États-Unis). Après l’abolition, les fantômes noirs de l’esclavage (autrement, 2022) est son premier ouvrage traduit en français par Gabriel Boniecki. Cette édition est réalisée avec le concours de Romuald Fonkoua, professeur de littératures francophones à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université où il dirige le Centre international d’études francophones. Kris Manjapra, au travers de cet essai, propose une analyse critique et historique des politiques de libération des esclaves africains qui, selon lui, les laissèrent dépossédés, voire, comme en Haïti, acculés par le poids de la dette. Le groupe de recherche Achac propose de découvrir des extraits du chapitre introductif.
Avant de quitter Andros [île des Bahamas], un ami m’emmena voir un trou bleu. Ces colonnes d’eau s’enfoncent profondément dans le socle calcaire de l’île. Un réseau de grottes sous-marines relie même certaines d’entre elles à l’océan. Devant ce trou bleu, je fus frappé par la densité sombre de cette eau immobile, dont la surface formait un miroir parfait où se reflétaient les pins environnants et le bleu intense du ciel. On aurait dit une porte, un passage vers le monde sous-marin, vers l’inconnu. Au bord de cette énigme géologique, je me rendis compte que scruter ce bleu sans fond n’était pas si différent que sonder les vides de mon histoire familiale. Lorsqu’on se confronte aux histoires nées du traumatisme de l’esclavage, le vide, la négation signalent à la fois une absence et une sorte de présence, obscure, immergée, qui attend d’être connue. En marchant autour de cette étendue d’eau, je me sentis happé par quelque chose, appelé à traverser vers un ailleurs, à me mettre à l’unisson d’une présence invisible mais bien réelle. Une analogie me frappa alors : cette situation était semblable à notre rapport à l’histoire en général, remplie d’inconnues de toutes sortes, d’expériences sans témoignages qui nous appellent depuis le vide[1].
La ligne fantôme
En 1900, le philosophe panafricaniste W.E.B. Du Bois suggéra que « le problème du XXe siècle, c’est celui de la ligne de couleur[2] ». Aujourd’hui, le combat pour les droits de l’homme et pour les droits civiques converge avec les luttes contre les discriminations de genre et celles pour protéger l’environnement : ces sujets demeurent des questions vitales. Mais je crois qu’au XXIe siècle, si le problème de la discrimination raciale reste d’actualité, il s’y ajoute celui de la ligne fantôme. Cette ligne sépare l’histoire de l’Homme de celle de ses vides. Les sociétés tirent un voile entre le royaume des choses visibles, reconnues, et celles qui sont effacées et désavouées de manière systémique. Si la barrière raciale divise pour opprimer et déposséder, la ligne fantôme crée une frontière existentielle entre l’être et le néant ; entre ceux dont on dit qu’ils sont présents, et ceux qu’on désigne comme les absents-présents de la société[3].
Le fait de traiter quelqu’un en fantôme (to ghost en anglais) revient à l’ignorer, à voir à travers, à faire comme s’il n’existait pas. Faire basculer l’histoire d’un peuple de l’autre côté de la ligne fantôme revient à ignorer de façon systématique le sens de son expérience collective, génération après génération, siècle après siècle[4]. Cette forme d’invisibilisation est à distinguer des phénomènes de colorlining (discrimination liée à la couleur de peau) et de redlining (discrimination qui consiste à refuser des prêts ou des assurances à des minorités visibles) : il s’agit d’une stratégie adoptée par des sociétés entières pour détourner le regard des groupes extorqués, pour étouffer l’histoire de leur lutte et leurs demandes de réparation[5].
Les fantômes de nos sociétés sont les laissés-pour-compte, les réprouvés, ces présences liées à une histoire ignorée des autres. Les traumatismes et le déni social sécrètent activement une « matière fantôme[6] ». Du fait de l’esclavage et du colonialisme, certains groupes humains ont été transformés en « fantômes dans le regard des autres[7] ». Comme Ralph Ellison en faisait le diagnostic dans Homme invisible [roman publié par l’écrivain noir Ralph Ellison, Homme invisible. Pourquoi chantes-tu ? en 1952, Grasset] les personnes fantômisées en viennent à incarner le « Négatif », la « chose amorphe ». On leur assène : « vous n’existez pas », votre histoire n’est pas assez substantielle pour qu’on s’en souvienne, pour mériter pleinement le nom d’histoire humaine[8]. Cette fantômisation est un piège en soi, qui affecte jusqu’à la vie quotidienne, l’accès à la nourriture, au logement, à l’éducation, aux protections civiques et au vote. La fracture politique entre ceux dont on se souvient et les réprouvés est délétère pour tout le monde : les victimes, les responsables et les bénéficiaires.
Une histoire comparée des abolitions
De façon naturelle, ce sont les discours abolitionnistes qui ont attiré l’attention des historiens – c’est-à-dire la fin de l’histoire. Des écoles historiques éminemment respectées, notamment celles associées à Seymour Drescher, ont mis en lumière les efforts des abolitionnistes blancs et des campagnes qu’ils menèrent dans l’espace atlantique. D’après cet historien, l’engagement en faveur de l’abolition qui se dessine en Europe et en Amérique entre la fin des années 1700 et le début des années 1900 représente une « réussite mondiale », qui constitue le soubassement de notre conception des droits de l’homme[9]. Cette vision des choses passe toutefois sous silence la façon dont ces idées antiesclavagistes furent mises en œuvre au sein de sociétés blanches, façon qui prolongea la captivité et l’oppression dont étaient victimes les Noirs du monde entier. (…)
Des politiques et des lois regroupées sous le nom d’« émancipation » ont concrétisé les idéaux abolitionnistes. (…) En effet, sous des formes nouvelles, les émancipations ont réactivé et maintenu le système de castes raciales né de l’esclavage : aujourd’hui encore, c’est lui qui structure l’inégalité des chances dans nos sociétés.
Ainsi, en se préoccupant surtout de la question de l’abolition – et donc de la fin de l’esclavage, les historiens ne racontent que la moitié de l’histoire. On nous dit que la blessure est refermée, que les victoires de l’abolitionnisme perdurent encore, oubliant au passage la réalité continue de l’oppression raciale. Dans la perspective d’une politique de réparations, il faut revenir sur cette période, sur les suites juridiques et procédurales de cette « émancipation », et sur les révoltes des communautés noires pour se libérer elles-mêmes. Il ne peut y avoir de véritable justice réparatoire sans un nouveau récit du passé attentif aux voix absentes des archives ; il faut réécrire une histoire qui compte pour elles comme pour nous.
Le chemin emprunté par les émancipations n’a pas conduit à la justice, qui était pourtant leur but affiché. (…) [Elles] furent façonnées selon des principes fondés sur la propriété, les sources de la valeur économique, les liens entre démocratie et citoyenneté, et une hiérarchie supposée entre les civilisations.
Le terme émancipation vient du latin emancipatio, qui signifie « libéré de la main ». Dans l’étymologie même du mot et dans l’antique droit romain, on trouve la légitimation de l’autorité d’une personne pour commercer ou vendre les droits de propriété (mancipatio) sur une autre[10]. Sous la loi romaine, l’emancipatio fait référence à l’acte par lequel le paterfamilias (le chef masculin du foyer et propriétaire) choisissait volontairement de renoncer à son pouvoir (potestas) sur d’autres êtres humains dans son foyer, y compris ses enfants et esclaves. Ainsi l’émancipation était-elle légalement interprétée comme le don volontaire d’un propriétaire, et non comme le droit légitime du captif.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, à travers l’Europe et dans les Amériques, cette procédure de l’antique droit romain fut réinventée : elle devint un instrument politique et légal qui permit de rendre hommage aux esclavagistes, de leur conférer une dignité tout en niant l’humanité des victimes. Dans les sociétés esclavagistes, les émancipations n’ont donc jamais été assorties de mea culpa envers les esclavisés. Alors même que l’institution de l’esclavage était abolie, les droits des esclavagistes et plus largement la structure de domination raciale furent préservés. Les émancipations permirent aux propriétaires d’esclaves et à leurs bénéficiaires d’obtenir des compensations et des gratifications, tout en les absolvant de leur responsabilité. Les gouvernements donnèrent aux responsables de ces crimes le pouvoir de modeler eux-mêmes le monde d’après. (…)
En Europe, aux Amériques et dans quelques colonies de plantation de l’océan Indien comme l’île Maurice et La Réunion, les gouvernements ont octroyé à l’élite des planteurs et investisseurs des systèmes de dédommagement intergénérationnels. Cent ans après la révolution haïtienne, les Français propriétaires d’esclaves expulsés d’Haïti ont reçu le soutien du gouvernement français. Aux États-Unis, de l’époque des premières émancipations dans les années 1780 jusqu’à l’aube des lois Jim Crow* dans les années 1880 et au-delà, les propriétaires d’esclaves et leurs descendants dévoyèrent les lois, le vote et les droits civiques, tout en étendant le système carcéral. Pendant 180 ans, jusqu’en 2015, les propriétaires d’esclaves britanniques et leurs héritiers reçurent de lucratives réparations financées par les contribuables. Ailleurs, les peuples émancipés des Caraïbes furent privés d’éducation, d’accès aux soins, à la propriété foncière, au droit de subsistance, au vote, et aux conditions nécessaires à la création d’économies indé- pendantes. Enfin, après 1875, les États européens confisquèrent les terres et abolirent la souveraineté des États africains, utilisant l’émancipation comme alibi pour imposer un système de domination impérialiste et de sous-développement dont les conséquences sont encore perceptibles aujourd’hui.
*Les lois « Jim Crow » désignent aux États-Unis les lois de ségrégation raciale mises en place dans les anciens États esclavagistes du Sud après la fin de la guerre de Sécession et l’abolition officielle
Au XIXe siècle, les abolitionnistes continuèrent à utiliser des expressions comme « cargaison » ou « contrebande », qui réduisaient les Noirs à une simple marchandise. Les États européens ou américains ne considéraient pas les personnes émancipées comme des « citoyens », mais comme des personnes « libérées ». Dans de nombreuses régions des Amériques, les descendants de ces personnes « libérées » ne furent d’ailleurs pas affranchis avant la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui encore, elles sont les cibles de lois, de politiques et de normes sociales discriminantes. En développant de nouvelles institutions comme l’esclavage pour dette, le métayage et les contrats de travail forcé, l’ordre établi força des générations de Noirs à payer leurs oppresseurs longtemps après la date « finale » de leur émancipation. De bout en bout, ce sont les propriétaires d’esclaves qui ont maîtrisé le processus et influencé le jeu politique.
(…)
Face à ces abolitions venues d’en haut, les communautés noires pratiquèrent l’auto-émancipation, la révolte et de nombreuses formes de libération, grandes ou petites. Les Noirs demandèrent la liberté sans se satisfaire des limitations, des décisions et des calendriers imposés par leurs émancipateurs[11]. Ils insistèrent sur leur droit à l’autodétermination, l’accès à la propriété du sol et à ses ressources, la liberté de vivre dans des communautés sûres et heureuses, enracinées dans des traditions nouvelles ou anciennes. En se libérant eux- mêmes, les Africains demandèrent à tisser des relations pacifiques et égalitaires avec les autres peuples. Et dès les prémices de l’abolitionnisme, les Noirs ne cessèrent d’insister sur la nécessité de réparations légitimes en regard des injustices de l’esclavage et de l’émancipation.
Les Noirs, bien conscients de la nature de ce pillage historique – « l’histoire qui blesse » – refusèrent le néant auquel on les assignait[12].
Le fin mot de l’histoire est donc loin d’être écrit. Les « fantômes » symbolisent l’inachevé. Ils désarçonnent, effraient, et nous hantent. Et qui contredirait l’idée que notre XXIe siècle est hanté par un passé qui continue de s’accumuler ? Les fantômes des esclaves sèment le trouble dans nos sociétés, nos consciences, nos mémoires, et jusque dans nos désordres sociaux. Ils nous dérangent et nous réclament justice. Ils nous hantent et nous invitent à recréer des relations apaisées à l’intérieur de sociétés toujours marquées par les conséquences de ce traumatisme historique. Les fantômes de notre histoire exigent une action réparatoire – des pratiques diverses pour faire entendre la vérité, présenter des excuses, réparer les torts et obtenir des compensations – de la part des descendants des coupables et des spectateurs, mais aussi de la part des pouvoirs en place, construits sur le terreau de l’esclavage. C’est par une action réparatoire, fondée sur une volonté de justice et de paix et non sur une volonté de puissance, que nous pouvons nous entraider à devenir plus humain ou, du moins, à dépasser cette humanité-là. C’est l’histoire à venir, au-delà de la ligne d’horizon : il faut que quelque chose finisse pour que quelque chose de nouveau commence[13].
Notes
[1] DUNHAM, Katherine, Island Possessed, University of Chicago Press, Chicago, 1969, p.127, relate sa rencontre avec des inconnus de toutes sortes lors de sa participation à une cérémonie vaudou ; CARUTH, Cathy, Unclaimed Expérience : Trauma, Narrative, and History, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996, pp.11-25.
[2] W.E.B DU BOIS, The Souls of Black Folk, W. W. Norton, New York, 1999 (1re éd. 1903), p.17.
[3] TROUILLOT, Michel-Rolph, Haiti: State against Nation, Beacon Press, Boston, 1900, p.141; Fred MOTEN, Stolen Life, Duke University Press, 2018, p.242.
[4] MIRZOEFF, Nicholas, The Right to Look: A Counterhistory of Visuality, Duke University Press, Durham, 2011; Christopher BOLLAS, Forces of Destiny: Psychoanalysis and Human Idiom, Routledge, 2018, p.87.
[5] MORRISON, Tony, Playing in the Dark, Vintage, New York, 2007, p. 5 – 7; Hilary Beckles utilise l’expression justice réparatoire in BECKLES, Hilary McD, Britain’s Black Debt: Reparations for Caribbean Slavery and Native Genocide, University of the West Indies, Kingston, 2013, p.13.
[6] GORDON, Avery, Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination, University of Minnesota Press, 2008, p.8.
[7] ELLISON, Ralph, Invisible Man, Vintage International, New York, 1995, (1re édition 1952), p.94
[8] Ibid., p.94
[9] « L’antiesclavagisme » a mis fin ou a considérablement limité une institution qui avait détruit et abrégé la vie de dizaines de millions d’êtres humains dans les deux hémisphères » in DRESCHER, Seymour, Abolition : A History of Slavery and Antislavery, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p.459. Des travaux récents réécrivent l’histoire de l’abolition et de l’antiesclavagisme en mettant l’accent sur le rôle joué par les Noirs, voir par exemple : BROWN, Christopher Leslie, Moral Capital : Foundations of Bristish Abolitionism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2006.
[10] William SMITH, William WAYTE, and G.E. MARINDIN, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, Londres, 1890, p.276.
[11] MCKITTRICK, Katherine, Demonic Grounds: Black Women and the Cartographies of Struggle, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.
[12] On doit cette expression à HARTMAN, Saidiya V., Scenes of Subjection: Terror, Slavery and Self-Making in Nineteenth-Century America, Oxford University Press, New York, 1997, p.51.
[13] SHARP, Christina, In the Wake: On Blackness and Being, Duke University Press, Durham, 2016, p. 130-34.
SOMMAIRE
- Introduction. L’émancipation et le vide
- I. Le fardeau de l’abolition dans les Etats nord-américains
- II. Punir la nation haïtienne
- III. Au Royaume-Uni : abolition et indemnisation des propriétaires
- IV. Dans les Caraïbes, criminels récompensés, victimes abandonnées
- V. De la guerre de Sécession à la guerre dévoyée contre la vie des Noirs
- VI. L’émancipation africaine : une politique antinoire mondiale
- Conclusion. Réparations : le combat continue
