Aux origines du racisme moderne 1789-1791
par Florence Gauthier
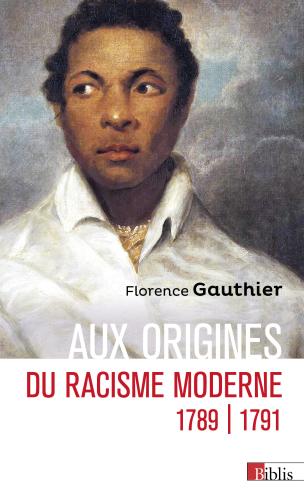
Spécialiste de la Révolution française, de la Révolution de Saint-Domingue et Haïti et du droit naturel à l’époque moderne, l’historienne et maître de conférences à l'Université Paris Diderot - Paris VII Florence Gauthier s’intéresse à l’histoire du préjugé de couleur, souvent confondu à tort avec celle, plus tardive, de l’invention du « racisme biologique ». Dans Aux origines du racisme moderne 1789-1791 (CNRS Éditions, avril 2024), l’auteure s’intéresse aux colonies esclavagistes françaises d’Amérique, et notamment à l’île de Saint Domingue au XVIIIe siècle, période où les hommes étaient désignés selon leur couleur de peau – « Blancs », « Noirs », « Métis », « libres de couleur » – ce qui déterminait alors leur statut juridique. Par l’étude de sources inédites et les cas de deux protagonistes aux idées opposées, Julien Raimond et Moreau de Saint Méry, elle pose une question essentielle : « Le préjugé de couleur est-il une conséquence de cet ordre juridique esclavagiste ou bien l’esclavage n’a-t-il été qu’un prétexte à son apparition ? » En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, l’auteure livre l’introduction de son ouvrage et pose des fondements de sa recherche.
La naissance et la diffusion du préjugé de couleur, constitutif d’une « aristocratie de l’épiderme » apparue dans les colonies esclavagistes françaises d’Amérique au XVIIIe siècle, n’ont guère retenu l’attention des historiens, à l’exception du beau travail d’Yvan Debbasch[1]. « Blancs », « Noirs », « Métis », « libres de couleur » : dans les Antilles françaises, à la veille de la Révolution, les hommes étaient désignés en fonction de leur couleur de peau, qui définissait leur statut juridique. L’apparition de cet ordre inégalitaire précède, historiquement, l’invention du « racisme biologique », avec lequel il se trouve trop souvent confondu. Péché d’anachronisme : à force d’amalgamer les deux phénomènes, l’histoire du préjugé de couleur a été négligée au profit d’une approche peu nuancée des débats sur l’esclavage dans la France des Lumières. Préjugé de couleur et « racisme biologique » relèvent pourtant de deux registres différents. Le premier se greffe sur un enjeu éthique et politique, qu’il convient d’analyser à la lumière des arguments échangés entre adversaires et partisans de l’ordre juridique esclavagiste. Le second emprunte aux théories essentialistes à prétention « scientifique ». Distinction qu’il faut garder présente à l’esprit pour entreprendre l’histoire des grands affrontements idéologiques consécutifs à la remise en cause de l’ordre ségrégationniste dans les colonies françaises d’Amérique, histoire que la présente étude se propose de retracer.
La résistance des victimes du préjugé de couleur, opposées au « parti ségrégationniste », a connu différentes phases : elle évolua de la fuite pure et simple de la colonie à une prise de conscience éclairée qui permit l’action philosophique et politique pour introduire, dès les débuts de la Révolution française, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur le continent américain. Aux avant-postes de ce combat se détache la figure de Julien Raimond (1744‑1801), métis originaire de St-Domingue et animateur, à partir de 1789, de la Société des Citoyens de Couleur. Auteur de nombreux écrits, Raimond lutta sans relâche pour faire reconnaître « l’égalité de l’épiderme » dans les colonies. Son principal adversaire fut l’avocat Médéric Moreau de Saint-Méry (1750‑1819), député de la Martinique et porte-parole des colons à l’Assemblée nationale. Mais avant de retracer plus en détail leurs carrières respectives, un détour s’impose par les colonies esclavagistes françaises d’Amérique et en particulier par l’île de St-Domingue, épicentre de cette histoire.
Le choc de la « destruction des Indes » et la naissance du premier droit de l’humanité
La « découverte de l’Amérique » fut marquée, dès le début, par tant de violences et de massacres que l’un de ses premiers témoins, Bartolomé de Las Casas (1474‑1566), la nomma « destruction des Indes »[2]. Rappelons que ce nouveau continent était désigné par l’expression Indes occidentales : Christophe Colomb pensait rejoindre les Indes en naviguant par l’Ouest. Las Casas était le fils d’un compagnon de Colomb, qui en fit un jeune colon privilégié. Il reçut, au nom du Roi d’Espagne, une « encomienda », c’est-à-dire une terre avec la population autochtone qui y vivait et se retrouvait contrainte de travailler pour ce nouveau maître. D’abord indifférent aux souffrances endurées par les indigènes, il prit progressivement conscience des horreurs de l’esclavage. Devenu moine dominicain, il renonça à sa situation de maître, abandonna son « encomienda » et consacra sa vie à dénoncer ce qui, désormais, lui apparaissait comme des crimes contre les droits de l’humanité.
Las Casas ne fut pas le seul à dénoncer l’esclavage. Un grand courant de pensée humaniste naquit dans l’Amérique conquise et, en Espagne même, dans les universités, en particulier à Salamanque. Condamnant sans ambages le système esclavagiste, l’École de Salamanque repensa les droits de l’humanité et les principes, qui devaient conduire les individus, les sociétés, les gouvernements.
La découverte par les conquistadors d’une humanité jusqu’alors inconnue avait ouvert un vaste débat intellectuel et provoqué des luttes acharnées visant à redéfinir l’humanité : était-elle divisée en « fidèles » et en « infidèles », comme l’affirmaient les Églises ? En maîtres et en esclaves, comme le pratiquaient les colons ? Ou était-elle formée d’individus libres et égaux en droits ?
L’humanité est une, affirmaient Las Casas et l’École de Salamanque : aucun humain ne « naît esclave », mais au contraire a droit à sa liberté qui doit être reconnue et protégée. Cette idée devint le principe fondamental de la philosophie humaniste du droit naturel moderne : l’humanité une se définit, a priori, par la naissance libre ; elle a des droits, qualifiés de droits naturels, qui renvoient à la nature propre à l’humanité et priment toutes les autres formes de droit.
Pourquoi l’École de Salamanque eut-elle recours à la notion de « droit naturel », qui occupe une place centrale dans sa théorie du droit humain ? À cette époque, trois conceptions du droit se présentaient : le droit divin, celui de la théologie ; le droit politique, droit des institutions, que l’on appelait aussi droit positif ; et le droit naturel. Ce dernier offrait l’immense avantage d’un espace de réflexion ouvert, indépendant du droit divin – et par commodité, je le qualifie de laïc avant le terme – qui permettait d’élaborer des idées neuves. En effet, le pape et les rois ou, si l’on préfère, le droit divin et le droit humain, révélaient dans la pratique leur double incapacité à protéger l’humanité une, née libre, ayant des droits. C’est la raison pour laquelle ces droits devaient être conçus indépendamment des droits divin et humain, qui révélaient leurs limites.
Quel était cet arbitre supérieur au droit divin et au droit humain ? L’idée de justice, mais une justice définie par le droit naturel conforme à la définition nouvelle de l’humanité une, née libre et ayant des droits. Cet énoncé s’appuie sur un sentiment commun à tous les humains : droit à une vie libre, et sur une prise de conscience née du refus des crimes commis dans le Nouveau Monde par les conquistadors. Il repose sur une conception réciproque du droit : tout humain naît libre de droit et doit respecter ce même droit chez tous ses semblables. Droit réciproque, universel ou égal : ces trois termes, qui signifient ici la même chose, disent à l’unisson que l’humanité est une.
La référence au droit naturel traduit le passage de l’éthique à la politique, ou plus précisément à la cosmopolitique du droit naturel moderne. Le principe éthique qui énonçait que l’humanité naît libre, devait se traduire en droit réciproque mis en pratique, pour devenir : l’humanité naît libre et doit le demeurer. La philosophie du droit naturel moderne construisait une « politique et une cosmopolitique » : c’était à la philosophie du droit naturel humain d’éclairer les principes auxquels les pouvoirs législatif et exécutif devaient se conformer.
Dénonçant les violences commises sur les peuples du Nouveau Monde, l’École de Salamanque entreprit de justifier les droits des autochtones à leur souveraineté et analysa en détail l’illégitimité des conquêtes. Las Casas et l’École de Salamanque énonçaient le premier droit de l’humanité entière, comme expression de la conscience critique de la barbarie européenne et comme affirmation de l’urgence d’arrêter et de réparer les crimes qui se commettaient dans le Nouveau Monde. Un effort considérable venait d’être accompli par le droit humain, marquant un pas en avant vers une conception pratique de la liberté de l’humanité.
Ainsi, ce droit naturel de naître libre et de le demeurer était une idée neuve, expression du choc de la « destruction des Indes ». Il définissait pour la première fois l’humanité, non plus localement ou partiellement, mais en termes de droit cosmopolitique et posait le problème de l’avenir de la façon suivante : droit de l’humanité née libre ou barbarie[3].
Contrairement à une idée reçue, cette théorie n’est pas née en Europe seule, mais des deux côtés de l’Atlantique. Elle n’était pas destinée aux seuls Européens, puisque son objectif immédiat était d’arrêter les crimes commis contre l’humanité dans le Nouveau Monde. Cette philosophie humaniste n’était pas davantage un produit de la domination impériale des Européens sur le monde : elle prétendait guider les relations entre les peuples en s’appuyant sur des principes cosmopolitiques contre la conquête coloniale. Toutefois, ces humanistes du XVIe siècle furent, on le sait, combattus et vaincus sur les plans éthique et politique. Les colons du Nouveau Monde, poursuivirent la « destruction des Indes » et contournèrent les freins mis à l’asservissement des autochtones par différents moyens, dont celui de la déportation de captifs africains, mis en esclavage sur leurs plantations. Ce système, existait dans l’Empire musulman qui, depuis le VIIIe siècle, razziait l’Afrique noire par le commerce de captifs, et fut étendu au Nouveau Monde lorsque les colons comprirent que les autochtones préféraient fuir ou mourir plutôt que d’être esclaves, et se fournirent en esclaves africains[4] dès le début du XVIe siècle.
Ainsi, les droits humains que Las Casas et ses amis avaient tenté de semer dans le Nouveau Monde tombèrent dans l’oubli.
Les colonies esclavagistes françaises d’Amérique
La monarchie française s’intéressa tardivement aux colonies d’Amérique. Elle favorisa dans un premier temps l’occupation de la Guadeloupe et de la Martinique, à partir de 1635. Dans la colonie de St-Domingue, la population autochtone avait « disparu » dès le XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, les colons espagnols quittèrent leurs établissements après avoir épuisé les terres et, en 1697, le roi d’Espagne céda au roi de France la partie occidentale de l’île de St-Domingue par le traité de Ryswick.
La plantation sucrière esclavagiste de St-Domingue prit un essor considérable au XVIIIe siècle, comme en témoigne l’explosion des effectifs d’esclaves africains introduits dans la colonie par la traite : 5 000 en 1697, 15 000 en 1715, 450 000 en 1789. Les libres regroupant planteurs, petits cultivateurs, petits blancs et affranchis, représentaient environ 70 000 personnes en 1789.
La colonie devint très rapidement la plus grosse productrice de sucre d’Amérique et le fleuron des possessions de la couronne de France sous le surnom flatteur de « Perle des Antilles »[5].
Jusqu’à la Révolution de St-Domingue qui conduisit à l’indépendance d’Haïti, de 1789 à 1804, la plantation sucrière assura la fortune rapide des planteurs, liés par des réseaux familiaux au grand négoce français, ainsi qu’à la noblesse de cour. En effet, le roi était possesseur des colonies et c’est en son nom que les terres étaient distribuées. Ses amis, ses proches étaient favorisés et recevaient les meilleures terres des plaines réservées à la production du sucre, dont la superficie était limitée sur cette île au relief fortement accidenté.
Dès le XVIIe siècle, de nombreux cadets de famille nobles ou roturières riches vinrent ainsi chercher fortune. Ces colons épousèrent fréquemment des femmes africaines et des métis naissaient de ces mariages légitimes.
Les esclaves formaient deux groupes distincts, selon la division du travail sur la plantation sucrière. Les captifs fraîchement débarqués d’Afrique, appelés Bossales, travaillaient aux champs et étaient les plus nombreux. Les conditions de travail y étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux Bossales, pour permettre la réalisation du processus de créolisation qui consistait à transformer des captifs, libres jusqu’à leur capture, en esclaves travailleurs, ce qui n’était pas simple. Ce processus de créolisation était à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des captifs, et un apprentissage des rapports maîtres-esclaves, du travail contraint, de la langue dite « créole » ainsi que des formes culturelles encouragées et sélectionnées par les maîtres.
L’exploitation du travail des Bossales était proprement esclavagiste : leur durée de vie était de dix à quinze ans maximum et l’esclave, épuisé, était remplacé à l’identique par un nouveau Bossale acheté au marché. Les maîtres n’avaient pas eu à investir dans la naissance, l’éducation et la formation de cette main-d’œuvre arrivée adulte et qui mourait à un rythme qui éliminait l’entretien de la vieillesse[6]. On notera que les Bossales refusaient d’avoir des enfants qui deviendraient esclaves et les femmes enceintes cherchaient à avorter ou pratiquaient l’infanticide : cette forme de résistance affirme la dignité et la liberté humaines.
L’autre groupe était formé des esclaves créoles, destinés aux travaux qualifiés : encadrement des Bossales, métiers nécessaires à l’entretien de la plantation, formation à la partie mécanisée des travaux, domesticité enfin. Ces esclaves apprenaient la langue créole, mais aussi celle du maître. C’était dans ce groupe que l’éducation, le travail personnel, l’affranchissement étaient possibles.
L’Édit de 1685, préparé par Colbert, créait un ordre juridique colonial esclavagiste. Retenons que les esclaves africains avaient un statut d’esclave étranger[7] spécifique aux colonies. L’article 57 de l’édit de 1685 précise que les esclaves sont « nés dans les pays étrangers »[8] et seul l’acte d’affranchissement leur concédait la naissance dans une terre du Roi de France.
Il existait deux groupes d’affranchis. Les « libres de savane » n’avaient pas de reconnaissance juridique et ne pouvaient donc quitter la plantation. Ils vivaient, avec l’accord du maître, soit comme cultivateurs, soit en exerçant un métier utile à la vie de la plantation, mais jouissaient d’un état de liberté relatif, car le maître pouvait à tout moment décider de les faire retourner à l’état d’esclave. Juridiquement, les « libres de savane » n’avaient aucun droit.
Par contre, les « manumis » avaient un « titre de manumission » reconnaissant leur nouveau statut juridique qui les faisait sortir de leur « naissance étrangère » pour entrer dans la catégorie sociale des « sujets libres du Roi de France ». Ceux-là pouvaient quitter leur maître et s’établir de façon indépendante.
D’abord expérimenté dans les Antilles à petite échelle, « l’élevage d’esclaves sur place » avec les esclaves créoles, se systématisera au XIXe siècle, lorsque la traite des captifs africains sera doublement freinée. En effet, tout au long du XVIIIe siècle, la fourniture de ce marché de captifs devenait de plus en plus difficile pour les Royaumes africains, qui avaient le monopole de la traite : la hausse des prix des captifs fut multipliée par trois[9] !
Par ailleurs, la Grande-Bretagne entreprit de contrôler le commerce africain en interdisant la traite des captifs, interdiction décidée en 1807. La Marine anglaise fit la police dans les océans et si la traite se poursuivait, elle était devenue illicite, ce qui contraignit les colonies esclavagistes d’Amérique à modifier le mode de reproduction de la main-d’œuvre en se tournant vers l’élevage d’esclaves sur place ou des formes d’importation nouvelles de main-d’œuvre. Est-il besoin de préciser que la suppression de la traite des captifs africains n’implique pas forcément l’abolition de l’esclavage[10] ? On retiendra qu’en 1789, de lourdes menaces pesaient sur le système de la traite des captifs africains, dont la hausse des prix inquiétait sérieusement les planteurs esclavagistes et réclamait un changement qui s’opérera au XIXe siècle, avec l’élevage d’esclaves sur place.
Comme nous allons tenter de le montrer en retraçant les itinéraires croisés de Julien Raimond et Moreau de Saint-Méry, les débats suscités en métropole par l’apparition du préjugé de couleur constituent un autre aspect de la crise du système esclavagiste dans les colonies françaises.
Portrait des protagonistes
Qui était Julien Raimond ? L’homme reste mal connu et, lorsqu’il est évoqué par les historiens, force est de constater la persistance des préjugés et de l’incompréhension dont il est l’objet. Né en 1744 à Bainet, dans la province Sud de St-Domingue, Julien était le fils d’un paysan béarnais qui avait obtenu le statut privilégié de colon et épousa une femme de couleur, la fille légitime d’un riche colon. Julien, comme ses frères et sœurs, fut envoyé faire ses études à Bordeaux et à Toulouse. Lorsque Julien rentra à St-Domingue dans les années 1760, les progrès du préjugé de couleur avaient provoqué la résistance des colons métis. Julien Raimond devint leur représentant dans la province du Sud de la colonie. En 1783, les colons métis décidèrent d’offrir un vaisseau au roi, mais leur proposition fut empêchée par le parti des colons ségrégationnistes qui commençait à se former et refusait de faire reconnaître les libres de couleur comme des colons à part entière[11].
Raimond eut la chance de rencontrer le ministre de la Marine, Castries, un réformateur, qui l’autorisa à venir à Versailles pour défendre la cause des libres de couleur. Accompagné de sa femme, Julien Raimond arriva en France en 1784 et s’installa dans la région d’Angoulême. À partir de 1785, il présenta différents mémoires au roi sur les droits revendiqués par les libres de couleur, mais en 1787, la démission du ministre Castries le priva de son principal soutien. Le nouveau ministre, La Luzerne, se rendit aux arguments des colons ségrégationnistes opposés à tout ce que son prédécesseur avait amorcé en faveur des libres de couleur et des esclaves. De 1787 à 1789, Julien Raimond continua de correspondre avec le ministre de la Marine, mais en vain[12].
Dans son étude, Luc Nemours le présente comme le chef des gens de couleur de St-Domingue. Yvan Debbasch, quant à lui, en fait un défenseur des libres de couleur. John Garrigus estime lui aussi que Raimond s’est occupé de défendre les droits de sa couleur. Enfin, Pierre Pluchon dresse un portrait doublement péjoratif de Julien Raimond qui aurait été l’un des chefs mulâtres libres mais aussi, avec son gendre Pascal, un affairiste à la conduite trouble[13]. Julien Raimond, chef des gens de couleur en 1951, est devenu un mulâtre libre et un affairiste trouble en 1995 : un portrait a ainsi été construit, en répétant ce qui a pu être écrit ici ou là et qui s’est transformé en une interprétation reposant sur le préjugé de couleur. Mais s’est-on seulement demandé si Julien Raimond ne défendait que sa couleur et aurait donc été un adepte du préjugé de couleur, comme ces interprétations l’induisent ?
Tout comme J. Raimond, Médéric Moreau de Saint-Méry n’a guère retenu l’intérêt des historiens, en dépit de ses nombreux écrits sur les colonies esclavagistes. Né à la Martinique en 1750, ce parent de Joséphine de Beauharnais, avocat et propriétaire, épousa l’une des trois filles de Mme Milhet, veuve d’un riche négociant de Louisiane, devenu planteur à St-Domingue. Venu en France, il fut recommandé par Le Mercier de la Rivière, ancien intendant de la Martinique, puis conseiller du ministre de la Marine. Il publia un nouveau code de lois pour la colonie de St-Domingue[14] et fut gratifié d’un poste au Conseil supérieur du Cap où il revint en 1786. Entre temps, en 1784 au Cap, ses beaux-frères, Arthaud et Baudry de Lozières, créèrent le Cercle des Philadelphes et chargèrent Moreau de le mettre en contact avec les loges maçonniques qu’il fréquentait en Europe.
Lors de la convocation des États généraux, il retourna à Paris et participa activement aux réunions des colons de St-Domingue. Il fut l’un des fondateurs de la Société correspondante des colons français, dit club Massiac, au mois d’août 1789, puis fut nommé en octobre de la même année député de la population blanche de la Martinique à l’Assemblée constituante.
Pierre Pluchon écrit à son sujet dans son index biographique déjà cité : « Homme actif, consciencieux et vaniteux, Moreau qui est un homme des Lumières appartient à la Franc-maçonnerie et à diverses sociétés qui la prolongent, ainsi qu’à des Académies françaises et étrangères… Ce juriste réformiste, à l’esprit philosophique, pressé par les évènements, renie ses principes intimes. Porte-parole des colons à l’Assemblée nationale, il se prononce contre la suppression de la traite, contre l’abolition de l’esclavage et même contre l’octroi de l’égalité des droits politiques aux métis libres. »
Moreau prend ici l’apparence d’un homme éclairé, reconnu, adepte des grands principes du siècle des Lumières. N’appartenait-il pas à la franc-maçonnerie ? En prenant position pour la traite des Africains et le maintien de l’esclavage, en s’opposant à l’égalité des droits entre les colons Blancs et les « métis libres », le député de la Martinique aurait renié ses « principes intimes ». Mais de quels « principes » s’agit-il ? Pluchon n’apporte aucune précision sur ce point.
Appartenant tous les deux à la classe des maîtres de la colonie, Raimond et Moreau vont se rencontrer dès les débuts de la Révolution française et s’affronter sur la question du préjugé de couleur dans les colonies. De ce combat, dont les enjeux n’ont jamais été clairement mis en lumière, vont naître des chassés-croisés étonnants, arguments, savoirs, dénis, mensonges, amitiés et haines politiques surgis du face à face entre deux positions : celle de l’aristocratie de l’épiderme contre celle de l’égalité.
Le préjugé de couleur a-t-il toujours existé ? L’exemple des colonies esclavagistes françaises d’Amérique indique qu’il est apparu tardivement, dans les années 1720. Depuis le XXVIIIe siècle, des colons riches appartenant à la classe dominante n’ont pas hésité à épouser en mariage légitime des femmes africaines, dont ils ont eu une descendance métissée, révélant leur « indifférence à la couleur », qui se retrouve également dans les textes organisant l’ordre juridique esclavagiste de cette époque. Le préjugé de couleur est-il une conséquence de cet ordre juridique esclavagiste ou bien l’esclavage n’a-t-il été qu’un prétexte à son apparition ?
Grâce à des sources restées jusque-là ignorées, nous avons pu retracer les débats suscités par la naissance du préjugé de couleur. Il s’agit des nombreux textes de Julien Raimond publiés de son vivant, avant et pendant la période révolutionnaire. Arrivé en France, il découvre que l’apparition du préjugé de couleur, récente dans les colonies, était largement méconnue. Il s’employa avec ténacité à la faire connaître à ses amis de métropole et c’est ainsi qu’il en devint le premier historien.
Lors des débats organisés à l’Assemblée constituante, le public, qui jusqu’alors ignorait tout de la question, prit progressivement conscience du préjugé de couleur et des réalités coloniales.
Il est important de souligner que ce furent ces chassés-croisés, ces échanges constants entre les deux rives de l’Atlantique, qui permirent aux deux révolutions en cours, celle de France et celle de St-Domingue, de se rapprocher, de s’éclairer, d’apprendre l’une de l’autre et, enfin, de se construire autour de la conquête de droits communs à l’humanité tout entière. Ainsi, le premier « martyr de la liberté » célébré en France fut une des victimes de ce préjugé de couleur : Vincent Ogé, arrêté puis exécuté par décision de l’assemblée des colons du Cap, le 23 février 1791. « Déclencheur de l’insurrection des esclaves à St-Domingue », l’exécution d’Ogé eut une portée décisive.
Ces échanges permanents d’une rive à l’autre de l’Atlantique conduiront notre enquête sur la diffusion du préjugé de couleur et le combat mené par ses victimes, qui allaient ouvrir le processus révolutionnaire dans le but de fonder, dans cette Amérique esclave, ce que la Société des Citoyens de Couleur appelait « l’égalité de l’épiderme », objectif toujours d’actualité. Cette volonté de reconquête des droits de l’humanité renouait avec le combat mené et perdu par Las Casas et ses amis humanistes, près de deux siècles et demi plus tard.
[1] Y. Debbasch, Couleur et liberté. L’affranchissement dans les possessions françaises de la Caraïbe, 1635‑1833, Paris, Dalloz, 1967.
[2] Sur B. de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, 1552 (trad. française), Paris, La Découverte, 1979.
[3] Thomas Paine renouvela cette proposition dans Human Rights, 1792, (trad. française) Les droits de l’homme, Paris, 1987, II, Chap. 5.
[4] C. Coquery-Vidrovitch, Les routes de l’esclavage, VIe-XXe siècle, Albin Michel, 2021 ; P. Ismard, Les Mondes de l’esclavage, Seuil, 2021.
[5] M. Devèze, Antilles, Guyane, la mer des Caraïbes de 1492 à 1789, Paris, SEDES, 1977 ; G. Barthélemy, Dans la splendeur d’un après-midi d’histoire, Port-au-Prince, 1996.
[6] Mirabeau, Les bières flottantes des négriers, Presses universitaires de St-Étienne, 1999, Discours tenu aux Amis de la Constitution, 1er et 2 mars 1791 ; J. Fouchard, Les Marrons de la liberté, Port-au-Prince, 1988 ; G. Barthélemy, « Le rôle des Bossales dans l’émergence d’une culture de marronnage en Haïti », Cahiers d’Études Africaines, n° 148, 1997, p. 839 ; Cl. Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage, Paris, Amsterdam, 1998.
[7] E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions européennes, Paris, Éditions de Minuit, 1969, t. 1 chap. 5, L’esclave, l’étranger, p. 355.
[8] J.-F. Niort, Le Code noir : Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier Bleu, 2015.
[9] M. Deveze, Op. cit., chap. 13 ; E. Williams, Capitalism and Slavery, London, 1942 (trad. française), Capitalisme et esclavage, Paris, Présence africaine, 1968 ; voir les Cahiers des Anneaux de la Mémoire, Nantes, depuis 1999.
[10] Voir infra, IIe Partie, les projets de la Société des Amis des Noirs de Paris.
[11] J. Raimond a raconté l’échec de cette tentative initiale des libres de couleur, dans son Mémoire présenté à Castries en 1786, Archives d’Outre Mer, (Aix-en-Provence) Col. F3 91.
[12] L. Nemours, « J. Raimond, le chef des gens de couleur et sa famille », DES dirigé par G. Lefebvre. Un résumé publié par les soins de Lefebvre dans AHRF, 1951, p. 257‑62 ; Y. Debbasch, Couleur et liberté, op. cit. ; J. Garrigus, The Free Colored Elite of St-Domingue. The Cas of J. Raimond, 1744‑1801, 1990. L’auteur m’a fait connaître ce texte non publié et « Sons of the Same Father », in C. Adams ed., Visions and Revisions of Eighteenth Century France, Univ. Press Pensylvania, 1997.
[13] Général Pamphile De Lacroix, La Révolution de Haïti, (1819) Paris, Karthala, 1995, rééd. par P. Pluchon.
[14] Lois et Constitutions des Colonies Françaises de l’Amérique sous le Vent, Paris, 1781‑90, 6 vol. Sur la rencontre entre Moreau et le physiocrate Le Mercier de la Rivière voir L.P. MAY, Le Mercier de la Rivière. Aux origines de la science économique, CNRS, 1975 et F. Gauthier, « Le Mercier de la Rivière et les colonies d’Amérique », Revue d’Histoire des Idées Politiques, Les Physiocrates et la Révolution française, n° 20, 2004, p. 261‑283.
