Décolonisations : regarder l'histoire en face
par Nicolas Bancel et Pascal Blanchard
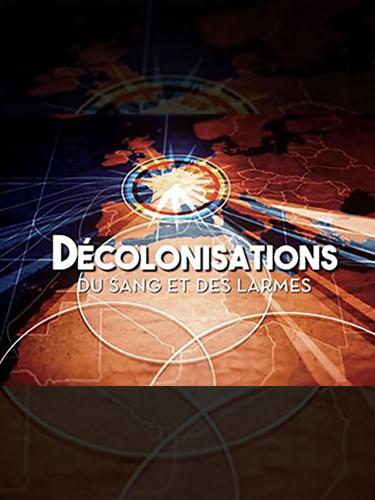
En décembre 2019, un petit groupe de six chercheurs – menés par Pierre-André Taguieff – publiait dans l’Express une tribune à charge sur les études postcoloniales et le Groupe de recherche Achac. Nicolas Bancel et Pascal Blanchard, tous deux historiens spécialistes de l’histoire coloniale et des enjeux postcoloniaux, et codirecteurs du Groupe de recherche Achac, leur répondait sur Mediapart. Un an plus tard et à l’occasion de la sortie du documentaire Décolonisations : du sang et des larmes sur France 2 le 6 octobre 2020 – dont Pascal Blanchard est l’un des auteurs et Nicolas Bancel l’un des conseillers historiques – le débat sur les études postcoloniales refait surface, comme la critique du film, lors d’une campagne cette fois-ci concentrée dans Le Figaro (alors que la presse et le public ont été très positifs sur le film). Les deux historiens font donc face à une campagne d’articles et de tribunes les accusant de contribuer à une « haine de la France » et ayant proposé des films sans assise historique. Plusieurs polémiques vont dans ce sens sur le travail des chercheurs sur le passé colonial. Pour ces polémistes, les études (post)coloniales et intersectionnelles venues des États-Unis fragmenteraient la société française et la République et, dans ce contexte sensible, le travail sur le film est par effet concentrique visé par certains. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel ont décidé de répondre de manière précise et argumentée dans cette tribune publiée dans Politis.
Décolonisations : regarder l’histoire en face
Ces images, ce récit, ce passé… difficile de regarder cela en face. Il nous semble pourtant nécessaire, désormais, d’affronter cette histoire. Signe des temps, le Président de la République Emmanuel Macron, dans un récent discours, soulignait que « nous sommes un pays qui a un passé colonial et qui a des traumatismes qu’il n’a toujours pas réglés, avec des faits qui sont fondateurs dans notre psyché collective… ». Il est temps de revenir sereinement sur ce passé qui ne passe pas et d’arrêter, des deux côtés du miroir colonial, une guerre des mémoires destructrice.
Nous travaillons sur le passé colonial depuis des décennies. Coauteur du film diffusé le 6 octobre dernier, Décolonisations. Du sang et des larmes, ou historien conseil de celui-ci, nous avons participé tous les deux à une table ronde sur les décolonisations au Rendez-vous d’histoire de Blois, le 10 octobre, et nous avons publié aux Éditions de La Martinière cette année, avec Sandrine Lemaire, un ouvrage de synthèse, Décolonisations françaises. La chute d’un Empire. Notre engagement d’historien à diffuser ce savoir est donc avéré. Et ce documentaire, auquel ont contribué plusieurs historiens et historiennes, est un travail d’histoire.
Si les recherches historiques ont considérablement progressé ces dernières décennies, comme cet ouvrage de synthèse en témoigne ainsi que de nombreux autres travaux (à l’image de l’ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch issu de la série d’Arte Les Routes de l’esclavage, histoire des traites africaines : VIe-XXe siècle), le grand public reste très peu informé du passé colonial de la France et de ses conséquences à long terme, de l’esclavage aux héritages de la colonisation. Nous croyons qu’il est temps de l’assumer, et d’explorer en commun, aussi, la réalité des décolonisations, la plus longue guerre de la France au XXe siècle (1943-1967).
Les nostalgiques et conservateurs de la mémoire qui refusent d’explorer les pages complexes et souvent douloureuses de la décolonisation, comme en témoignent les pages du Figaro ces derniers jours (que nous nous proposons d’analyser dans cet article), de même d’ailleurs que les radicaux identitaires de tous bords qui refusent d’accepter que cette histoire puisse s’écrire ensemble (ou soit écrite par des « Blancs »), poursuivent une guerre des mémoires qui n’a plus lieu d’être. Le temps de l’amnésie (1970-2020) se termine.
Nous pensons que la France est prête à regarder en face son histoire (même si ce processus est difficile), pour mieux la dépasser. Il serait désastreux de retomber dans une guerre des mémoires qui, depuis soixante ans, coupe en deux la société française.
Revenir sur le passé
En vingt-cinq ans, l’Empire colonial s’est effondré. De 1943 à 1967, des territoires représentant cinq sixièmes de la surface de l’Empire échappent à l’autorité de la République. Ceux-ci, au terme de longs combats, de guerres, de négociations et de compromis, conquièrent leurs indépendances. Au milieu des années 1970, les derniers territoires africains s’émancipent (Djibouti et les Comores), puis les Nouvelles-Hébrides en 1980. Une page d’histoire se ferme… et se prolonge aussi avec, par exemple, le référendum en Nouvelle-Calédonie en 2020.
Cette histoire est mieux connue, grâce notamment aux efforts méritoires de l’Éducation nationale, mais combien y lisent un moment de basculement du récit national ? Combien de nos contemporains ont vu dans cette période des indépendances l’une des faces les plus complexes et parfois les plus sombres de l’histoire de nos républiques successives et un moment, aussi, où la quasi-totalité de la classe politique française a été compromise dans ce processus, alors que se développait pourtant en France un courant anticolonial ? Bien peu.
Car cette histoire, la France a voulu l’oublier, l’enfouir. La segmentation de chaque conflit de la décolonisation – guerre d’Algérie, guerre d’Indochine, indépendances africaines, etc. – en fait une histoire parcellaire. Pourtant, une logique anime cette période : la volonté des pouvoirs successifs de conserver l’Empire, par tous les moyens. Le général de Gaulle sera le seul chef d’État à prendre tardivement conscience, en 1959, de la nécessité de la décolonisation, et encore ce fut sous la pression des événements.
Ce conflit global et mondial concerne des dizaines de territoires, aujourd’hui indépendants mais aussi des régions ultramarines parties prenantes de la République française, à l’image de la Nouvelle-Calédonie qui a voté pour la seconde fois au sujet de son indépendance il y a une quinzaine de jours (53,26% pour le « non »).
Cette histoire est aussi celle d’une défaite – du côté français – dans la mesure où les autorités françaises ont depuis le début (1943-1944), et toutes tendances politiques confondues, usé successivement de différentes stratégies – guerres, corruption, manipulation des élections, négociation avec les élites francophiles – pour « sauver » ce qui pouvait l’être de l’Empire et conserver ces « confettis » que sont désormais les territoires ultramarins de la France.
Contrairement à une idée répandue, cette histoire n’a pas pris fin en 1962 en Algérie. De fait, elle se prolonge bien au-delà en Polynésie, dans les Antilles, les Comores, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Djibouti ou La Réunion, mais aussi dans de nombreux territoires ex-colonisés, notamment en Afrique subsaharienne, où la France a réussi, parfois durant des décennies après les indépendances, à maintenir son influence et une partie de sa puissance. Cette histoire s’écrit donc, aussi, dans une temporalité postcoloniale, où les suites de la colonisation se font encore largement sentir aussi bien dans les anciennes colonies qu’en France, marquée par ces liens « incestueux » avec une partie de son ex-Empire.
Il en est ainsi en France des enjeux de mémoire, des nostalgies, des commémorations, mais également des immigrations postcoloniales et des questions soulevées par le sort des descendants de ces anciens « indigènes ». Cela concerne également toutes les populations ayant un lien avec le passé colonial de la France : anciens combattants, harkis, appelés du contingent, colons, rapatriés, fonctionnaires, militaires ou tout simplement acteurs passifs ou militants actifs de ces événements. Tout cela, nous le savons depuis longtemps grâce au travail des historiens (voir à ce sujet le livre référence Histoire de la France coloniale, 1914-1990, dont l’une des directrices de publication fut Catherine Coquery-Vidrovitch – une des conseillères historiques du film –, aux côtés de Jacques Thobie, Gilbert Meynier et Charles-Robert Ageron), mais le grand public l’ignore encore.
Le retour des nostalgiques
Pour les nostalgiques, le déclin de l’Hexagone aurait commencé avec les indépendances ; pour les décoloniaux les plus radicaux et ceux qui prônent une vision identitaire quasiment ethniciste des mémoires, la France d’aujourd’hui serait, dans un continuum parfaitement tautologique, l’héritière de l’idéologie coloniale et des violences des décolonisations (et l’histoire des décolonisations ne pourrait, par ailleurs, être mise à jour par des « Blancs »). Face à ces discours binaires, face à ces conflits mémoriaux, il faut revenir sur les décolonisations avec bien plus qu’un « regard lucide et responsable » (François Hollande, 2012), ne pas tomber dans la caricature en affirmant que ce regard ne fait que « noircir le passé » (Nicolas Sarkozy, 2007), affronter enfin ce « tabou » (Emmanuel Macron, 2020), pour comprendre pourquoi ce passé hante encore le présent. Il faut le regarder en face et ne plus en avoir peur.
Symbolique de ces réticences, la stratégie de destruction de toute approche critique des décolonisations menée par Le Figaro depuis une dizaine de jours. Cette stratégie peut se lire en trois temps, trois dynamiques négatives visant les deux ans de travail dédiés au film et au livre qui l’accompagne.
La première salve dans Le Figaro commence le jour de la diffusion du film. Alors que la presse est unanime à son sujet, Blaise de Chabalier titre son article : « Sous le signe de la repentance ». Le texte demeure cependant mesuré : « Mais si ce film fleuve ambitieux […] a le mérite de revenir en détail sur cette période douloureuse, il en propose une vision essentiellement à charge, placée sous le signe de la repentance. » Il poursuit : « La complexité de la période n’est pas assez expliquée. » Et de conclure : « C’est oublier que la présence française eut aussi des aspects positifs : en termes d’infrastructures, de santé ou encore d’éducation. [Car] s’il est important de ne pas cacher les blessures et les crimes du passé, encore faut-il, en même temps, mettre en lumière toutes les nuances de l’histoire. »
Clairement, cette critique se limite encore aux poncifs habituels sur la « mission civilisatrice » de la France. Quelque temps après, la position est plus radicale : il s’agit de dénoncer la qualité historique du film, son « idéologie », ses archives (truquées), et même d’assimiler le film au contexte des attentats terroristes qui se dérouleront quinze jours plus tard.
C’est en effet dix jours après l’article de Blaise de Chabalier qu’apparaît, le 16 octobre, le texte d’un historien, dans les colonnes du même quotidien. Pour Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb, ces films ne seraient (selon le titre de son article) qu’une « œuvre commerciale sans déontologie, pas un travail d’historien ». Examinons les reproches. Il faut en premier lieu prouver que ce travail est « truffé de mensonges et d’omissions » et démontrer que dans ce film « presque tous les chiffres cités sont inexacts, hormis les dates… »… Diable. Pierre Vermeren vient de publier On a cassé la République. 150 ans d’histoire de la nation (Tallandier), et pour lui, approcher le passé colonial de la France sous un angle critique contribue à déstabiliser la République. La tribune est donc incendiaire, à l’image de la pensée, omniprésente dans les colonnes de ce journal, d’un autre chroniqueur du Figaro, Éric Zemmour.
Pour commencer, il tronque les chiffres de l’audience de la soirée sur France 2 et lisse sur toute la soirée l’audience, alors que près de 2,6 millions de personnes ont suivi le premier volet à partir de 21 h 05. De plus, bien d’autres le verront en replay (il sera disponible pendant 60 jours sur France Télévisions), et à l’étranger, par mille et un subterfuges, des centaines de milliers de personnes l’ont vu et le verront encore dans les prochaines semaines. Guerre des chiffres pour réduire de facto le succès de cette soirée. Dans les citations, Pierre Vermeren tronque l’histoire, il prétend que nous aurions « emprunté » notre titre au célèbre discours de Winston Churchill du 13 mai 1940, sans se souvenir que celui-ci énonçait : « Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Eh oui, l’historien doit toujours vérifier ses sources…
Par la suite, il réduit l’importance des guerres et conflits des décolonisations, qui ont duré un quart de siècle et qui, selon lui, ne pèsent guère face aux morts de la Seconde Guerre mondiale ou aux « guerres intra-africaines depuis les indépendances [qui ont fait] au moins 16 millions » de victimes. Étonnante comparaison venant d’un historien prompt à donner des leçons de déontologie. Comment comparer, en effet, une guerre mondiale aux décolonisations françaises, ou encore la totalité des conflits inter-africains depuis soixante ans à celles-ci ? Quelle est la logique ? Où est la rigueur ? D’où viennent ces chiffres qu’il assène sans aucune source ? On voudrait renvoyer dans l’oubli le million de victimes des guerres coloniales que l’on ne s’y prendrait pas autrement.
Très vite, il affirme que ces films ne sont qu’un discours « victimaire » et manquent d’un « traitement scientifique rigoureux ». Pour emporter la conviction, il mélange allègrement le récit proposé par le film et ce qui s’est dit dans le débat (où ni les auteurs, ni le réalisateur, ni les conseillers historiques n’étaient présents, à la différence de la romancière Leïla Slimani ou de l’historien Benjamin Stora). Tout ce que nous aurions montré dans le film serait faux, les archives tronquées, une démarche qui, au final, puise « de manière orientée des archives pour les exhiber sur fond de musique de film ». Avec un seul but : « le choc des images », car « une fois colorisées, montées, cadrées et coupées à bon escient, rehaussées par des musiques de film tantôt angoissantes, lugubres ou chantantes, sur fond de voix off lue par un bon comédien, [les images] créent chez le spectateur, souvent ignorant du sujet, des émotions fortes, voire, du fait de l’accumulation des tragédies dévoilées ou suggérées par le récit militant, une sensation de dégoût, de rage ou de désespoir ». Ce ne sont donc pas les faits révélés par le film, cette « accumulation de tragédies », mais bien la colorisation des images et l’accompagnement musical (utilisé dans de très nombreux documentaires, aux sujets parfois encore plus « tragiques », tels la Seconde Guerre mondiale) qui en fin de compte le perturbent.
Revenons sur terre : les tragédies décrites dans le film suffisent largement à provoquer une réaction indignée chez le téléspectateur. Tout est dit ? Non. Car tout s’explique par l’idéologie d’un des auteurs du film : « créateur français du mouvement décolonial », pour qui la « déontologie d’historien serait une utopie ». Et ceci dans un seul but : « désintégrer » la société française et « jeter des allumettes sur un baril de poudre ». Rappelons, pour mémoire et pour revenir aux faits, que Nicolas Bancel et Pascal Blanchard ont refusé de signer le manifeste des Indigènes de la République (importateurs, eux, d’un mouvement décolonial radicalisé en France) et qu’ils ont été les premiers – à un moment où cela n’intéressait à peu près personne – à publier dans Le Monde, en mars 2005, une critique de ce mouvement et de ses idées. Ce qui leur vaut d’ailleurs, depuis, les attaques régulières des « décoloniaux radicaux » et du Parti des indigènes de la République. Mais à quoi bon s’embarrasser des faits ?
Pour Pierre Vermeren, l’approche critique des décolonisations et de son cortège de violences est tout aussi biaisée et fausse que l’histoire des « zoos humains », dont il estime qu’ils sont une invention. CQFD. Car selon lui, « il n’y a jamais eu de zoos humains, mais [seulement] des expositions ou des foires ». Et par conséquent les « Chrétiens et Républicains de métropole n’ont jamais douté que les habitants des colonies étaient des humains à part entière ». Doit-on rappeler que, si le phénomène des « zoos humains » est complexe (comme le démontre l’ouvrage paru en 2009 chez Liverpool University Press, mais encore faudrait-il le lire…), des groupes ethniques majoritairement issus des aires colonisées ont été présentés durant des décennies dans des espaces réservés jusqu’alors à la présentation d’animaux sauvages (zoos et jardins zoologiques), exhibés aux côtés d’animaux ? Que s’est diffusée concomitamment une vaste littérature s’interrogeant sur la place des « exotiques » dans le genre humain ? Que de nombreux travaux d’anthropologues raciaux cherchaient alors à placer les Africains à une place intermédiaire entre les grands singes et l’Homme ? Que beaucoup aient durant cette période douté du statut des « exotiques » dans l’espèce humaine ou aient cru à une infériorité consubstantielle des races non-européennes ne fait malheureusement aucun doute. Le phénomène des « zoos humains » n’est d’ailleurs pas propre à la France, il touche aussi bien les autres pays européens, les États-Unis ou le Japon : la France n’était qu’un pays parmi d’autres d’un vaste système économique transnational de monstration de l’Autre.
Après le déni de l’existence même des « zoos humains », la litanie des dénonciations des « mensonges » du film se poursuit : la réalisation et la production (Cinétévé) n’auraient pas comptabilisé les combattants morts à Diên Biên Phu avec les morts des camps de prisonniers du Viêt-Minh (preuve d’une volonté révisionniste assez étrange, puisque le coauteur est soupçonné d’anticolonialisme primaire…). Pourtant, le film explique clairement qu’il s’agit des morts durant les combats de Diên Biên Phu et non les victimes suivantes dans les camps du Viêt-Minh. Cette séquence serait en outre aggravée par le « manichéisme purificateur du commentaire » (tous ceux qui ont participé à l’écriture de celui-ci apprécieront)…
Il est également reproché au film de ne pas mentionner que les supplétifs algériens de l’armée française sont plus nombreux que les combattants FLN (ce qui est vrai, mais peut-on tout dire dans un documentaire sur une histoire aussi vaste ?). Idem, d’ailleurs, pour la non-mention du fait que les combattants FLN qui arrivent du Maroc et de Tunisie sont en majorité des déserteurs de l’armée française (mais là aussi, il n’est pas possible de tout dire dans un film). Il nous reproche aussi de « glorifier » des leaders anticoloniaux devenus des dictateurs (alors que le film ne traite clairement pas des trajectoires postcoloniales des nouveaux États indépendants). Soyons sérieux, deux films ne peuvent tout dire, ce n’est pas leur fonction. Pour approfondir, l’ouvrage publié aux Éditions de La Martinière Décolonisations françaises. La chute d’un Empire est disponible. Pierre Vermeren y retrouvera plus de faits et de développements.
Affirmer par ailleurs, comme le fait Pierre Vermeren, que l’immigration postcoloniale est déclenchée par l’oppression exercée par ces nouvelles dictatures sur leurs propres populations est largement spéculatif. Si un nombre non négligeable d’opposants ont effectivement émigré pour cette raison, c’est d’abord les conditions socio-économiques, l’existence de réseaux de migrants en France structurés durant la colonisation, la faveur de la langue et les politiques migratoires de la France qui expliquent ces migrations, qui sont dans leur très grande majorité des immigrations de travail. Là aussi, revenons aux faits, et s’il cherche à mieux comprendre ce phénomène migratoire, notamment en provenance d’Algérie, qu’il relise les ouvrages de Benjamin Stora. Il y retrouvera plus de détails et d’explications.
La toute dernière critique est pour le débat organisé après les deux films par un « journaliste sympathique mais autodidacte » (débat auquel aucun de nous deux n’était présent). Débat où la France a été présentée, selon lui, comme « bloc criminel monolithique » et « les colonisés [comme] un bloc victimaire unique ». Avec, au passage, un dernier mensonge : le film a été conçu sans « aucun contrôle des historiens reconnus comme tels par leurs pairs ». Pourtant Benjamin Stora était au débat… mais il ne compte pas. Pourtant Catherine Coquery-Vidrovitch, Nicolas Bancel, Tramor Quemeneur… et plusieurs autres historiens de renom sont conseillers scientifiques du film, mais Pierre Vermeren ne les cite pas, car sa démonstration s’effondrerait.
Mais qu’importe, sa tribune incandescente n’a qu’un but : prouver que le projet républicain actuel n’est plus soucieux « de pacifier les mémoires et de cautériser les plaies de l’histoire, [il] n’est qu’un bateau ivre ». Tout fout le camp, il faut revenir à l’histoire officielle, contrôlée et vérifiée par des commissaires du peuple, pour éviter de produire une histoire « dangereuse à présenter à nos lycéens ». En définitive, faudrait-il sauver le mythe et la grandeur (coloniale) de la France ? Et ne pas le laisser à des politiques « ayant présenté à Alger la colonisation comme un crime contre l’humanité » et à un gouvernement qui n’a qu’un rêve, financer des recherches sur « les questions de genre, de domination et de minorités » ? Si l’histoire coloniale est effectivement mal lotie à l’Université – ce que nous regrettons –, il semble contre-productif de dénoncer des recherches telles l’histoire des minorités ou du genre, récentes et pour certaines d’entre elles marginales dans les recherches historiques, qui méritent tout autant l’attention que nos sujets de recherche (et doivent d’ailleurs être intégrées à l’histoire coloniale).
Le travail de l’historien comme « antichambre du terrorisme »
Quelques jours plus tard, le 21 octobre, Le Figaro tire une troisième salve. Sous le titre « La fabrique du ressentiment », c’est cette fois-ci l’historien Jean-Louis Margolin, spécialiste de l’Asie et dont le dernier livre en 2015 traitait de l’Inde, qui se lance dans une attaque en règle du film avec une association parfaitement scandaleuse avec l’attentat récent et le crime odieux contre le professeur d’histoire Samuel Paty, suggérant un lien « contextuel » entre le regard sur le passé colonial et la violence jihadiste et radicaliste que nous connaissons aujourd’hui au sein de la jeunesse.
Pour lui, ces deux films sont ahistoriques et nourrissent « notamment le ressentiment d’immigrants de plus ou moins fraîche date à l’égard de la France » et fabriquent une « vision culpabilisatrice de notre passé colonial ». Une approche en parfaite concomitance avec l’interview dans Le Figaro de l’ancien Premier ministre François Fillon, sous le titre « Il y a un problème avec la religion musulmane, et non avec les autres ». Une interview dans laquelle il fait le lien entre « passé colonial », « violence terroriste » et islam dans son rapport à la société française, où il déclare : « Le manque de confiance en nous, en notre culture, en notre passé, atteint des sommets délirants avec la contestation de toutes les grandes figures de l’histoire, le déboulonnage des statues, le procès permanent fait à tous les dirigeants de notre pays d’être soit esclavagistes soit prédateurs sexuels. » Et de conclure : « Tout cela crée un climat qui participe à réduire notre capacité d’intégration, de mobilisation de la population nationale. »
Le but est, avec ces deux papiers, de créer un schème de pensée pour légitimer la charge violente à venir contre les deux films accusés de participer à cette entreprise de déstructuration et de contribuer à promouvoir la haine de la France. On le comprendra, en tant qu’auteur du film et conseiller historique de celui-ci, il est essentiel de répondre à une telle déformation de notre travail d’historiens et à cette manipulation opportuniste du plus odieux des crimes.
Jean-Louis Margolin commence d’ailleurs sa « tribune » sur le film par ces lignes : « Le meurtre de Samuel Paty a été commis par un Tchétchène », qui pour lui n’est « pas un coup de folie et est partagé, sous des formes heureusement moins agressives, et à des doses variables, […] par d’autres immigrants de plus ou moins fraîche date ». Il fait un lien immédiat entre histoire coloniale et terrorisme. Soulignant même qu’il n’est « pas nécessaire d’être islamiste, ni musulman, pour partager une vision extrêmement noire de notre passé ». Le message est clair : Décolonisations. Du sang et des larmes n’a qu’un objectif : contribuer à haïr la France. Donner des « idées » aux migrants postcoloniaux pour détester la République. En conclusion : il ne faut pas évoquer les pages les plus sombres du passé colonial et encore moins celles rythmant les décolonisations. Car cela mène à penser que « la vérité de la France, ce serait la combinatoire toxique de l’esclavagisme, du colonialisme, du racisme, des inégalités et du patriarcat. Cette vision s’est érigée en nouveau roman national, aux cinquante nuances de sombre ».
Dès lors, le danger est à nos portes. Les médias « les plus officiels », « le cinéma ou la littérature à succès (qu’on pense à certains récents prix Goncourt) [en référence à Alexis Jenni ou Leïla Slimani, on l’aura compris, lauréats en 2011 et 2016] […], les réseaux sociaux » basculent dans cette vision du monde. Jean-Louis Margolin nous annonce qu’il faut sauver la France et, pour illustrer ce combat, il prend en « exemple ce documentaire-fleuve » et son supposé travail de sape. Pourtant, le film n’énonce que des faits avérés. Son objet est l’histoire des décolonisations durant lesquelles, il est vrai, le rôle des gouvernements français successifs ne fut généralement pas glorieux. Pour cette raison, doit-on scotomiser ces faits ? Nous ne le pensons pas. Il conteste pourtant que les auteurs du film aient décidé de parler d’une « guerre de vingt-cinq ans » (ce dont on peut discuter car c’est un débat d’historiens). Mais l’ambition du film va au-delà, il veut aussi montrer la constance d’une politique impériale foncièrement conservatrice qui provoque une succession de conflits liés entre eux.
Jean-Louis Margolin affirme ensuite que « ce documentaire fourmille d’inexactitudes, d’erreurs graves et d’omissions dramatiques ». S’agissant de Thiaroye, le film ignorerait le fait que les tirailleurs n’étaient pas des combattants de la France libre mais avaient été faits prisonniers par les Allemands. Nous ne contestons pas ce fait et un témoin le dit clairement au sujet de son père. Concernant la séquence sur la déclaration d’indépendance d’Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945, le film ferait croire que cette déclaration est contre la France, alors que les Français ne sont pas encore revenus en Indochine. Pourtant, il est évident que cette déclaration s’adresse bien à la France, après la défaite des Japonais et l’effondrement de l’administration vichyste, même si les troupes de la France libre ne sont pas encore revenues en Indochine. Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour savoir que la France va vouloir récupérer sa colonie et qu’oncle Hô s’adresse à la France libre du général de Gaulle. Il conteste les chiffres des morts en Afrique noire… mais donne lui-même les mêmes chiffres que nous au Cameroun, à Madagascar ou en Côte d’Ivoire. Pour l’Indochine, nous expliquons plusieurs fois l’aide des Chinois au Viêt-Minh (cinq occurrences dans le film), et pourtant il affirme que nous aurions « négligé, lors de la bataille de Diên Biên Phu, l’aide massive de la Chine communiste, qui codirigeait la bataille avec ses camarades vietnamiens ». Là encore, il s’agirait de ne pas déformer, sous prétexte de critique, les informations données par le film. Cette manière de procéder n’est pas déontologique.
Jean-Louis Margolin critique ensuite le regard porté sur Sékou Touré, Ahidjo et d’autres dirigeants d’Afrique noire, au prétexte que nous n’aurions pas assez expliqué qu’ils deviendront bientôt des « dictateurs ». Mais, encore une fois, ce n’est pas le sujet du film, qui s’interroge sur les décolonisations de l’Empire français et non sur les États postcoloniaux. Enfin, position partisane insoutenable pour lui, nous n’aurions cité positivement que Jean-Paul Sartre… Il oublie Michel Rocard, Pierre Mendès France et les autres, également cités « positivement » pour leurs actions : là aussi, revenons aux faits. Et enfin, nous aurions osé montrer des archives sur la « violence extrême » de ces années… Incroyable aveu ! Aurait-il fallu cacher, masquer et refuser de montrer les archives qui existent ? Au nom de quoi ? De la préservation de la paix civile ? Nous sommes d’abord historiens et nous refusons de cacher des documents importants, qui éclairent, en l’occurrence, la violence des décolonisations.
Que souhaitait réellement notre contempteur ? Que l’on raconte les indépendances sans jamais montrer les images ? Ni les faits de violence ? Montrer une France coloniale idéale ? Et de nous accuser de n’avoir jamais su regarder la violence des mouvements anticoloniaux. À croire qu’il n’a pas regardé la seconde partie du film, sur le FLN ou le Cameroun, les harkis et la violence des attentats, sans même parler du traitement des prisonniers français par le Viêt-Minh, qui fixent la pellicule à la fin du premier épisode. Il nous est enfin reproché d’avoir donné la parole à tous, aux anciens colons, militaires, activistes du Viêt-Minh ou du FLN… dont cette femme « qui dans ses jeunes années tua et mutila délibérément des femmes et des enfants dans l’un des premiers attentats terroristes de l’histoire ». Au final, tout est dit dans sa conclusion : un tel film, pour les « spectateurs prenant [le] documentaire au sérieux », ne peut que faire douter de la France de 2020.
Nous pensons bien au contraire que c’est en évoquant ce passé, en le regardant en face, en écoutant les témoins, quels qu’ils soient, que la République de 2020 sera capable de répondre à ceux qui doutent d’elle et sera capable d’intégrer l’autre, quels que soient son histoire, son parcours, sa mémoire familiale… pour au final dépasser les traumas de l’histoire. De nombreux pays ont fait ce chemin pour l’histoire coloniale, l’Allemagne l’a fait pour le nazisme, pourquoi n’en serions-nous pas capables ? Si on ne le fait pas, d’autres, radicalisés, de l’ex-Front national aux indigénistes jusqu’aux islamistes, utiliseront ce passé pour recruter de nouvelles forces.
De fait, la critique peut aussi venir d’un autre bord. Venant de l’autre côté du spectre idéologique, certains récusent ce film au nom de la couleur de peau (blanche) des deux réalisateurs. Nous n’aurions pas (plus) le droit de parler de ce passé. C’est notamment la thèse de Léonora Miano reprise sur le site De l’autre côté de Mehdi Derfoufi – un des signataires du texte de soutien en 2017 à Houria Bouteldja, porte-parole des Indigènes de la République – dans laquelle elle affirme que ces films n’ont guère d’intérêt et qu’elle produirait, elle, « des œuvres plus justes, plus profondes, plus utiles… ». Nous l’engageons à le faire ! Et de conclure, comme les tribuns du Figaro, qu’il est « urgent que la parole et les moyens soient donnés à d’autres, que l’histoire ne soit pas toujours signée à la pointe du zizi… ».
Lorsque les deux opposés sont d’accord pour détruire un travail historique au nom de positions idéologiques, on est en droit de penser que l’on a sans doute visé juste et que ce travail n’a pas servi à rien. Au-delà de proposer un autre regard, il permet aussi de lire et d’entendre désormais ce que pensent ceux qui ne veulent surtout pas sortir des affrontements et des guerres des identités.
Et pour finir…
Nous ne contestons évidemment pas le droit de critiquer le film. Comme tout film, il a ses défauts, et certaines critiques peuvent faire débat. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce film prend d’entrée un axe d’interprétation – éclairer les politiques coloniales menées par les gouvernements français successifs, sous la IVe et la Ve République – et tend à démontrer que ces politiques ont cherché, par tous moyens, à conserver ce qui pouvait l’être (et à cet égard, il est vrai que le rappel constant des actions de « la France » devrait être nuancé : il s’agit bien, dans la plupart des cas, des actions des gouvernements successifs et de l’armée). Sa valeur pédagogique est incontestable, en ce qu’il permet de découvrir, dans cette logique, des faits absolument essentiels de l’histoire des décolonisations, pour beaucoup ignorés du grand public, tels les massacres de Sétif et de Guelma, ceux de Madagascar, la guerre au Cameroun, et tant d’autres.
Cet axe d’interprétation a bien évidemment des limites : l’histoire des fractions sociales colonisées n’est pas approfondie, qui aurait pu permettre de mieux mettre en évidence le fait que la colonisation s’appuie aussi sur certaines d’entre elles (la chefferie, certaines fractions des « évolués » ou des élites locales par exemple), brouillant parfois les frontières entre colons et colonisés, comme il ne permet pas, effectivement, de nuancer les différentes fractions des mouvements anticoloniaux, comme le rôle des appartenances religieuses. Il n’autorise pas, également, de rendre pleinement compte des complexités des réactions en France face aux drames successifs des décolonisations. C’est une évidence, liée à ce choix assumé, mais aussi au format même d’un documentaire de seulement trois heures, qui ne peut rendre compte de toute la complexité du réel. D’autres facettes des décolonisations restent encore à découvrir par le grand public, et ce film se propose d’être un jalon sur ce chemin. Cela ne mérite certainement pas la guerre de mémoire que certains voudraient susciter, ou l’indignité de certaines critiques.
Dans son discours sur les « séparatistes », Emmanuel Macron faisait du passé colonial un des éléments des crises « identitaires » du présent – notamment au sein de la jeunesse issue des immigrations postcoloniales –, parlant de « tabou » du côté français, et de manipulations des mémoires (et même d’un « surmoi post-colonial » plein d’« ambiguïtés ») avec ceux qui « instrumentaliseraient » cette histoire. Bien au-delà d’un surmoi, il y a aussi un long silence, et nous le savons, à chaque fois que la République ne regarde pas sereinement son histoire, d’autres s’emparent de ces enjeux et les instrumentalisent. Il est temps de faire de ce tabou une histoire réintégrée dans l’histoire nationale, dans toute sa complexité, afin d’éviter la méconnaissance et la radicalisation des points de vue.
C’est dans cette perspective et avec cette volonté que France Télévisions a programmé en « prime time » cette soirée exceptionnelle sur France 2, le mardi 6 octobre, avec le film Décolonisations. Du sang et des larmes. La presse a été (quasi) unanime, le public a été au rendez-vous (lisez les commentaires sur les réseaux sociaux). C’est aussi avec cette volonté de regarder en face ce passé, en cherchant à explorer beaucoup plus en détail la complexité du processus, que nous avons publié cette année le livre Décolonisations françaises. La chute d’un Empire aux Éditions de La Martinière (avec une préface de Benjamin Stora et une postface d’Achille Mbembe). Nous croyons en la vertu de l’histoire et des regards croisés. Il n’est plus possible de se voiler la face.
Nous ne voulons plus être l’esclave d’un roman national qui n’a jamais pu ni su regarder la colonisation et les décolonisations en face. Nous déplorons les oukases de censeurs qui placent leur vision idéologique au-dessus de tout, en donnant de pseudo-leçons de déontologie. Nous ne voulons plus faire cette guerre des mémoires. Ni d’un côté ni de l’autre. Et nous recommandons à tous de voir ou de revoir ces deux films pour se faire leur jugement. Cela tombe bien, il est encore pour 45 jours en replay sur le site de France Télévisions.
À découvrir également dans la même dynamique
L’article « La fabrique du dénigrement – sur le postcolonial » de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel dans AOC, en réponse à la polarisation extrême et inquiétante du débat public sur les questions (post)coloniales, entre les idéologues ultra-républicains et les activistes radicaux « décoloniaux »
L’interview de Pascal Blanchard dans L’Opinion
