« Doit-on supprimer les commissions d’historiens et d’historiennes sur la colonisation ? »
par le Groupe de recherche Achac
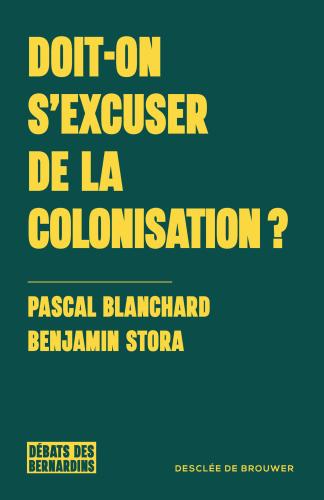
Dans une interview publiée par Le Figaro en août 2025, l’historien Pierre Vermeren commente la reconnaissance par Emmanuel Macron de la guerre au Cameroun (1955-1971). Pour lui, la France n’aurait pas dû reconnaître ce conflit et la démarche présidentielle relèverait davantage d’enjeux diplomatiques et politiques que de la recherche historique. Ce texte illustre une posture dite « anti-repentance », qui tend à minimiser les violences coloniales et à critiquer les commissions d’historiens mises en place pour documenter ces périodes. Cette actualité s’inscrit dans un contexte plus large de réflexions sur la mémoire coloniale, telles qu’elles sont explorées dans le nouvel essai Doit-on s’excuser de la colonisation ? (Éditions Desclée de Brouwer, 2025) des historiens Pascal Blanchard et Benjamin Stora, qui analyse les enjeux, controverses et tensions liés aux reconnaissances historiques décidées par l’État. L’interview de Pierre Vermeren et la réception médiatique qui l’accompagne témoignent de la difficulté persistante en France à concilier recherche historique, mémoire coloniale et enjeux diplomatiques. Le Groupe de recherche Achac propose en tribune cette semaine un décryptage de ces débats, en soulignant l’importance de laisser travailler les commissions d’historiens pour approfondir la connaissance du passé colonial et de ses conséquences.
Interview surprenante de l’historien Pierre Vermeren au sujet de la reconnaissance par Emmanuel Macron de la guerre au Cameroun dans Le Figaro. Une interview à décrypter ligne à ligne (https://www.lefigaro.fr/vox/politique/pierre-vermeren-en-reconnaissant-la-guerre-au-cameroun-emmanuel-macron-risque-de-raviver-des-tensions-20250814), car pour lui, la France n’aurait pas dû reconnaître cette guerre (de 1955 à 1971), se demandant également « ce que la France peut bien gagner diplomatiquement dans cette affaire » et son intérêt immédiat à regarder l’histoire en face.
Curieuse analyse pour un historien qui devrait (en toute circonstance) faire primer la vérité sur tout autre considération (opportunité, diplomatie, intérêt financier, enjeu idéologique ou intérêt politique…). De fait, on n’écrit pas l’histoire pour « gagner » quelques points diplomatiques ou « améliorer » les relations bilatérales entre deux pays. Au-delà, ce texte de Pierre Vermeren vise surtout à attaquer le Président de la République, à satisfaire l’électorat de droite et d’extrême droite, à combattre (au passage) les « décoloniaux-wokistes » et (enfin) à créer le doute sur les deux prochaines commissions mixtes envisagées par l’Élysée au sujet de Madagascar et de Haïti.
Décryptage du texte… et analyse entre les lignes de ce combat contre cette « repentance présidentielle ». Pour Pierre Vermeren, les « dirigeants africains sont éberlués, très étonnés par toutes ces démarches. Loin d’œuvrer en faveur de la paix, nous risquons [avec de telles reconnaissances sur le passé colonial et les crimes qui lui sont liés] de raviver des tensions, des contentieux, une animosité contre la France sur fond de mémoire coloniale chauffée à blanc par le décolonialisme. » Ainsi, voilà le fond de sa pensée : l’État français ne doit rien reconnaître, car personne ne réclame cela en Afrique et, surtout, derrière ses revendications il y aurait des fauteurs de troubles idéologiques, des « wokistes », qui ne veulent qu’une seule chose : la « repentance. » Et Pierre Vermeren est un chasseur de wokistes. Il fut de l’épopée en 2019 de L’Observatoire du décolonialisme (aux côtés des penseurs de cette Croisade comme Pierre-André Taguieff), devenu depuis un « Observatoire des idéologies identitaires » et, désormais, le moribond « Observatoire d'éthique universitaire »… Mais il est toujours en première ligne contre les islamo-gauchistes et contre ceux qui critiquent le passé colonial de la France.
Le Figaro adore lui ouvrir ses colonnes. Pour lui, Emmanuel Macron se trompe depuis des années avec les diverses commissions d’historiens/historiennes sur le passé colonial. Même les Africains ne comprendraient pas cette stratégie : « On a beau rejeter la Françafrique, nos contorsions rencontrent peu d’écho de l’autre côté de la Méditerranée. Tout au plus suscitent-elles une forme d’incompréhension. » La justification est ici : les ex-colonisés n’ont que faire de ces vieilles histoires de Blancs… pourquoi donc le Président de la République se préoccupe-t-il de cela ?
Sur la guerre du Cameroun
Néanmoins, il doit reconnaître que le rapport (issu de la commission présidée par Karine Ramondy) sur le Cameroun est de qualité et qu’il « s’apparente à une thèse d’histoire : 1000 pages, des centaines de notes de bas de pages » et que « les conclusions sont sérieuses », mais à ses yeux il ne faut surtout pas que l’État prenne position sur les conclusions de celui-ci, ni sur cette « guerre secrète » et encore moins reconnaître la responsabilité de la France. D’ailleurs, précise-t-il, la guerre au Cameroun n’était pas une guerre contre un peuple ou pour les intérêts de la France, c’était une guerre contre « une organisation politico-militaire » d’abord motivée, en pleine Guerre froide, par le danger communiste.
C’est oublier que le conflit, en parallèle de celui qui se déroule en Algérie, a commencé en 1955. C’est donc bien un conflit « colonial » en lien avec les décolonisations, dirigé d'ailleurs un moment par Pierre Messmer (futur Premier ministre de Pompidou) et qui correspondait à une stratégie française de conservation de l’Union française et qui s’inscrit donc dans ce processus des indépendances et va aussi au-delà de la Guerre froide. On doit également rappeler qu’une partie du Cameroun, essentiellement la Sanaga maritime, faisait l’objet d’une large mobilisation populaire contre la colonisation et que ce conflit est aussi inter-régional. La guerre menée contre l’UPC a annihilé toutes les chances que ce parti accède au pouvoir, et elle va permettre aux « alliés » camerounais de la France de s’en emparer lors de la décolonisation. Ensuite, la guerre va se poursuivre avec l’aide de la France, pendant onze ans, afin de maintenir le régime en place, les relations de celui-ci avec la France et réduire à néant l’UPC et ses leaders. En parfaite cohérence avec la Françafrique…
Après avoir évalué cette histoire, Pierre Vermeren peut ensuite critiquer la démarche d’Emmanuel Macron et les commission d’historiens/historiennes sur le passé colonial car, pour lui, « les précédents sont déjà nombreux depuis 2017 » et à chaque fois c’est l’impasse (comme en Algérie). Pour lui, cela « s’apparente à une démarche religieuse, pénitentielle de type catholique, consistant à avouer ses fautes... commises par des générations disparues. C’est tout de même troublant de la part d’un État laïque ».
À cet instant de l’interview, il faut un peu tronquer les faits : « À l’échelle mondiale, l’unique précédent (affirme sans aucune hésitation ni contradiction Pierre Vermeren au journaliste du Figaro) de ce genre se trouve en Allemagne, laquelle a demandé pardon pour la Shoah. » C’est faux et les cas sont nombreux et multiples de processus équivalents dans d’autres pays en lien avec le passé colonial de manière spécifique.
On se rappelle la visite à Benghazi effectuée le samedi 30 août 2008 par Silvio Berlusconi (dans l’ancienne colonie de l'Italie de 1911 à 1943, l’Éthiopie), où il déclare « Il est de mon devoir, en tant que chef du gouvernement, de vous exprimer, au nom du peuple italien, notre regret et nos excuses pour les blessures profondes que nous vous avons causées ». « Il s'agit d'un moment historique durant lequel des hommes courageux attestent de la défaite du colonialisme » observe alors Mouammar Kadhafi (voir Le Monde)...
Pierre Vermeren oublie aussi l’Allemagne et son passé colonial et pas uniquement le travail de reconnaissance en lien avec la Shoah dans ce pays. L’Allemagne a demandé en effet pardon à la Namibie pour le génocide des Herero et des Nama de 1904 à 1908 (voir l’article également dans Le Monde de Thomas Wierder). Le vendredi 28 mai 2021, le ministre allemand des affaires étrangères Heiko Maas déclarait : « Nous qualifions officiellement ces événements pour ce qu’ils sont du point de vue d’aujourd’hui : un génocide. […] À la lumière de la responsabilité historique et morale de l’Allemagne, nous allons demander pardon à la Namibie et aux descendants des victimes. »
Histoire, recherche historique et diplomatie
Aux yeux de Pierre Vermeren, le Président de la République se rendrait coupable d’un mélange des genres : « […] Emmanuel Macron croit que l’histoire peut créer une mémoire officielle susceptible d’apaiser les relations internationales. » Pour Pierre Vermeren, cela est un mythe. De fait, affirme-t-il : « les dirigeants algériens, rwandais, camerounais n’ont aucun intérêt à faire la vérité sur leur propre passé. » C’est dans cette perspective qu’il critique la démarche qui a présidé à la création des commissions sur le Rwanda, le Cameroun ou l’Algérie. Or, s’il est vrai que les pouvoirs en place au Cameroun et en Algérie n’ont aucun intérêt à faire la lumière sur les événements de la colonisation – tributaire d’un récit national pour l’Algérie et d’un déni de la responsabilité du régime d’Ahidjo dans la guerre du Cameroun – cela invalide-t-il la démarche aboutissant à la création de ces commissions ? De notre point de vue, nullement. Ce qui doit compter, pour les historiens, c’est le progrès de la recherche et la socialisation de ses résultats. Et dans cette perspective, ces commissions ont rempli leur rôle.
Pierre Vermeren estime à la fin de cette interview pour Le Figaro qu’il « importe de faire jaillir la vérité historique pour notre édification, écrit-il, mais on se demande ce que la France peut bien gagner diplomatiquement dans cette affaire ». Or, il est incontestable que ces commissions ont permis de mettre à jour et de publiciser des configurations coloniales – comme nous l’avons souligné –, configurations qui étaient encore largement ignorées par les non spécialistes. Ces commissions ont également permis de participer, grâce à des recherches empiriques minutieuses, à l’approfondissement des connaissances sur celles-ci. Les historiens se doivent de souligner ces progrès – qui laissent la place bien sûr aux critiques des pairs –, quant aux conséquences diplomatiques de ces commissions, ils ne sont certes, pour l’historien, pas le principal enjeu.
Par ailleurs, établir les faits n’est pas une démarche « pénitentielle », c’est la recherche, toujours difficile, de la vérité. La critique de la « repentance » n’est ni plus ni moins qu’un obstacle idéologique placé devant cette recherche et le déni de notre histoire coloniale se nourrit de cette posture « anti-repentance ».
La violence des commentaires des lecteurs
On l’aura compris, dans cette interview il faut lire entre les lignes. Des articles de ce type servent en outre à stimuler le lecteur du Figaro et à déclencher de la violence verbale, mais aucunement à penser les cheminements complexes de la mémoire coloniale. À lire les 300 et quelques réactions, on est halluciné par cette violence des mots. C’est clairement le but et l’historien se prête finalement à ce petit jeu idéologique qui consiste à remuer le chiffon rouge de la « repentance », une stratégie toujours efficace à droite et à l’ultra-droite.
D’ailleurs, la violence des commentaires est assez symbolique de la force de ce passé dans le présent. C’est une longue litanie assez brutale contre Emmanuel Macron — « Qui a donné mandat à EM pour toutes ces repentances ? » écrit un internaute — ; celui-ci n’aurait qu’une « préoccupation : rabaisser et détruire la France, son présent, son passé et son avenir » affirme un autre. Cette posture se retrouve dans bien d’autres commentaires : « La repentance à tout prix, l'autoflagellation en prime... Pauvre France. » ; « Flagellation et narcissisme… en même temps. » ; « Il récidive dans une repentance inutile et stérile. » ; « Assez de cette perpétuelle et insupportable repentance… ». Un autre écrit même « le Camerounais n'a jamais été colonisé par la France » ; un second commentaire précise qu’en ce qui concerne le Cameroun, « nous [La France] ne l'avions pas initialement colonisé, ne sommes intervenus que sous mandat de la société des nations puis de l'ONU et qu'après l'indépendance de celui-ci nous avons aidé l'autorité en place » ; un troisième résume son propos en une affirmation : tout cela c’est « fantasmer des crimes que la France n'a jamais commis ».
Pour beaucoup des commentateurs, à lire ce « courrier des lecteurs » du Figaro, ce type de reconnaissance en lien avec le passé colonial ne vise qu’à « Démolir systématiquement la réputation de son pays et salir son histoire » et c’est la « preuve » qu’Emmanuel Macron « n'a rien appris de sa reconnaissance de crime contre l'humanité par la colonisation de l'Algérie ».
Les commentaires sont violents, en sens unique et surtout qualifient quasi-systématiquement cette « politique de la mémoire » et de reconnaissance, de « repentance ». Avec ces prises de positions, à leurs yeux, « Macron symbolise le délitement de la France » et il est devenu « le président des étrangers en France ! » Cette politique n’aurait qu’un but : ouvrir les frontières du pays aux étrangers ; pour d’autres, cette politique viserait à se soumettre aux « décolonialistes » qui est « un mouvement politique dont le but est de nous dominer » (l’inversion de la domination coloniale donc !). La revanche du colonisé : la « repentance » consiste à « raviver des tensions » et « rallumer des braises ou mettre le feu… ».
Au milieu de cette forêt de critiques et d’insultes mêmes, quelques commentaires approbateurs surnagent… comme perdus dans le feu d’artifice des attaques « anti-repentance » et de crispations sur la manière de regarder le passé colonial, en ouvrant d’autres perspectives : « Pierre Vermeren illustre avec ses propos au contraire pourquoi la France n'en finira jamais avec la haine des ex-colonies contre elle. [Et] cet entretien de Pierre Vermeren, a fortiori dans Le Figaro, illustre qu'il n'a strictement rien compris aux bouleversements en cours en Afrique et en quoi la démarche du président Macron, si elle n'a pas d'effet immédiat vis-à-vis des pays concernés pour tout un tas de raisons, a au moins le mérite de soulager la conscience coupable de la France coloniale. » Un autre fait référence à la mission en attente (à l’Élysée) sur les « événements » de Madagascar 1947 : « Il y a encore [du travail à faire] Madagascar où l’armée française aurait massacré entre 50.000 et 100.000 Malgaches… » Mais ces commentaires sont minoritaires (1 à 2%) et ils ne reflètent en rien les prises de positions habituelles du lectorat du Figaro.
On touche là une posture qui a toujours existé chez certains historiens en France spécialistes du passé colonial, de Daniel Lefeuvre à Bernard Lugan, affirmant un discours clairement « anti-repentance » et une démarche critique contre toute reconnaissance par la France des moments les plus sombres du passé colonial. De fait, cette histoire reste un des derniers tabous du récit français, mais aussi un marqueur encore puissant de la posture de chacun dans son rapport à l’histoire de France. Quelques jours plus tard, Le Journal du dimanche (le 20 août 2025) s’engage, d’ailleurs, dans une analyse comparable. Sous le titre « Colonisation : l’éternelle repentance d’Emmanuel Macron », Jean-Marc Albert précise : « Le président français n’a pas fini de battre sa coulpe pour notre inépuisable histoire coloniale et, même au-delà, puisqu’après le Rwanda, jamais colonisé par la France, se profile déjà la demande de réparation d’Haïti. […] Les gestes d’apaisement du président n’ont, en fait, récolté que le mépris de ceux qui n’y voient qu’une faiblesse à exploiter pour exiger réparation. »
Jean-Marc Albert résume cette histoire par une réécriture assez stupéfiante : la « colonisation fut un phénomène universel » ; « les peuples africains ont réduit leurs voisins en esclavage, comme l’Empire ottoman a asservi les populations balkaniques et maghrébines » ; « la gauche a lancé la colonisation, la droite l’a assumée » ; « la gauche lui en reproche aujourd’hui les errements pour mieux s’en dédouaner » et pour conclure : « la France n’a jamais été une puissance colonisatrice comme put l’être son voisin britannique. Il y eut bien un “Empire” mais il fut davantage le fruit d’un effet d’entraînement que d’un projet prémédité. Pour souligner un soi-disant manque d’intérêt des Français, il affirme même : « Le retour des pieds-noirs dans l’indifférence des métropolitains prouve ce désintérêt pour une entreprise faite à reculons ».
En conclusion, il rappelle qu’il n’y a pas crime : « La colonisation fut certes brutale mais n’a pas cherché à exterminer. La romanisation de la Gaule fut-elle un crime contre l’humanité ? » La responsabilité viendrait, selon cet article, des wokistes et des décolonialistes qui « dans un climat de compétition victimaire et d’ethnicisation du débat » espèrent faire payer à la France actuelle des « crimes » imaginaires issus du passé colonial. Désormais, « l’assignation à vie, par la repentance, d’un statut d’opprimé à ceux qui se présentent comme “descendants d’esclaves” dessine en creux celui de “bourreau” éternel de la France ». Emmanuel Macron ne « réconcilie » pas les mémoires et ne « risque pas de faire de “notre” histoire la “leur” ».
Le dernier tabou de l’histoire
On le constate, la colonisation reste un sujet politique majeur, un espace de polémique et de manipulation du passé, mais aussi un marqueur idéologique fort. Cette place du passé colonial dans le récit national est d’ailleurs un des sujets qui est analysé dans l’essai qui vient tout juste de paraître de Pascal Blanchard et Benjamin Stora : Doit-on s’excuser de la colonisation ? (Éditions Desclée de Brouwer, 2025). Il montre que l’on attend tout de la présidence de la République — en France, la reconnaissance vient du « haut » —, mais cela implique aussi (et toujours) une polarisation des débats sur ce sujet.
Stratégiquement, il y a aussi derrière ce combat polémique un objectif : faire que la commission mixte d’historiens/historiennes franco-malgache qu’a annoncée Emmanuel Macron en avril dernier à Madagascar « autour des événements de 1947-1948 » (et la répression menée par l’armée française dans l’île aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale) ne soit pas mise en place à la rentrée de septembre 2025. Après l’Algérie (mission Stora), après le Rwanda (mission Duclert), après le Cameroun (mission Ramondy), après les Antilles-Guyane (mission Stora sous François Hollande), les deux prochaines missions envisagées pour la fin de son second mandat par Emmanuel Macron (Madagascar et Haïti) sont pour la droite et l’extrême droite inacceptables. Cette tension, qui persiste 70 ans après le début du conflit au Cameroun ou celui en Algérie, est lisible dans ces deux journaux — comme dans les commentaires à lire sur leurs sites respectifs —, et cela explique en grande partie la difficulté en France, et en Afrique, à digérer enfin ce passé qui ne passe pas.
Nous sommes dans une sorte de post-vérité, en refusant de voir en face le passé ou en le minorant (on a « tous » colonisé ; on est « tous » des colonisateurs ; il n’y a pas de « crime »…), affirmant que la « vérité » n’est pas bonne à dire et dangereuse. Ne pas écrire les récits — douloureux ou glorieux — c’est une étrange défaite dirait Marc Bloch, une défaite devant les faits. L’antithèse du désir de savoir. L’inverse du métier d’historien… Alors oui, il faut laisser travailler les commissions d’historiens et d’historiennes pour que le débat puisse se poursuivre.
