Du décolonial au wokisme. Des subaltern studies au décolonial en Afrique subsaharienne
(seconde partie)
par Catherine Coquery-Vidrovitch
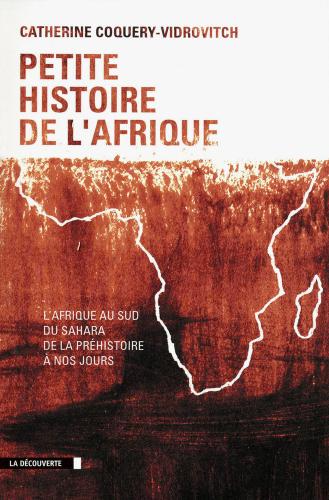
Catherine Coquery-Vidrovitch est une historienne spécialisée dans l’histoire africaine. Professeure émérite de l’Université Paris VII, ses travaux s’intéressent notamment aux enjeux politiques de la colonisation. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont les plus récents sont Le choix de l’Afrique. Les combats d’une pionnière de l’histoire africaine (La Découverte, 2021) et Les routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines VIe-XXe siècle (Albin Michel, 2021). Cet article entend analyser les réactions diversifiées des « Africanistes » face aux théories successives auxquelles ils se sont trouvés confrontés depuis plusieurs décennies : subaltern studies, post colonial studies, decolonial studies. L’attention est portée sur les réponses des chercheurs plutôt que sur le détail de ces théories dont, la plupart du temps, ils ne sont pas à l’origine. Dans cette deuxième partie de son article (dont la première partie a été publiée il y a deux semaines dans la lettre de l’Achac), l’autrice rend compte de l’histoire et de la perception des idées postcoloniales en France et en Occident, notamment dans les milieux universitaires.
Reconnaître que le regard de l’ex-colonisateur est insuffisant, et que sans le regard « subalterne » on est condamné à ne pas comprendre, cela avait donc déjà été dit. Mais, pour l’historienne que je suis, la grande différence d’avec les années 1960, qui change tout, c’est que, avec les études postcoloniales arrivant en France au début des années 2000, l’« Autre » a désormais les mêmes pouvoirs que le savant occidental, et revendique son propre regard sans avoir besoin de se le faire expliquer par ses partenaires.
La preuve en fut donnée par les réunions régulières du réseau interafricain CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique) né en 1973 où se retrouvent de nombreux intellectuels africains de stature internationale qui refusaient désormais de se « faire cornaquer » par leurs camarades européens : francophones, anglophones, lusophones, arabophones, venus de partout, en poste aussi bien en Afrique intertropicale qu’en Afrique du Sud, aux États-Unis ou au Canada, ils se retrouvent périodiquement à Dakar. Pour ne parler que des francophones, Achille Mbembe, Mamadou Diouf, Felwine Sarr, Souleymane Bachir Ndiaye, Fatou Sow, et bien d’autres, réceptifs aux « subaltern studies » ont définitivement revendiqué depuis les années 1970-1980 de penser par eux-mêmes, sans pour autant, en qualité d’intellectuels comme les autres qui s’appuient sur des chercheurs africains et non africains, réduire leur propre subjectivité intellectuelle à la seule qualité d’Africain.
Les idées postcoloniales en France
Ces intellectuels de haut vol, qui n’ont pas grand-chose à voir avec les « afrocentristes » tant décriés non sans raison par les historiens français de l’époque[1], ont tôt compris que, aussi lucide et rigoureux soit-on, il est quasi impossible de se défaire de sa propre subjectivité qui relève aussi du point de vue où l’on est situé dans le temps et dans l’espace. Les « subaltern studies » l’ont pourtant enseigné aux anglophones depuis les années 1970. Le résultat s’en est fait sentir nettement plus tard en France : l'histoire dialoguée en Algérie a été introduite par Benjamin Stora et Mohammed Harbi en 2004, et en Afrique au sud du Sahara par un ouvrage collectif sur Le Mali : Histoire partagée de Pierre Boilley (France) et Doulaye Konaté (Mali) en 2005. Cela précédait de cinq ans l’ouvrage de Romain Bertrand, L’histoire à parts égales[2], qui fut une espèce de coup de tonnerre, révélateur tardif de la nécessité de ce que l’on appelle désormais l’histoire connectée.
C’était encore un temps où d’autres chercheurs français sérieux et respectés ne doutaient pas de leur propre regard, allant jusqu’à suggérer que les chercheurs africains (et African Americans) ne feraient que nous imiter maladroitement[3]. Leurs ouvrages par ailleurs pleins d’idées expriment inconsciemment une espèce de mépris pour la parole de l’autre.
L’apport essentiel, vraiment original, des recherches postcoloniales, c’est tout simplement de nous rappeler à l’ordre. « Se mettre à la place de l’autre », en l’occurrence « à la place de l’Africain » est une attitude révolue, trop souvent pratiquée par le savoir anthropologique de naguère. L’important est devenu d’entendre l’autre et d’accepter son point de vue, de dissiper ensemble les malentendus, bref de se défaire de cette morgue du savoir européen héritée du XIXe siècle qui continue de nous coller à la peau, ne serait-ce qu’inconsciemment. C’est ce que Souleymane Béchir Diagne et Jean-Loup Amselle ont tenté dans un livre commun qui rend sensible un désaccord relevant de cette disparité d’appréhension[4]. Le malentendu n’est sans doute pas près de se dissiper entièrement, comme le démontre la mauvaise réception algérienne de la mission récente confiée à Benjamin Stora à propos de la guerre d’Algérie[5].
Le sentiment instinctif de supériorité intellectuelle des Occidentaux, enseigné durant plusieurs siècles, continue d’être prégnant. C’est une attitude concernant surtout l’Afrique au sud du Sahara. Elle est assurément en partie au moins redevable à l’héritage de l’histoire de l’esclavage atlantique, qui a depuis le XVe siècle généré un racisme anti-noir spécifique de l’opinion publique[6]. Certes, les chercheurs ont toujours fait leur possible pour démontrer l’inanité de ces miasmes nauséabonds. Mais le poids inconscient de cet héritage douloureux est tenace. C’est aujourd’hui, avec les générations montantes, que ces réflexes intimes commencent à se dissiper, même si nos auteurs français continuent de ne s’intéresser qu’insuffisamment aux centres de réflexion mis en place en Afrique, au premier chef, outre CODESRIA déjà évoqué, les Ateliers de la pensée.
Montés depuis 2016 à Saint-Louis du Sénégal par le philosophe Felwine Sarr avec Achille Mbembe, ils constituent une « plateforme qui fait circuler les savoirs parce que les gens viennent de l’Afrique, des diasporas et du monde entier pour venir réfléchir à des problématiques du continent et du monde[7] ».
Les enjeux au sein du monde de la recherche
Il y a une génération, la recherche française était encore peu consciente de la maturité pourtant évidente d’intellectuels africains. L’un des rares vraiment reconnu (à juste titre) fut le philosophe anthropologue Harris Memel-Foté[8]. Or la revue Présence africaine avait été créée en 1947 par le Sénégalais Alioune Diop. Si l’on excepte les ouvrages pionniers du géographe Jean Suret-Canale[9], la première Histoire générale de l’Afrique noire vraiment digne de ce nom fut publiée en français par le Voltaïque (aujourd’hui Burkinabe) Joseph Ki-Zerbo en 1972[10]. Curieusement, ce sont deux historiens sénégalais en poste dans des universités américaines, Mohamed Mbodj et Mamadou Diouf, qui rendirent accessibles aux historiens français de l’Afrique les idées postcoloniales en France. Le premier le fit en conclusion d’un recueil d’articles rédigés par des jeunes chercheurs africains en poste dans leurs universités parus dans la revue semi confidentielle du laboratoire « Tiers-Mondes, Afrique » de l’université Paris-7.
C’étaient des études sérieuses mais dans l’ensemble conventionnelles, marquées par l’enseignement classique reçu dans leurs universités africaines ; il fallait leur faire connaître les nouveaux courants de la recherche à une époque où très peu d’entre eux avaient alors la possibilité de sortir de leur université. Mohamed Mbodj, qui enseignait aux États-Unis, rédigea une conclusion constructive, quelques pages précises sur le mouvement postcolonial américain en train de prendre son essor. L’année suivante paraissaient les traductions, sous l’égide de Mamadou Diouf, alors à l’université du Michigan, de quelques-uns des textes majeurs des subaltern studies[11]. Le sujet était enfin introduit en France chez les historiens de l’Afrique.
Néanmoins, les « postcolonial studies » furent dans l’ensemble mal reçues par les chercheurs et le rejet fut durable jusqu’au début des années 2010, comme le confirme la critique constructive qu’en fit en 2012 l’historien Nicolas Bancel[12]. Auparavant, les historiens n’étaient guère intervenus dans le débat, car la méthode historique a peu à voir avec l’esprit théorisant des autres sciences sociales en cause, aussi bien en sociologie qu’en économie ou en sciences politiques, ce qui peut expliquer pourquoi la majorité des historiens spécialisés ont peu réagi sur la question postcoloniale. En 2006, l’historien italien Giovanni Levi remarque : « en tant qu’historien, je note avec intérêt l’absence des postcolonial studies dans le champ de l’histoire[13] ». Non que les historiens ne travaillent pas sur la situation coloniale ou postcoloniale, mais « la philosophie de ces postcolonial studies est difficile à digérer pour [eux][14] ».
Il faut attendre 2011 pour que la question soit examinée calmement[15]. Pourtant, « l’histoire par le bas » était devenue populaire depuis l’ouvrage alors novateur de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français (1966) qui pour la première fois effaçait l’approche du XVIIe siècle par le Roi-Soleil au profit des sans nom et des sans-grades, bien éloignée de l'histoire classique. Il suffisait d’appliquer le même principe à l’histoire africaine sous la colonisation, consistant désormais, aux antipodes de l’histoire de l’épopée coloniale, à s’interroger sur l’histoire des colonisés à partir de leur vécu. Les historiens de l’Afrique avaient commencé à le faire depuis un moment.
Les post colonial studies légitimaient leur pratique, en démontrant qu’il fallait pour cela se dégager de la colonial library dénoncée par V. Mudimbe en réinterprétant des sources certes utiles et même nécessaires, mais jusqu’alors utilisées surtout pour écrire l’histoire des colonisateurs. Le blocage des « africanistes » français s’exprima en 2006 lors d’un colloque organisé sur le sujet à l’Institut d’études politiques[16]. Ainsi, Jean-François Bayart raye d’un trait de plume les pistes postcoloniales comme inutiles et superflues[17], et « politiquement dangereuses[18] ». Jean-Loup Amselle raille les « postcolonial studies[comme] l’idéologie des intellectuels du Sud confortablement installés dans les universités américaines » — ce qui ne manque pas de sel vu d’une chaire de l’EHESS, moins inconfortable au demeurant que les universités des tiers et quart mondes[19].
Romain Bertrand était plus nuancé (il fut le premier à modifier son avis) mais alors peu optimiste sur le succès en France des idées postcoloniales et attentif à épingler, non sans raison mais sans précision, toutes « les erreurs de méthode » de « certains auteurs […] dont certains d’entre eux écrivent ceci ou cela[20] ». D’une façon générale, le motif principal de refus reposait sur un malentendu : parler aujourd’hui de postcolonial serait le fait de faire durer le moment colonial jusqu’au présent, ce qui lui donnerait une vertu explicative trop déterminante : or il ne s’agit pas de prolonger le colonial (même si bien entendu la tendance existe aussi, parfois tenace en Afrique, mais on n’a pas besoin d’être « post colonial » pour cela). Il s’agit d’être attentif à remettre en cause, pour étudier la colonisation, des concepts forgés par des siècles de « colonial library ».
Ce malentendu révèle inconsciemment le réflexe français de défendre, face aux dominés, le droit à la parole des occidentaux. Bref, nos anciens se trouvèrent en « situation coloniale », selon le mot de Georges Balandier dont l’article portant ce titre fit date en 1951[21], puis en situation de décolonisation puis de « néocolonialisme » (selon le mot de Nkrumah, alors président du Ghana, désignant les dix premières années d’indépendance). Nous sommes passés en « situation postcoloniale »[22].
L’enjeu, aujourd’hui comme hier, demeure d’innover, en produisant de nouvelles analyses suggérées ou confirmées par de nouvelles théories. Georges Balandier fut un indéniable précurseur. Et il fut le premier à rétorquer en 2006 à Jean-François Bayart, en réponse un peu interloquée au rejet virulent du « postcolonial » par son ancien disciple, que « les hommes ont plus à produire leurs vies, leurs cultures, leurs significations qu’ils ont à en être les passifs héritiers : il y a toujours un combat pour "créer de l’actuel" autrement[23] ». Il était merveilleux que ce grand aîné continuât de s’en réjouir. C’est ce que vient de redire Élisabeth Roudinesco : « Nul ne doit répéter comme un perroquet l’enseignement d’un maître. Il faut toujours déconstruire ce dont on hérite afin de réinventer une pensée pour mieux comprendre l’avenir[24] ».
Sociologues et philosophes français de gauche reprochaient surtout aux études postcoloniales américaines leurs préjugés antimarxistes parfois affirmés. Bayart, Lacoste, ou Amselle n’avaient pas de limite injurieuse à l’égard de ces idées au nom de ce qui semble (surtout chez Amselle) un marxisme puriste un peu dépassé ; nous eûmes des échanges assez vifs sur le sujet. Pour la même raison, un peu plus tard, en 2007, les jeunes collègues du CVUH (Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire) discutèrent un chapitre de ma part sur les postcolonial studies qui pour eux incarnaient le diable libéral[25]. Les historiens ne sont pour la plupart ni des littéraires, ni des philosophes. Ce sont en bonne part des esprits pragmatiques et expérimentaux, même si aujourd’hui une tendance historique réflexive n’est pas nécessairement d’accord avec cette vision des choses.
Ecrits postcoloniaux et connaissance
À ce titre, les écrits postcoloniaux, pour beaucoup d’historiens dont je suis, ne sont à considérer ni comme des lois, ni comme des débats abstraits. Nous éprouvons sans doute moins que d’autres chercheurs en sciences sociales le besoin de s’écharper sur des divergences théoriques. L’histoire demeure surtout une pratique qui va utiliser comme telle ce qu’on peut considérer comme une boîte à outils utile et parfois nécessaire parce qu’ils confirment la nécessité de concevoir une histoire repensée de façon comparée, à la fois multiple, connectée et partagée. Les historiens de l’Afrique l’ont désormais compris pour la plupart : le savoir n’est efficace que s’il est internationalement échangé et discuté entre chercheurs de toute provenance, de toute culture et de toutes langues, de façon en sus interdisciplinaire. De ce point de vue, les acquis scientifiques contemporains sont formidablement enrichis, entre autres, par la rapidité offerte par les nouvelles technologies informatisées de l’information et de la communication. Dans ce cadre novateur, on ne peut faire l’économie de l’apport des idées dites postcoloniales, comme l’ont montré toute une série de chercheurs auxquels je renvoie[26].
Et moins encore de ce qui aujourd’hui a enflammé les esprits : le décolonial, qui a succédé au postcolonial, ce dernier que l’on croyait aujourd’hui intégrer tant il était entré dans les mœurs. Encore que ! Une tribune trainant dans la boue les universitaires postcoloniaux est encore parue en 2019, signée de noms respectables et polémiques[27].
Les idées décoloniales
La bataille renaît sous une autre forme : la lutte de nombreux chercheurs français, africanistes ou non, de gauche comme de droite, contre le décolonial, concept importé cette fois-ci d’Amérique latine, les chercheurs latino-américains souhaitant se démarquer de l’emprise conceptuelle nord-américaine. Non sans raison : car une des complexités de la pensée décoloniale est de montrer qu’on peut être descendant de colonisés, mais aussi colonisateur : c’est le cas en Amérique du Sud entre Blancs/Noirs vs Amérindiens. Je n’entrerai pas dans le détail de la pensée décoloniale qui, comme la pensée postcoloniale, a donné naissance à une série de courants souvent bavards nourrissant les tenants et les aboutissants d’un débat épistémologique, théorique et méthodologique qui se situe au-delà de mes compétences, je ne suis pas philosophe.
La théorie bouleverse l’appréhension marxiste classique du capitalisme comme système de domination simultanément politique, économique et culturel en ajoutant au prisme des classes sociales deux autres facteurs : le « genre » et la « race ».
Le « genre » et la « race »
Le malentendu est profond. Les termes, ou plutôt concepts de « genre » et de « race » ont eu autant l’un que l’autre la plus grande difficulté à être d’abord compris. Ce sont deux mots venus de la langue anglaise, à l’origine aussi mal acceptés l’un que l’autre. On a oublié aujourd’hui que le terme « genre » a été longtemps rejeté en France, aussi bien par les chercheurs que par le grand public. En 2004, quelques membres féminins (minoritaires) du conseil scientifique des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois ont proposé comme thème de l’année « Le genre », en l’honneur des travaux novateurs de Michelle Perrot.
Les membres masculins se sont récriés avec une virulence certaine que personne n’y comprendrait rien ; on s’était donc s’est rabattu sur le titre rassurant d’Histoire des femmes jugé plus intelligible, tant l’idée de « genre » demeurait inconnue, sinon comme règle grammaticale du masculin et du féminin. Depuis, le terme a trouvé sa place : le sexe est biologique, le genre est social. Pour le terme de « race », nous en sommes aujourd’hui un peu au même point, dans le grand public autant que chez la plupart des chercheurs, avec une difficulté complémentaire : le terme est évidemment connoté, surtout en France depuis la Shoah : les « races » humaines n’existent pas, ceci est démontré scientifiquement depuis un siècle, même si cette croyance a fait florès au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Tout le monde le sait – sauf les racistes et les négationnistes. Le problème est que la réflexion scientifique est d’abord née aux États-Unis autour du même mot, « race », qui est resté en usage en anglais non pas nécessairement avec un sens raciste, mais comme un instrument statistique comptable, il est vrai dans des pays (les États-Unis et l’Afrique du Sud) où le racisme a sévi tardivement (l’émancipation des noirs américains remonte à 1963 et celle des noirs d’Afrique du Sud à 1990).
On doit encore dans ces pays déclarer la « race » de son enfant quand on l’inscrit à l’école, même si la différence est théoriquement de taille : chaque individu décide désormais lui-même de quelle race il ou elle est. On peut être noir et se déclarer blanc, ou vice versa… Bref la tension autour du mot existe toujours, mais de façon moins viscérale qu’en France où utiliser le mot « race » équivaut à une déclaration de racisme. C’est un énorme malentendu qui mine toutes les discussions, publiques, médiatiques, et scientifiques. Car le racisme existe bel et bien, il aurait même tendance à prospérer. Qui dit racisme sous-tend l’idée derace. La race n’existe pas, mais le concept de « race », lui, existe et à ce titre les chercheurs le considèrent comme un objet légitime d’analyse, ne serait-ce que pour en éliminer la puanteur.
C’est sur le genre et la couleur que s’est focalisée la dispute. La querelle a d’abord été animée par les féministes : être femme étant une donnée universelle, différencier les femmes « racisées » par leur couleur ou leur origine ethnique serait un acte raciste. La querelle est repartie avec force en se focalisant sur la « race ». Il serait réducteur d’y voir une opposition classique entre droite et gauche. Le terme race est connoté par tous en français de façon négative. C’est issu des théories racistes développées au XIXe siècle contre la race noire, redoublé au XXe siècle par les horreurs de l’antisémitisme. Vers le milieu du XIXe siècle, la légitimité de l’esclavage noir en Occident était en extinction. Alors comment justifier désormais ce qui apparaissait encore en Europe une évidence « naturelle », l’infériorité noire établie par la « bibliothèque coloniale » ?
La réponse fut l’essor du « racisme scientifique » né dans la deuxième moitié de XVIIIe siècle, devenu quasi la doxa à la fin du XIXe siècle et désormais précisément étudié par les historiens : les êtres humains relevaient de plusieurs races, la supérieure était la blanche et la pire était la noire[28]. Depuis l’essor de la génétique à partir des années 1920, il a pourtant été scientifiquement démontré que le concept de race est inepte chez les humains, l’espèce humaine est unique et interchangeable. Le mot race est en français devenu une injure. Comme on l’a déjà souligné, ce n’est pas le cas en langue anglaise pour des raisons historiques complexes, où « race » a plutôt pris le sens « d’origine ethnique » ; certes, cette notion est discutable, au moins en principe n’est-elle ni injurieuse ni méprisante.
Compte tenu de l’anglomanie internationale, les spécialistes de langue française se plient à cet anglicisme. Mais beaucoup de citoyens français demeurent rétifs à ce vocable : pour eux, parler de « race », c’est être raciste. D’où ce résultat surprenant : la notion de « classe », intellectuellement dominante dans les études imprégnées de marxisme des années 1960-80, avait servi de repoussoir aux approches subalternistes de la fin du siècle dernier. Maintenant que le marxisme ne représente plus une menace, la « classe » est reprise par tous les opposants au décolonial comme le paradigme essentiel voire unique de l’analyse sociale. Le plus curieux de l’affaire, c’est que les « universalistes », qui refusent tout critère d’analyse autre que la « classe », ont été pour un certain nombre d’entre eux communistes dans leur jeunesse militante dans les années 1945-1960, où c’était une forme privilégiée de révolte ; ils avaient ensuite rejeté avec horreur et non sans raison, à la suite du drame stalinien, ces « erreurs de jeunesse ». Ils revendiquent aujourd’hui, au nom de l’universalisme, l’exclusivité du concept marxiste de « lutte des classes » : tenir compte du genre et de la « race » serait faire du « communautarisme » à l’américaine.
Le faux-sens initial dû à une déficience analytique a contribué à rendre la discussion quasiment impossible et les échanges des adversaires autant de déclarations de guerre. Ce sont ainsi succédées des tribunes violemment contradictoires dans les grands journaux et périodiques d’information (Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Express, Marianne, et j’en passe) où les intellectuels, souvent universitaires, en appellent à l’opinion publique pour exprimer leurs désaccords. Successivement les « intellectuels », les femmes, les psychologues, les philosophes y sont allés de leurs déclarations plus péremptoires les unes que les autres, dénotant surtout la volonté de ne pas comprendre les raisons de l’autre[29].
Le plus intéressant est sans doute que, bien qu’avec des nuances importantes, les clivages ne recoupent que partiellement les opinions politiques des signataires, globalement « de droite » ou « de gauche », ce que révèle parfois des alliances improbables (comme par exemple entre Alain Finkelkraut et Élisabeth Badinter).
Classe et intersectionnalité
À l’origine, les descendants de colonisés, qui se disent « racisés » surtout s’ils sont de couleur (qualificatif récusé par leurs adversaires qui l’interprètent comme un terme raciste), reprochent donc à l’histoire sociale de ne privilégier que le concept de classe, aux dépens de ceux de genre et de « race » (prononcée « resse » et entendue au sens américain du terme, c’est-à-dire, comme l’exprime W.E.B. Du Bois dès 1899, comme la configuration de relations de pouvoir inégales[30]). Pour les chercheurs décoloniaux, cela paraît une évidence expérimentale : à niveau de revenu équivalent, une jeune fille noire au nom exotique peut avoir plus de mal à se trouver une place dans la société qu’un jeune homme blanc « bien de chez nous ».
Proposer le croisement des rapports de domination ne signifie pas refuser de les hiérarchiser. On confond multiculturalisme à la française, qui est une richesse culturelle évidente, et « communautarisme », qui signifie s’enfermer dans sa culture en rejetant les autres. « Genre » et « race » jouent leur rôle dans la sélection de classe. Croiser ces données permet de comprendre la complexité, plutôt que d’en privilégier une seule en excluant les autres de l’analyse. C’est ce que les tenants sérieux du « décolonial » (car il y a ceux qui ne parlent que de « race » comme ceux qui ne parlent que de « classe ») suggèrent sous le terme de « convergence » et d’intersectionnalité[31]. Ce terme souligne une des idée-force du décolonialisme : la complexité sociale, qui ne peut être réduite à une seule catégorie d’analyse[32]. C’est évidemment plus sage que ce que proclament les inconditionnels du facteur racial « identitaire ». Je ne développe pas plus avant cette critique, que j’ai exprimée naguère dans un autre article[33] : la couleur n’explique pas tout, la classe sociale n’explique pas tout, et le genre non plus.
Ces explosions irrationnelles ont culminé ces temps-ci dans les délires sur le wokisme (qui a vite fait de remplacer ceux sur l’islamo gauchisme déjà passé de mode tant le mot supposé rassembleur s’est avéré vide de sens). Le wokisme apparaît comme le sommet de la confusion par négation de la complexité ; ces élucubrations transformées en épouvantail par des politiques dont certains s’improvisent théoriciens du n’importe quoi[34] ne font que traduire la méconnaissance d’une intelligentzia parisienne souvent peu au fait des réalités africaines. Ce n’est pas sa faute : l’histoire africaine, encore très insuffisamment enseignée, reste quasi inconnue pour la grande majorité des Français, y compris « racisés ». On souhaiterait renvoyer nos néo-théoriciens à quelques ouvrages qui pourraient les éclairer sur l’inanité des lieux communs encore si généralisés sur l’Afrique, afin qu’une discussion scientifique de qualité s’organise[35]. Dès lors que le débat s’ouvre, la vivacité des réactions peut s’atténuer, car elles révèlent non pas une « vérité », mais une position, voire une idéologie politique.
Quitte à me répéter, je terminerai donc par une profession de foi d’historienne : l’histoire est une science fondée sur l’observation et l’interprétation. Pour l’historien, les théories sont plutôt des boites à outils dont on n’est pas obligé de tout utiliser, mais pas non plus de tout rejeter par principe (aussi bien pour les théories dites de la dépendance que des théories dites post- ou décoloniales, ou « universelles »). Bien sûr, écrire l’histoire contemporaine demeure, qu’on le veuille ou non, « une question politique et militante[36]», autrement dit la subjectivité de l’auteur influence implacablement ses raisonnements.
Ce qui anime cet article est un engagement fondamental contre le racisme. C’est pourquoi les excès des débats entre blancs et noirs sont exaspérants, aussi bien chez les uns que chez les autres. Les races n’existent que dans la tête des gens, mais ce sont des héritages enracinés dans l’histoire qui génèrent le racisme, qui est hélas une des choses du monde les mieux partagées. Pourquoi la grande majorité (blanche) des Français n’arrive-t-elle pas à ressentir qu’être noir en France c’est, comme l’a expliqué Pap Ndiaye, une « condition » inconfortable, parce que minoritaire et terriblement visible ? Un noir en France ne peut pas ignorer qu’il est noir. Un blanc n’est pas renvoyé à sa couleur (pas plus qu’un noir ne l’est en Afrique). La personne noire n’est pas racisée, mais elle se sent racisée. C’est aussi simple que cela[37] : un énorme malentendu.
Alors, pour une historienne observatrice du réel, il y a à prendre et à laisser dans des théories qui s’affrontent si brutalement. Ce qui prime, c’est le va-et-vient permanent entre théorie, pratique et empirisme, ce qui permet aussi à l’imagination créatrice maîtrisée de prendre son envol. Ces allers-retours sont indispensables pour renouveler les interprétations tout en avançant dans les connaissances. Les générations, même si parfois elles paraissent se répéter, en fait se succèdent et se complètent, et souvent enrichissent de façon originale des idées déjà apparues sous des formes moins achevées dans une autre génération, et qu’elles sont en train de refonder.
Cela permet chaque fois d’avancer un peu plus avant dans la réflexion. L’essentiel demeure de rester sensible à la complexité de l’histoire, de ne pas rigidifier les positions : il faut savoir « résister à la tyrannie de l’un au profit du multiple, ou inversement : ne pas fétichiser l’universel au détriment de la différence, ni la différence au détriment de l’universel [38]». Et surtout comprendre une fois pour toutes que l’« universel » n’est pas occidental. Il est… universel.
[1] Jean-Pierre Chrétien, François-Xavier Fauvelle et Claude-Hélène Perrot (éds), Afrocentrismes, L'histoire des Africains entre Égypte et Amérique, Paris, Karthala, 2000.
[2] Romain Bertrand, L'Histoire à parts égales : récits d'une rencontre Orient-Occident, Paris, Le Seuil, 2011.
[3] Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock, 2008 ; Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010 ; Yves Lacoste, La question post-coloniale : une analyse géopolitique, Paris, Fayard, 2010.
[4] Souleymane Béchir Diagne et Jean-Loup Amselle, En quête d’Afrique(s) : Universalisme et pensée décoloniale, Paris, Éditions Albin Michel, 2018.
[5] Benjamin Stora, France-Algérie. Les passions douloureuses, Paris, Albin Michel, 2021. La question est complexe car, d’une part, l’effort est unilatéral, et d’autre part et surtout, les facteurs politiques et mémoriels interfèrent lourdement avec la recherche historique.
[6] Sur l’histoire du racisme anti-noir, aujourd’hui les études se multiplient. Pour un essai de synthèse, voir Catherine Coquery-Vidrovitch, Les routes de l’esclavage africain, du 6e au 20e siècle, Paris, Albin Michel, 2018. Récemment : Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe – XXe siècles, Paris, La Découverte, 2021.
[7] Felwine Sarr, « Pourquoi j’ai quitté l’UGB pour rejoindre Duke University », Le Soleil, 28 août 2020.
[8] Harris Memel-Foté (1930-2008). Il fut Directeur d'Étude associé à l'École des hautes études en sciences sociales (1978-1979 et 1991), et titulaire d’une chaire internationale du Collège de France (1995-1996). Il donna une conférence mémorable à l’EHESS sur les « Pères fondateurs » de l’indépendance. Mais sa thèse d’État, L'esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne, XVIIe–XXe siècle, fut pratiquement ignorée jusqu’à sa publication vingt ans après (Éditions du CERAP et IRD, 2007), ce qui révèle le manque d’attention qui fut portée sur un sujet alors négligé.
[9] Jean Suret-Canale, Afrique noire occidentale et centrale, Tome 1, Paris, Les Éditions sociales, 1958. Tome 2, L’ère coloniale 1900-1940, Paris, 1964.
[10] Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire : d'hier à demain, Paris, Hatier, 1972 et 1978.
[11] Mamadou Diouf (éd.) ; L'historiographie indienne en débat : colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales, Paris, Karthala/ Amsterdam, SEPHIS, 1999.
[12] Nicolas Bancel, « Vertus et déraisons de l'accueil critique des Postcolonial Studies en France », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 115, 2012/3, p. 129-147.
[13] Giovanni Levi, « Entre pétulance désastreuse et humilité pénible », in Marie-Claude Smouts (dir.), La situation postcoloniale, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, p. 262.
[14] Giovanni Levi, Ibid. in Marie-Claude Smouts, op. cit., p. 262
[15] Jean-Pierre Rioux, La France coloniale sans fard ni déni, Paris, André Versaille Editions., 2011.
[16] Marie-Claude Smouts (sous la dir. de), op.cit. [en écho de l’article fondateur de Georges Balandier sur « la situation coloniale », Cahiers internationaux de Sociologie, n°11, 1951, pp. 44-79].
[17] « Dans leur utilité, les postcolonial studies sont largement superflues », Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010, p. 41.
[18] Marie-Claude Smouts, op.cit.
[19] « Bouillon de culture », France Culture, 6 février 2007. Cf Amselle, L'Occident décroché, op.cit.
[20] Romain Bertrand, « Faire parler les subalternes ou le mythe du dévoilement », in Marie-Claude Smouts, op.cit., pp. 276-284. Voir aussi, du même : Mémoires d’empire : La controverse autour du « fait colonial », Paris, Éditions du Croquant, 2006.
[21] Georges Balandier, « La situation coloniale », op.cit.
[22] Marie-Claude Smouts (sous la dir. de), La situation postcoloniale, op.cit.
[23] Georges Balandier, discussion, in La situation postcoloniale, op.cit., pp. 274-275.
[24] Élisabeth Roudinesco, « Déconstruction », Le Monde, 20 mai 2021, p. 30.
[25] Catherine Coquery-Vidrovitch, Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille, Agone, 2007.
[26] Cf. Mamadou Diouf, « Les études postcoloniales à l’épreuve des traditions intellectuelles et des banlieues françaises », Contretemps, n° 16, avril 2006, pp. 17-30 ; « Pour comprendre la pensée postcoloniale », numéro spécial, Esprit, n° 330, décembre 2006 ; Achille Mbembe, entretien in « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », Esprit, n° 330, 2006, p. 131 ; « Qui a peur du postcolonial ? Dénis et controverses », n° spécial Mouvements, octobre 2007.
Sur la pensée postcoloniale anglophone : Jacques Pouchepadass, « Que reste-t-il des subaltern studies ? », Critique internationale, n° 24, 2004, pp. 67-80 ; Romain Bertrand, « Habermas au Bengale, ou comment “provincialiser l’Europe” », Travaux de science politique, Université de Lausanne, n° 40, 2009, pp. 3-25 ; Marie-Claude Smouts (dir.), op.cit.
[27] Tribune « Les bonimenteurs du postcolonial business en quête de respectabilité académique », Texte collectif, publié le 26/12/2019 dans L’Express.Commentaire du journal :
« Les auteurs de cette tribune craignent l'institutionnalisation des "études postcoloniales" qu'ils jugent scientifiquement peu sérieuses et obsédées par le colonialisme. Texte signé par Laurent Bouvet (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Nathalie Heinich (CNRS), Isabelle de Mecquenem (université de Reims), Dominique Schnapper (EHESS), Pierre-André Taguieff (CNRS), Véronique Taquin (professeur de khâgne) ». Pascal Blanchard et Nicolas Bancel y répondent dans leur tribune « La fabrique du dénigrement – sur le postcolonial (1/3) », publiée le 7 octobre 2023 dans AOC.
[28] Un résumé de ces thèses dans Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le postulat de la supériorité blanche et de l’infériorité noire », Le livre noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance (Marc Ferro éd.), Paris, Robert Laffont, 2003, pp.646-685. Voir surtout Peiretti-Courtis, op. cit, 2021.
[29] Voir le détail de ces tribunes, assez nombreuses depuis 2018, comme Catherine Coquery-Vidrovitch, « Cheikh Anta Diop et l’histoire africaine », Le Débat, n° 208, janvier-février, 2020, pp.178-190. Par exemple : « Tribune de « 80 intellectuels » contre la pensée décoloniale », Le Point, 28 novembre 2018. Signé au nom des valeurs républicaines, des Lumières et, curieusement, de la liberté d’expression.
[30] W.E.B. Du Bois, Les noirs de Philadelphie, une étude sociale, (1899), traduit La Découverte, 2019, p.30.
[31] Cf. Ludivine Bantigny, Médiapart, 19 déc. 2018 ; Abdellali Hajjat et Silyane Larcher (eds), Dossier Intersectionnalité, revue Mouvement des idées et des luttes,12 février 2019. Silvia Lippi et Patrice <https://aoc.media/opinion/2019/10/11/mais-que-font-les-psychanalystes> tentent de dépassionner le débat.
[32] Capucine Boidin, « Études décoloniales et postcoloniales dans les débats français », Cahiers des Amériques latines, n° 62, 2009, pp.129-140.
[33] Catherine Coquery-Vidrovitch, « Cheikh Anta Diop et l’histoire africaine » Le Débat, n° 208, 2021, pp.178-190.
[34] Je parle ici des discussions scientifiques en France et n’aborde pas les excès évidents qui peuvent exister aux USA, souvent caractérisés malheureusement par des radicalités issues de la color-bar toujours présente des deux côtés en dépit des lois. Les imiter en France (ce que font certains politiques) tient de l’absurdité.
[35] Hélène d’Almeida-Topor, L'Afrique, Le Cavalier Bleu, coll. « Idées reçues », 2006 ; Georges Courade (ed.), L'Afrique des idées reçues, Paris, Belin, 2016 ; Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Débat, op.cit.
[36] Catherine Coquery-Vidrovitch, « De l’africanisme vu de France. Le point de vue d’une historienne » Le Débat, 2002, n° 118, p.37.
[37] Pap Ndiaye, La condition noire en France, Paris, Calmann Lévy, 2008.
[38] Élisabeth Roudinesco, ibid.
