Féminicides. Une histoire mondiale
Par Christelle Taraud
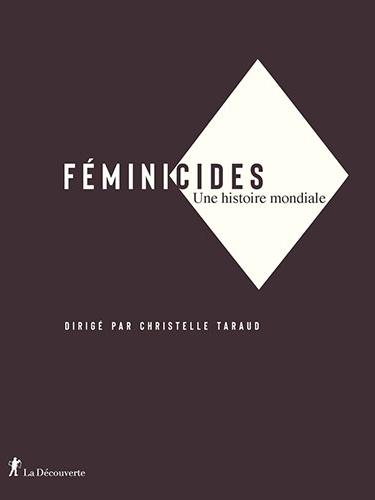
Christelle Taraud est historienne spécialiste de l’histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial. Après avoir co-dirigé avec Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Nicolas Bancel et Dominic Thomas l’ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours (La Découverte, 2018), elle s’intéresse dans son nouvel ouvrage Féminicides. Une histoire mondiale (La Découverte, 2022) à une autre forme de domination à travers l’étude de l’ensemble des violences faites aux femmes. Avec les contributions des meilleurs spécialistes, d’œuvres et d’archives, et dans le sillon d’une étude à la fois mondiale et historique remontant à la préhistoire, elle dénonce le système patriarcal qui favorise la domination masculine et prône l’inclusion et l’égalité. Elle partage ici l’introduction de l’ouvrage.
Le féminicide n’est pas une anomalie. Il est le symbole d’un système de domination très ancien qui repose sur la banalité, mais aussi l’impunité, des violences faites aux femmes et des crimes de haine à caractère sexiste perpétrés contre elles. Ainsi, comme le souligne la poétesse et anthropologue nigériane Ifi Amadiume, « la tolérance au sexisme et aux comportements machistes, y compris par les femmes elles-mêmes, est sans commune mesure avec d’autres formes de discriminations ». Ces discriminations genrées ne recouvrent pas uniquement les préjugés sur les femmes et les conditions socioéconomiques inégalitaires qu’elles subissent, ce que l’on constate presque partout et à toutes les époques, mais forment un système de violences si ancré, si incorporé, si intégré, aussi bien individuellement que collectivement, qu’il finit par être transparent, impensé, tabou.
Une histoire mondiale des féminicides : pour quoi faire ?
Ce système, c’est le patriarcat. Associé au capitalisme et au (néo)colonialisme avec lesquels il fait corps, il trouve sa plus parfaite expression dans le crime de féminicide qui s’assure, par la spectacularisation dont il s’accompagne souvent, de remettre les femmes à leur juste place : celle de corps exploitables, au mieux, sacrifiables, au pire, comme le démontrent les chercheuses féministes Julia Monárrez Fragoso et Melissa W. Wright. Ainsi, dans nombre de pays, les chiffres des féminicides sont terribles.
Selon l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC), 47 000 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou un membre de leur famille en 2020 : une toutes les onze minutes. Sur le continent américain où la pandémie de féminicides est apparue très précocement, nombre d’études et de statistiques traduisent aujourd’hui l’ampleur du désastre. Au Brésil, au moins 106 093 femmes en ont été victimes entre 1980 et 2013. Au Mexique, en 2020, 10 femmes meurent chaque jour, victimes de la violence machiste et, entre 2009 et 2019, 23 800 femmes en seraient décédées. En 2016, selon une étude officielle mexicaine, 42 % des victimes avaient moins de trente ans, ce qui correspond aussi à la classe d’âge de la majorité des ouvrières des maquiladoras (les usines de sous-traitance). En 2016, un rapport de l’agence des Nations unies pour les femmes mentionne que, toujours dans le même pays, seuls 10 % des féminicides ont fait l’objet d’une condamnation pénale. En 2011, une étude de l’Instituto nacional de estadística y geografía (Inegi) réalisée à partir d’un échantillon de femmes de plus de quinze ans signale que 45 % des Mexicaines ont vécu au moins un épisode violent dans leur vie conjugale, plus de 11 % de ces épisodes impliquant des violences sexuelles. En mai 2014, un rapport de la gendarmerie royale du Canada comptabilise quant à lui 1 017 femmes autochtones assassinées et 164 disparues entre 1980 et 2012. Les femmes natives représentent 23 % des victimes de meurtres du pays pour la seule année 2012 (contre 4 % pour la population féminine globale) ; des crimes dont le caractère sexuel est généralement attesté. Dans neuf cas sur dix, la femme tuée connaissait son agresseur et elle se trouvait même parfois dans une relation de confiance avec lui. Amnesty International souligne cependant dans un rapport de 2015 que lorsque les femmes pauvres et indigènes sont assassinées, elles ont 3,5 fois plus de risques d’être tuées par un membre de leur famille et 7 fois plus par un inconnu par rapport aux autres femmes canadiennes.
En Europe, de même, les chiffres sont effarants. Ainsi, en Italie par exemple, 3 000 femmes ont été assassinées entre 2000 et 2019. Pour la seule année 2016, une femme tous les trois jours en moyenne est victime de féminicide, dans un pays où l’abolition du crime d’honneur et du mariage réparateur ne remonte qu’à 1981. En 2017, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) référençait 6 788 000 Italiennes âgées de seize à soixante-dix ans ayant déclaré avoir subi dans leur vie, au sein de leur famille et le plus souvent par leur partenaire, une forme de violence que celle-ci soit physique ou sexuelle. Un rapport de l’institut Eures concernant les féminicides, entendus comme des « homicides volontaires dont les victimes sont des femmes », souligne qu’entre 2010 et 2014 2 587 individus ont été tués en Italie dont 1 768 (68,3 %) étaient des hommes et 819 (31,7 %) des femmes. Parmi celles-ci – dont l’âge moyen était de cinquante ans – 77 % furent assassinées par un membre du cercle familial, le plus souvent par armes blanches ou à feu. Dans 192 cas (23,4 % du total), il s’agissait d’étrangères. Les enquêteurs ont comptabilisé 393 (48 %) féminicides conjugaux, dont 106 (27 %) du fait d’un ex-conjoint, auxquels il faut ajouter les 80 (9,8 %) mères tuées par leurs enfants et les 44 (5,4%) filles assassinées par leurs parents. En Espagne, a contrario, les féminicides ont baissé de 25 % au cours des dix-huit dernières années grâce à l’activisme des associations féministes qui a mené à la promulgation d’une loi-cadre sur les violences conjugales en 2004, à la dotation d’un fonds d’un milliard d’euros sur cinq ans (2018-2022) permettant de lutter contre ces mêmes violences ainsi qu’à la mise en place de tribunaux dédiés, à la formation de policiers et de magistrats spécialisés, et à de nombreuses autres mesures dont l’objectif est de prévenir les féminicides et de protéger les victimes. Si l’Espagne fait régulièrement figure de modèle en matière de lutte contre les violences de genre, des critiques se font entendre quant au caractère très punitif du nouvel arsenal juridique espagnol et les avancées restent fragiles, comme en témoignent la recrudescence de féminicides qu’a connue le pays au sortir des confinements liés à la pandémie de Covid-19 ou encore la virulence des nombreux opposants aux mesures en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
En France, enfin, et ce malgré l’adoption de la loi Égalité et Citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui fait de l’identité de genre « une circonstance aggravante du crime commis contre une femme », les féminicides restent terriblement hauts, deux fois plus qu’en Espagne. Associée aux cinq plans interministériels contre les violences faites aux femmes, particulièrement au sein du couple et si la femme est enceinte (une autre circonstance aggravante), une nouvelle politique se déploie depuis 2006 au travers de huit lois. Malgré cela, en 2012, 166 femmes ont succombé sous les coups de leurs (ex-)conjoints. En 2017, elles étaient 109, dont 30 % avaient été victimes de violences avant l’assassinat lui-même, 3 % d’entre elles étant déjà connues des services de police ou de gendarmerie au moment des faits, certaines ayant même déposé une main courante ou une plainte. Et, « selon un récent bilan du ministère de l’Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux en 2019, et 102 en 2020 ». En 2021, elles furent 113. En 2022, au moment même où ces lignes sont écrites, elles sont déjà 34… Statistiquement, « une femme est tuée en France tous les trois jours par son (ex-)conjoint, tandis que les violences conjugales touchent 220 000 Françaises chaque année ».
Ces mêmes statistiques montrent, de surcroît, que le moment le plus dangereux pour une victime de féminicide est souvent celui où elle se sépare du partenaire violent : « Le contexte de fin de relation est en effet le premier facteur de féminicides en France. » Les hommes tuent les femmes qui veulent partir parce qu’ils considèrent celles-ci comme des objets leur appartenant qu’ils ont le droit de contrôler, de surveiller et de punir – « C’était sa chose », peut-on entendre dans le documentaire de Lorraine de Foucher et Jérémy Frey Féminicides, présenté le 2 juin 2020 sur France 2. Le féminicide est donc bien d’abord un « crime de propriétaire », comme l’a démontré l’historienne féministe italienne Silvia Federici, mais c’est aussi une manifestation paradigmatique de pouvoir ; du pouvoir des hommes sur les femmes, que celui-ci se manifeste par la violence physique et sexuelle ou bien par l’emprise psychologique.
De l’usage des termes
Si l’usage du terme « féminicide » s’est généralisé et globalisé depuis une dizaine d’années au moins pour désigner tout « meurtre de femme parce qu’elle est une femme », ce mot n’a pourtant pas l’exclusive de la représentation du phénomène. Ainsi au cours de l’histoire humaine et à l’échelle planétaire, plusieurs termes – uxoricide, conjuguicide, gynogide, sexocide, fémicide, gendercide… – ont-ils pu éclairer la réalité polymorphe d’un crime sexo-spécifique extrêmement ancien. Cette diversité d’approches, aujourd’hui globalement arasée, notamment dans l’opinion publique mondiale qui s’est emparée du seul terme de féminicide, se devait pourtant d’être présente dans cette histoire mondiale des féminicides car l’utilisation de ces mots fait encore débat, en particulier chez les spécialistes de la question.
C’est pourquoi le choix qui a été fait dans le cadre de ce livre est de laisser à chaque autrice et auteur le soin d’analyser le phénomène au travers du mot le plus à même de le désigner dans le contexte traité et à l’époque considérée. Car il ne s’agit nullement ici de produire une doxa mais bien de mettre en lumière la diversité des situations et des expériences, y compris par des points de vue contradictoires.
Quant au terme féminicide lui-même – qu’il faut cependant replacer dans une généalogie intellectuelle et politique qui commence par l’invention de celui de « fémicide » par la chercheuse féministe étatsunienne Diana E. H. Russell à la fin des années 1970 –, c’est du fait de son importante popularisation et démocratisation, mais aussi de sa polysémie et de sa plasticité dans le langage commun, que nous l’avons privilégié ici. Car si le concept de féminicide parle aujourd’hui à de nombreuses personnes de par le monde, ce n’est pas parce qu’il serait dépolitisé à cause de son utilisation au sein d’agendas politiques très fortement marqués par un antiféminisme récurrent, y compris dans le monde occidental, processus finalement assez classique lorsque « le combat féministe devient une chose publique ». C’est plutôt parce qu’il raconte une très ancienne histoire trop longtemps ignorée : celle d’un crime enfin reconnu pour ce qu’il est, comme le soulignent Lydie Bodiou et Frédéric Chauvaud dont le travail pionnier participa grandement à cette prise de conscience en France, en particulier avec la publication en 2019 de leur ouvrage collectif On tue une femme. Le féminicide. Histoire et actualités.
La réflexion sur les mots employés amène dès lors à regarder le féminicide autrement que sous l’angle de l’assassinat d’une femme par un (ex-)conjoint, (ex-)compagnon ou (ex-)petit-ami qui est généralement le seul considéré et médiatisé. Car ce que le féminicide matérialise et expose tout à la fois, c’est un crime total perpétré contre les femmes. Un crime dont la dimension universelle, en même temps historique et actuelle, se devait donc d’être traitée non dans sa seule contemporanéité et encore moins dans une unique « aire culturelle », mais à l’échelle de l’histoire du monde. Aussi, à l’opposé d’une lecture réductionniste du crime cantonnant celui-ci à la seule sphère du privé et de l’intime, le continuum féminicidaire qui est éclairé dans ce livre et qui en constitue le cœur devait nécessairement être pensé, analysé et compris dans la très longue durée chronologique, en saisissant les racines du phénomène dès les temps préhistoriques, tout en lui donnant une densité et une épaisseur géographique inédite à ce jour dans le monde académique – à l’aune des cinq continents qui fondent notre monde commun.
Le continuum féminicidaire : qu’est-ce que c’est ?
Au demeurant, nombre d’organisations nationales, régionales et internationales en font aujourd’hui elles-mêmes le banal constat. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît-elle quatre formes de féminicide, qu’elle désigne sous les appellations d’intime, de familial, de communautaire et de sociétal, actant, par là même, que le crime ne peut être réduit aux seuls dysfonctionnements du couple au sein des dynamiques intimes, domestiques et familiales. Or c’est justement cette pluralité de formes et leurs multiples interpénétrations qui constituent ce que j’appelle ici le continuum féminicidaire, c’est-à-dire un agrégat de violences polymorphes, connectées les unes aux autres par des liens subtils et complexes, subies par les femmes de leur naissance à leur mort.
Le meurtre d’une femme par un « partenaire intime » (fémicide) n’est en effet le plus souvent que la dernière étape d’une série d’actes anti-femmes (féminicide) qui inclut, pêle-mêle et sans exhaustivité aucune, le dressage à la féminité (si possible dans un souci de soumission et de passivité) et l’infériorisation systémique du féminin qui présuppose son assujettissement en tant que « second sexe » ; le traitement différencié dans les langues et les langages, et donc à l’école et dans les universités (quand les filles ont le droit d’y aller), mais aussi dans les systèmes politiques (où les femmes, quand elles ont le droit de voter, sont généralement sous-représentées) et religieux (cosmogonies, mythologies, monothéismes…) ; les discriminations économiques essentialisées, particulièrement au sein d’un capitalisme patriarcal prédateur ; le harcèlement sexuel dans les espaces publics (la rue, les transports en commun, les espaces de loisirs, les campus universitaires, les lieux de travail…) ; les humiliations, les insultes et les coups (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace conjugal/familial) ; les mutilations corporelles et sexuelles ; les mariages précoces et/ou forcés, les maternités obligatoires ou au contraire les avortements et les stérilisations forcés, les fœticides ou les infanticides au féminin ; l’humour sexiste et les publicités machistes ; la pornographie straight ; la contrainte à l’hétérosexualité et la lesbophobie ; la prostitution forcée et la putophobie ; l’esclavage sexuel sous toutes ses formes, les abus et les crimes sexuels (y compris la pédophilie et l’inceste qui touchent majoritairement les filles) ; les viols (conjugaux, par des proches ou des étrangers, correctifs, de guerre, génocidaires, de profanation…) et bien sûr, in fine, les assassinats eux-mêmes…
Un continuum féminicidaire qui vise, pour reprendre le titre de l’ouvrage fondateur des chercheuses féministes Rosa Linda Fregoso et Cynthia Bejarano, à « terroriser les femmes », autant réellement que symboliquement, au travers d’une gynophobie banale et banalisée. Ce qui fait dire à la grande écrivaine féministe canadienne Margaret Atwood : « Les hommes ont peur que les femmes se moquent d’eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. »
Lutter contre les crimes sexistes par la sororité
Le féminicide éclaire donc avec force la valeur systémique des inégalités de genre dans les très nombreuses relations de pouvoir asymétriques où la domination masculine reste la norme hégémonique – à l’école, dans la rue, au travail, dans la religion, dans la politique, dans l’art, dans le langage… Il ne s’agit donc pas d’une rupture entre le passé (archaïsme/tradition) et le présent (modernité) de nos sociétés ni d’une assimilation à une vision familialiste et/ou culturaliste, dont les tendances racistes et classistes sont souvent patentes, mais bien d’un système d’écrasement généralisé des femmes par les hommes, du féminin par le masculin, au sein de sociétés encore puissamment machistes et profondément misogynes. Ce qui fait du féminicide, à l’échelle planétaire, un crime individuel autant que collectif et même un crime d’État comme le précise la chercheuse féministe et femme politique mexicaine Marcela Lagarde y de los Ríos. Dans de nombreux endroits du globe, les femmes mettent d’ailleurs aujourd’hui les États devant leurs responsabilités historique et politique : comme les Mexicaines qui dénoncent l’impunité des féminicides de masse commis dans leur pays, en particulier dans la ville de Ciudad Juárez, devenue tristement célèbre sous l’appellation de « cité où l’on tue les femmes », mais aussi comme ce collectif de colleuses féministes françaises qui s’affiche sur les murs de nos villes au travers de phrases coups de poing, l’une d’elles affirmant, en écho aux demandes de reconnaissance et d’action des activistes mexicaines, « aux femmes assassinées, la patrie indifférente »…
Pour autant, le féminicide – qui touche toutes les femmes d’une manière ou d’une autre, du moins dans son acception la plus large privilégiée ici – doit être complexifié du fait de l’existence d’autres formes de discriminations qui sont fondamentales pour analyser et comprendre les spécificités de chaque situation de féminicide dans le monde. Car le crime de genre est souvent corrélé à des inégalités touchant à la classe sociale, à la race, à la confession religieuse, à l’orientation sexuelle, à l’âge… En effet, si toutes les femmes sont discriminées au sein de ce continuum de violences sexistes qui constitue le féminicide, elles ne le sont pas toutes de la même manière et selon le même registre. C’est pourquoi cet ouvrage adopte une approche intersectionnelle et fait une large place aux femmes connaissant – et souvent subissant – des dominations croisées au sein de systèmes patriarcaux se nourrissant les uns les autres.
Au travers de régimes coercitifs/punitifs, qui bien que diversifiés selon les continents et les pays n’en ont pas moins des racines communes, ces systèmes patriarcaux assurent simultanément la mise au pas des femmes et le contrôle strict de leur féminité et de leur sexualité. Ainsi, les femmes pauvres, les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes dérogeantes sont, parce que leurs voix sont généralement déniées, marginalisées et délégitimées, particulièrement présentes dans ce livre. Bâtir un monde où le féminicide serait éradiqué passe en effet nécessairement par la destruction de ce qui, à défaut de le construire ontologiquement, le renforce toujours en exacerbant et maximisant ses effets délétères.
À la pluralité des inégalités – et donc des discriminations – dont certaines se produisent et se répliquent au sein même de la communauté des femmes et des féministes au risque de la fracturer durablement, cette histoire mondiale des féminicides entend répondre par une sororité bienveillante et clairvoyante en réaffirmant l’urgente nécessité d’une union générale de toutes les femmes, dans le respect mutuel de leurs différences, dans leur lutte commune contre le féminicide et les violences de genre, de classe et de race.
Car, et c’est la seule bonne nouvelle dans un contexte où la pandémie féminicidaire mondiale ne cesse de gagner du terrain, la parole se libère et trouve enfin une écoute, en particulier grâce aux réseaux sociaux, et les actions se multiplient, comme ce fut le cas par exemple avec les manifestations de Tel-Aviv le 4 décembre 2018, de Nairobi le 8 mars 2019 et de Johannesburg le 13 septembre 2019. Dans le monde entier des collectifs se forment, actant de la nécessité d’une riposte qui, tout en ayant souvent une base locale, se déploie au sein d’un mouvement féministe post- #MeToo désormais globalisé. L’un des meilleurs exemples de cette lutte du proche aujourd’hui mondiale, qui démontre qu’une sororité féministe horizontale peut exister, est peut-être la chanson Un violador en tu camino du collectif féministe chilien Lastesis, performée pour la première fois le 20 novembre 2019 à Santiago. Quelques jours plus tard, le collectif lance via sa page Instagram un appel mondial à interpréter la chanson, qui devient alors un hymne planétaire (…).
Une histoire des féminicides comme outil de résistance
Pendant longtemps, et encore aujourd’hui, face à la dénégation de l’ancienneté, de la pérennité et de l’ampleur du crime, le travail de nombre de féministes de par le monde fut simplement d’établir des listes pour témoigner de l’existence réelle de ces assassinats, pour incarner les chiffres en visages et en noms, au-delà des statistiques macabres, à l’image des sites français Féminicides par compagnons ou ex (fondé en 2016) et algérien Féminicides Algérie (créé en 2019 par Narimene Mouaci Bahi et Wiame Awres). Cette triste litanie qui nous fait égrener, jour après jour, mois après mois, année après année, le nombre de nos mortes n’est pourtant ni un constat d’échec ni une acceptation tacite de la victimisation des femmes qui se traduirait, un peu partout, par le seul établissement d’un « panthéon mondial des martyres » que nous agiterions tel un hochet à la face de ceux qui décident, en général pour nous.
Car, a contrario, de cette logique victimaire qui continuerait à nous assimiler à l’infantilisation, à la passivité et à la soumission, c’est bien un esprit de résistance qui nous anime et nous porte. C’est une volonté commune de résister ensemble, de faire front entre sœurs, au sein d’une communauté féministe planétaire respectueuse et égalitaire qui pratique activement la solidarité politique : chose que nombre de chercheuses et d’activistes féministes ont appelée de leurs vœux, de l’Africaine-Américaine bell hooks à l’Argentine Verónica Gago. De résister aux féminicides individuels comme aux féminicides de masse. Car si on songe aux 200 millions de filles manquantes sur le continent asiatique du fait des fœticides à vastes échelles qui y ont été organisés depuis le second XXe siècle, on comprend que le féminicide n’est pas seulement un crime individuel mais bien un massacre collectif, à l’échelle de sociétés entières et des États complices qui les couvrent, ce que la journaliste et autrice indienne Gita Aravamudan appelle la « tuerie silencieuse » qui ravage l’Inde aujourd’hui en sus de nombreux autres pays d’Asie.
Ces meurtres de masse n’ont rien à voir, faut-il le rappeler, avec le droit inaliénable des femmes à disposer de leur propre corps, y compris en ayant recours à l’IVG, lui aussi mis à mal dans plusieurs endroits du monde comme la Pologne, où les femmes sont menacées de peines de prison pour « crime d’avortement », et les États-Unis, où la Cour suprême a annulé le 24 juin 2022 l’arrêt Roe v. Wade datant de 1973. Les fœticides, ces crimes commis avant même que les filles ne naissent, ont pour corollaires les tueries masculinistes qui, entre mandat masculin et masculinité toxique, se succèdent et se ressemblent : Montréal le 6 décembre 1989, Pittsburgh le 4 août 2009, Toronto le 23 avril 2018… Avant de commettre un attentat masculiniste de grande ampleur en Californie le 23 mai 2014, au cours duquel six personnes sont tuées et quatorze autres blessées, Elliot Rodger publie en ligne un « manifeste » (My Twisted World) ainsi qu’une vidéo intitulée « Retribution » (châtiment). Dans l’un et l’autre de ces documents apparaissent de manière très crue sa haine des femmes et sa volonté de les châtier.
Dans ce cas comme dans d’autres, ici comme ailleurs, dans le passé comme dans le présent, il ne s’agit pas seulement de morts physiques mais aussi d’assassinats symboliques. Car à l’autre bout de la longue chaîne de violences qui constitue le continuum féminicidaire, l’un des aspects les plus mésestimés du crime commis contre les femmes est la longue nuit du féminicide historiographique, ce que souligne l’historienne française Michelle Perrot lorsqu’elle note les silences de l’histoire à leur propos. Une nuit à l’opacité si dense qu’elle a conduit à la disparition programmée des femmes dans tous les domaines considérés comme non « féminins » et à la délégitimation et marginalisation constantes et pérennes de ceux auxquels elles sont associées.
Du monde académique au grand public s’est alors diffusé un récit de l’évolution de l’humanité qui, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, fait la part (trop) belle à l’homme au travers d’une vision exclusive et univoque. Une histoire sans femmes (ou presque) racontée par des dominants dans les langues de la domination, avec des concepts, des théories, des pensées de la domination… Une histoire partielle et partiale, qui fait de la partie le tout, assimilant l’« homme » à l’« humain ». Ainsi, comme le soulignent tant de chercheuses féministes à commencer par l’historienne française Éliane Viennot, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce n’est pas seulement le mot « homme » qui rend l’intitulé sexiste, mais comment celui-ci réfléchit l’effacement des femmes dans la société ainsi que leur néantisation dans l’histoire.
Ceci amène, in fine, à parler de l’articulation des savoirs et des expertises qui irriguent ce livre pensé, sur la très longue durée, comme une immense caisse de résonance polyphonique à l’échelle du monde. Proposant des textes inédits, mais également la republication d’articles, d’extraits d’ouvrages scientifiques, d’essais ou de romans – qu’ils soient fondateurs ou trop peu connus ; certains sont par ailleurs traduits ici pour la première fois en français –, la reproduction d’archives ou encore de documents iconographiques très divers, Féminicides. Une histoire mondiale repose aussi sur une alternance des voix – académiques, activistes, artistiques, journalistiques – et des récits, notamment ceux des femmes survivantes ou bien de leurs proches quand celles-ci sont mortes ou ont disparu. Sans prétendre nullement à l’exhaustivité, cette polyphonie était le seul moyen de rendre véritablement compte de l’ampleur et de la multiplicité du continuum féminicidaire : à n’importe quel moment de l’histoire, quel que soit le lieu, il a existé des violences visant spécifiquement les femmes.
Cet ouvrage (Féminicides. Une histoire mondiale) s’attache dès lors à recouvrer et à donner à voir les multiples traces historiques et mémorielles d’un crime dont la réalité fut trop longtemps relativisée, déniée ou bien tout simplement tue : le silence constituant ici, comme à Ciudad Juárez, une « seconde mort ». Articulé autour de sept grandes parties – Chasse aux « sorcières » ; Esclavage et colonisation comme féminicide ; Meurtres de femmes et féminicides de masse ; Masculinismes et féminicides ; Féminicides et génocides ; Normes de beauté, mutilations corporelles et annihilations identitaires ; Tuer les filles, les domestiquer et les marchandiser – et réunissant les plus grandes spécialistes de la question sur les cinq continents, l’ouvrage a vocation à faire du bruit, a contrario de ce silence qui a longtemps recouvert le crime de féminicide. Il s’agit de dire, en écho à la poétesse mexicaine Susana Chávez assassinée en 2011, « ¡ Ni una muerta más ! » (Pas une morte de plus !) et d’attester ensemble de notre capacité d’action en clamant haut et fort de tous les points du globe : « Nous avons résisté, nous résistons, nous résisterons ! »
