« Femmes et génocides. La colonisation allemande au Sud-Ouest africain (Namibie) »
par Christine de Gemeaux
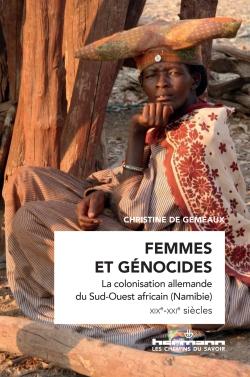
Christine de Gemeaux est professeur émérite en études germaniques à l’Université de Tours. Ses travaux sur le colonialisme allemand ont été pionniers en France et ont permis d’élargir la focale sur les études coloniales et postcoloniales en Europe : premier colloque (2006) et actes sous le titre Du Saint Empire romain germanique au deuil postcolonial (Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2010). Elle est notamment l’auteure de nombreuses autres publications dont L’Europe coloniale et le grand tournant de la Conférence de Berlin 1884-1885 (Le Manuscrit, 2013) et De la Prusse à l’Afrique. Le colonialisme allemand (Presses Universitaire François Rabelais, 2022). En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, elle présente son dernier ouvrage Femmes et génocides. La colonisation allemande du Sud-Ouest africain(Namibie) XIXe-XXIe siècles, paru en janvier 2025 aux éditions Hermann. Elle revient notamment sur l’histoire coloniale allemande depuis les premiers contacts européens jusqu’à l’établissement du protectorat du Reich en 1884, puis l’échec du projet de peuplement allemand après les génocides des Héréros et Namas (1904-1908), en adoptant une perspective originale : celui des femmes, et particulièrement les écrits de Margarete von Eckenbrecher.
Poursuivant ses recherches sur le passé colonial allemand, Christine de Gemeaux a fait paraître en janvier 2025 un livre sur le Sud-Ouest africain, actuelle Namibie aujourd’hui plaignante auprès de la RFA. Il couvre la période de l’arrivée des Européens au XVIe siècle, avec le premier repérage du territoire par les marins portugais (1488), puis la venue de missions chrétiennes de la colonie du Cap (1806) et enfin l’installation de commerçants allemands (1884) avec le protectorat du Reich (24 avril 1884). S’ensuit une politique de peuplement développée autour de 1900 pour fonder une « nouvelle Allemagne » qui s’effondrera une dizaine d’années plus tard.
L’histoire est abordée sous un angle original, à partir des mémoires de femmes de colons. Interrogées de façon critique, en particulier au sujet des génocides perpétrés contre les populations autochtones (1904-1908), notamment les éleveurs héréros et namas, ces témoignages constituent la mémoire privée allemande de la colonisation. Si la recherche les déclasse souvent comme illustrant un eurocentrisme secondaire, cette approche fournit des éléments fondamentaux pour la connaissance des réalités coloniales.
Elle permet de relire l’histoire en creux, d‘entrer dans la chair des événements. Le cœur de la présente étude repose sur les écrits de Margarete von Eckenbrecher (1875-1955) — en particulier Ce que l’Afrique m’a donné et ce qu’elle m’a pris[1]—, et sur ceux de ses compatriotes féminines. Comment les colonisatrices rendent-elles compte des « révoltes indigènes » de janvier 1904, des réactions des fermiers allemands, des liens avec la Schutztrupe (troupe coloniale), quels regards portent-elles sur des événements tels que la bataille du Waterberg (11 août 1904), ou l’ordre d’extermination du Général von Trotha (2 octobre 1904) ; bref, qu’apprenons-nous sur la survenue des génocides ?
Le livre de Christine de Gemeaux n’esquive pas la polémique qui surgit dans les années 1990 autour de ce que certains ont appelé « le premier génocide allemand », reprenant un concept contesté. Un historien comme Jürgen Zimmerer[2] ou encore le politologue Henning Melber[3] établissent une continuité avec le génocide ultérieur contre les Juifs. Si l’étude montre des similarités évidentes (discours et vocabulaire spécifiques, idée de « race supérieure », d’espace à conquérir sur des populations « inférieures » ; camps de concentration, engagement successif du personnel allemand dans le service colonial puis dans celui du national-socialisme), s’il y a bien eu sur le principe des génocides au Sud-Ouest (reconnus par la RFA en mai 2021) Christine de Gemeaux conclut que cela ne permet d’y voir une prédétermination, un laboratoire de l’extermination des Juifs. II existe une différence d’intention politique liminaire et une différence de degré entre ces génocides.
Enfin la question est posée de savoir si, au terme de la Première Guerre mondiale, la défaite allemande en Europe et dans les colonies signe la fin de la présence allemande au Sud-Ouest ? La seconde moitié du livre montre qu’il n’en est rien. Christine de Gemeaux étudie la suite de l'histoire namibienne, en revenant sur le mandat sud-africain (1920) jusqu’aux luttes de la SWAPO et à l’indépendance du territoire (1990).
L’analyse s’étend jusqu'à nos jours et au softpower allemand, à l’influence des Namibiens-Allemands, et surtout aux questions des restitutions et des réparations. Avec la Namibie notamment, la politique mémorielle de l’Allemagne et celle des anciens colonisateurs est questionnée, replacée dans un contexte international. Cela mérite de retenir l’attention des lecteurs français.
[1] Margarete von Eckenbrecher, Was Afrika mir gab und nahm. Erlebnisse einer deutschen Frau in Südwestafrika 1902-1936, Berlin, Verlag Mittler und Sohn, 1940 [1907].
[2] Jürgen Zimmerer, Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust, Periplus-Studien. Vol.15, LIT Verlag, Münster, 2011.
[3] Henning Melber, The Long Shadow of German Colonialism Amnesia, Denialism and Revisionism, London, C. Hurst & Co ed., 2024.
SOMMAIRE
Introduction
Partie I – Le regard d’une colonisatrice
I. Retour sur l’ère coloniale allemande
1. Questions sur la Namibie
2. Un territoire perçu comme hostile
3. L’occupation coloniale
II. Femmes allemandes et installation sur le territoire
1. Margarete von Eckenbrecher et ses compatriotes
2. Débarquement à Swakopmund et voyage vers l’intérieur
3. Représentations des populations autochtones
4. Processus de dépossession
III. Diviser pour régner : conflits interethniques et militarisation
1. Luttes entre Namas et Héréros
2. Création de la Schutztruppe et stratégie coloniale
Partie II – Les génocides au Sud-Ouest africain
I. De la colonisation à la guerre
1. Déclenchement du conflit : causes immédiates
2. L’assassinat d’un commerçant : un exemple révélateur
3. 1904-1905 : la fin du mythe colonial
II. Le conflit vu par Margarete von Eckenbrecher
1. Menaces sur la ferme familiale
2. La figure du blanc « négrisé » et l’obsession de la pureté
3. Encerclement et délivrance
III. L’ordre d’extermination et ses conséquences
1. L’ordre d’extermination
2. La bataille du Waterberg et ses suites
3. Regards de femmes allemandes sur le conflit
IV. Le débat sur le « premier génocide allemand »
1. Convergences entre les génocides
2. Une polémique historique et politique
3. L’Allemagne face à son passé colonial
Partie III – Mandat sud-africain, indépendance namibienne et mémoire
I. 1915 : la défaite allemande vécue de l’intérieur
1. Télécommunications et mobilisation
2. Les ennemis de la colonie
3. Premières offensives alliées
4. Réactions autochtones et internement
II. Capitulation et conséquences immédiates
1. La prise de Windhoek
2. Le Blue Book et les conditions de la reddition
III. Le mandat sud-africain : une germanité bafouée
1. Jugements sur les puissances alliées
2. Margarete von Eckenbrecher en résistance
IV. De la SWAPO à l’indépendance
1. Le rôle de la SWAPO
2. Le gouvernement ovambo et la lutte anti-apartheid
3. Statut et engagement des femmes noires
V. Mémoires coloniales et postcoloniales
1. Commémorations et lieux de mémoire
2. Mémoires allemandes en Namibie
3. Évolutions de la mémoire coloniale allemande
4. Décolonisation mémorielle : entre restitutions, musées et tourisme
