Le goût des Îles sur les tables des Lumières
Par Érick Noël
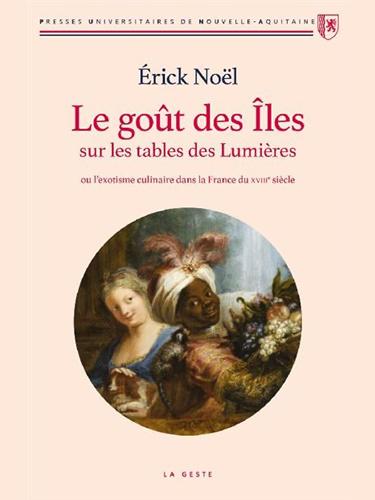
Érick Noël a été maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes de 1998 à 2008 et est depuis professeur à l’Université des Antilles. Ses thèmes de recherches sont l’étude du milieu planteur aux Antilles au XVIIIe siècle ; les Noirs en France à l’époque moderne et les Îles en France. Il a publié de nombreux articles notamment sur Alexandre Dumas, le chevalier de Saint-George et la Légion noire sous la Révolution, et a publié les ouvrages Les Beauharnais, une fortune antillaise (1756-1796) (Droz, 2003), Être noir en France au XVIIIe siècle (Éditions Tallandier, 2006), Un Monde créole. Vivre aux Antilles au XVIIIe siècle (La Geste, 2017) avec Annick Notter ; et son dernier ouvrage Le goût des Îles sur les tables des Lumières (La Geste, 2020), qu’il présente dans cette tribune.
Des « Isles » d’hier aux « Îles » d’aujourd’hui, vendeuses de rêve et d’exotisme, c’est un monde enchanteur qui s’inscrit dans les imaginaires occidentaux, fruit des Grandes Découvertes idéalisées à l’époque moderne par des hommes en quête de paradis nouveaux. Dépeintes à l’heure du retour à la nature comme les vestiges d’un Éden perdu, les îles désacralisées par la pensée des Lumières n’en sont pas moins dénaturées pour être sacrifiées à l’autel de la rentabilité, celles de l’Atlantique et dans une moindre mesure de l’océan Indien devenant sous les tropiques les îles à sucre, quand le bon sauvage qui peuplait les terres nouvelles est balayé par l’esclave noir associé au processus.
Fantasmées, les Îles s’étirent en fait largement dans les eaux chaudes de la Caraïbe et de l’est de l’Afrique, pour pointer jusqu’aux confins des mers du Sud. Et jusque dans un XVIIIe siècle avancé, des noms chargés de mythe sont portés sur des cartes qui poussent même l’île de Saint-Brendan au large des Canaries, voire les Hespérides dans les Antilles. Le déclin des mers froides, qui avaient fait fortune par la morue, contraste alors avec l’essor de ces archipels plus méridionaux, dont les fleurons deviennent les fers de lance d’une économie-monde, de la Jamaïque anglaise à Saint-Domingue, consacrée « perle » du premier empire colonial français.
D’emblée, ce déplacement du curseur indique une tropicalité qui ne s’exprime pas seulement dans l’exubérance des paysages, mais à travers des saveurs émanant de la flore qui s’y déploie. Emboîtant le pas aux Ibériques, les Européens du Nord-ouest se lancent dans une aventure qui met en évidence le rôle moteur du sucre de canne, l’« or blanc » entraînant dans son sillage d’autres productions, comme le café de Moka répandu des Indes orientales au Nouveau Monde. Préféré au miel, qui n’avait cessé au Moyen Âge de relever plats et boissons, le sucre s’invite sur les tables des élites, dissipant aussi bien l’amertume du cacao hispanique que celle du café Bourbon ou du thé du Japon. Au-delà des vertus réelles ou supposées des nouvelles plantes, les breuvages et les douceurs mis en vogue par les grands suscitent un engouement tel que les gouvernants, malgré les réticences des églises ou de la médecine, sont tentés d’exploiter le succès des addictions naissantes. Les empires qui se dessinent dressent dès lors les contours de goûts originaux, et d’autant de particularismes locaux. Le crépuscule de l’Ancien Régime voit ainsi poindre une identité culinaire française où le café du lever s’impose, jusqu’au bas de l’échelle sociale, tandis que le chocolat se répand en Espagne et que le thé devient, en Angleterre, un symbole de la culture nationale.
Ces signes les plus évidents d’une mutation des goûts ne sauraient dissimuler des changements plus profonds, dans des sociétés dont le fonds alimentaire, dominé par les blés et les légumes, n’est guère amélioré que chez les plus aisés par les assaisonnements qui relèvent viandes et poissons. À cet égard, une révolution se prépare dès le Grand Siècle, les cuisiniers comme La Varenne défendant, au moment où Louis XIV combat les Hollandais passés maîtres de la route des Indes, un retour aux « saveurs vraies » des aliments. Si les épices continuent, comme le sel qui conserve la morue, à rehausser gibiers et pâtés, les sauces acides et aigres-douces font place à des accompagnements plus doux, les produits laitiers envahissant en particulier les entremets. Facilitant la digestion, le fruit qui clôt les repas se meut lui-même en un large choix de desserts, des gâteaux les plus sophistiqués à ces crèmes dont Massialot offre de multiples recettes. En ce sens, les raffinements de la Régence font école, bientôt codifiés par Menon qui sait habilement adresser aux femmes des manuels à succès, réédités jusqu’au milieu du XIXe siècle. La cuisine aristocratique se fait ainsi bourgeoise, les plats épicés et salés reculant devant des assiettes toujours plus suaves.
De tels bouleversements, dont nos sociétés actuelles sont directement héritières – pour le meilleur et pour le pire si l’on considère l’invasion du sucre dans l’espace alimentaire –, nous ont paru l’argument majeur pour engager une analyse du phénomène. Les recherches en histoire culinaire se sont démultipliées depuis les travaux magistraux de Bruno Laurioux sur la cuisine médiévale et de Jean-Louis Flandrin pour la période moderne, aboutissant dans les années 2000 à des études géographiquement plus ciblées, de Florent Quellier en Île-de-France à Philippe Meyzie en Aquitaine. La thèse de Maud Villeret a en outre ouvert le champ sur la transformation en Pays de Loire de la manne sucrière, quand les colonies n’ont, en revanche, paru pour l’essentiel aborder que sous l’angle économique, à travers la droiture et l’exploitation esclavagiste. Il nous a dès lors semblé nécessaire de mettre l’accent sur les Îles, de leurs productions les plus porteuses à la valorisation de ces denrées qui ont surtout réjoui les papilles métropolitaines.
Ce livre entend être un précis, offrant en quinze chapitres un éclairage sur chacune des étapes qui ont marqué les produits jusqu’au stade de leur consommation. C’est ainsi qu’une large moitié de l’analyse est consacrée à la compréhension de ces systèmes, ténus et complexes, qui ont sous-tendu une chaîne où les modalités d’exploitation et de traitement, mais aussi de transfert et de conditionnement, n’ont cessé d’impliquer les intérêts les plus divers. De là, ce sont les étapes suivies par les produits transportés, bruts ou semi-finis, qui ont donné corps aux derniers chapitres, dans une France des Lumières où les apprêts réalisés, de la cuisine au restaurant, ont annoncé la gastronomie contemporaine. Cette histoire met en outre en évidence des mutations accélérées sous l’effet de la mode, au sein d’un monde du travail et d’une société civile qui a fait siennes de nouvelles manières de vivre, du salon au café, et jusque dans la sphère domestique.
