Les « révoltes indiennes » : une histoire américaine, XVIe-XXIe siècles
Par Christophe Giudicelli et Gilles Havard
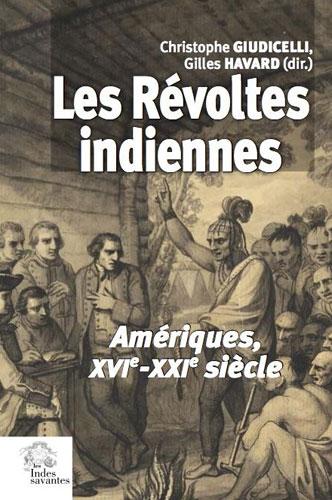
Christophe Giudicelli est professeur d’histoire et de civilisation latino-américaine à Sorbonne Université et directeur du Centre Franco-Argentin des Hautes Études en Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Buenos Aires. Il dirige la revue Nuevo Mundo Mundos Nuevos et est spécialiste des frontières de l’Amérique espagnole coloniale (nord du Mexique, nord-ouest argentin) et des questions de classifications (XVIe-XIXe siècles). Il a notamment publié Luchas de clasificación (Prohistoria/ IFEA 2018), La indianización (Doce Calles, 2013) avec Gilles Havard et Salvador Bernabéu et Régimes nationaux d’altérité (PUR, 2016) avec Paula López Caballero. Gilles Havard est directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Mondes Américains, ses travaux portent sur l’histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (XVIe-XIXe siècles). Il a notamment publié Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715 (Septentrion/PUPS 2003, 2e éd. 2017), Histoire des coureurs de bois. Amérique du Nord 1600-1840 (Les Indes Savantes, 2016. 2e éd. Perrin, 2021) et L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde (Flammarion, 2019). Ensemble, ils viennent de publier l’ouvrage Les révoltes indiennes (Les Indes Savantes, 2021), qui interroge l’histoire des rebellions indigènes dans les Amériques anglaise, espagnole et française depuis le XVIe siècle. Le livre tente de rendre la parole aux « révoltés » pour reconstruire chacun des soulèvements, des guerres, des insurrections ou des résistances, qui ont été masqués par le terme générique de « révolte ». Cette simplification des mouvements de contestation a participé d’une volonté de criminalisation des oppositions, un usage encore utilisé par certains états d’Amérique aujourd’hui.
Dans l’Amérique contemporaine, de la Terre de Feu à l’Alaska, nombreux sont les mouvements de protestation ou de revendication des communautés amérindiennes contre l’usurpation de leurs terres, les abus de compagnies forestières, les ravages de l’extraction pétrolière et minière, de la culture intensive de soja ou de l’exploitation touristique. Au Canada, en 2012, des femmes amérindiennes ont lancé le mouvement Idle No More (« L’inaction plus jamais ») contre le gouvernement fédéral de Stephen Harper, accusé de faire peser une menace sur les traités du passé. Aux États-Unis, en 2016, une mobilisation de grande ampleur s’est organisée contre la construction d’un oléoduc, le Dakota Access Pipeline (DAPL), dans la réserve sioux de Standing Rock, avec à la clé de nombreuses arrestations, pour des motifs divers : « criminal trespass » (intrusion criminelle), « reckless endangerment » (mise en danger), obstruction, trouble à l’ordre public, etc. En Amérique latine, les mouvements indiens de contestation sont aussi taxés avec une remarquable régularité d’« émeutes », lorsque leur lutte n’est pas tout simplement assimilée à du « terrorisme », argument d’autorité brandi désormais par certains pouvoirs en place pour justifier une guerre ou l’adoption de lois d’exception.
C’est ainsi par exemple que la loi « antiterroriste », promulguée sous le régime dictatorial du général Pinochet, est très régulièrement appliquée pour réprimer la lutte des militants mapuche du sud du Chili pour la défense de leurs terres[1]. De l’autre côté des Andes, les communautés mapuche argentines en lutte pour la récupération de leurs terres accaparées par de grands groupes internationaux comme Benetton sont régulièrement assimilées à des organisations terroristes. Elles font même l’objet d’un déni de nationalité : selon le sens commun forgé au XIXe siècle lors des campagnes militaires menées par l’État argentin pour justifier massacres et réduction en esclavage, ces Indiens seraient chiliens[2]. Et ne parlons même pas du Président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro, pour qui toute opposition à la déforestation de l’Amazonie et à l’avancée des grandes entreprises alliées aux intérêts qu’il représente[3] est une manifestation de terrorisme et d’archaïsme de la part de populations dont il a ouvertement regretté qu’elles n’aient pas été exterminées[4].
La disqualification des soulèvements indigènes a une longue histoire dans les Amériques, puisqu’elle remonte aux origines de la colonisation. Durant la période dite coloniale, c’est le cadre de la rébellion ou de la révolte qui a souvent présidé à la description des soulèvements amérindiens contre les diverses formes d’autorités nées de la colonisation, qu’il s’agisse des représentants du pouvoir colonial, des encomenderos et autres propriétaires terriens ou encore de l’autorité religieuse représentée par les missionnaires.
Qu’ils soient mobilisés au XVIe ou au XXIe siècle, les termes servant à caractériser ces mouvements amérindiens, qui ont parfois été des guerres, il faut tenter de les contextualiser et de les problématiser. Cela passe par une réflexion sur leur généalogie et sur la porosité qui peut exister entre, d’une part, les catégories des acteurs, qui leur permettent de rendre compte du monde social dans lesquels ils vivent, et, d’autre part, les catégories analytiques qui sont celles des historiens ou des anthropologues. Le langage utilisé pour décrire une guerre, une explosion de violence, et du coup la façon dont on s’en souvient, est toujours biaisé[5], a fortiori dans le contexte des relations asymétriques entre Européens (ou Euro-Américains) et Amérindiens : les mots sont ceux du pouvoir, des colons ou de l’État, rarement ceux des Indiens, qui n’ont guère été répertoriés pour l’époque coloniale et qui restent très marginaux pour les mouvements plus contemporains, leur parole étant bien souvent passée sous silence et criminalisée. En d’autres termes, il faut déjouer l’ordre du discours qui organise le plus souvent les événements et les mouvements étudiés. Ce faisant, il s’agit de déconstruire des catégorisations pour mieux reconstruire les logiques politiques et culturelles qui présidaient aux mouvements que ces catégories condamnent d’emblée et interdisent de penser de façon autonome. C’est le projet à l’origine du livre Les révoltes indiennes[6] (Les Indes Savantes, 2021), lui-même issu d’un colloque intitulé « Des "révoltes indiennes" aux "émeutes autochtones". Sociétés amérindiennes, autonomie et criminalisation des conflits (Amériques, XVIe-XXIe siècle) », qui s’est tenu à l’Université de Rennes II les 9 et 10 mars 2017.
Les catégories de « révolte » et de « rébellion » ont été reprises, mais parfois aussi forgées, par l’historiographie au cours des XIXe et XXe siècles. Dans l’historiographie de l’Amérique espagnole et portugaise, l’histoire des révoltes, par le biais d’une lente sédimentation qui remonte à l’époque coloniale, est presque devenue un genre à part entière. Le nord du Mexique, par exemple, a suscité la publication d’un nombre conséquent de catalogues de mouvements amérindiens, pourtant très différents les uns des autres, tous subsumés sous la catégorie de « rébellions ». Dans la zone andine (territoires actuels du Pérou, de la Bolivie et de l’Équateur), pour le seul XVIIIe siècle, l’historienne Scarlett O’Phelan Godoy a recensé et analysé 140 « révoltes » et « rébellions » (ces dernières étant susceptibles de réunir des Indiens, des métis et des créoles)[7]. La révolte de Tupac Amaru (1780-1782), qui mobilise des dizaines de milliers d’Indiens, est le plus emblématique de ces soulèvements. C’est aussi celui qui a le plus retenu l’attention des élites créoles, dans la mesure où, selon leur perspective volontariste et téléologique, il anticipait les guerres d’indépendance du début du XIXesiècle. La rupture avec l’ancienne métropole ibérique entraîna en effet un changement radical d’appréciation des soulèvements amérindiens : figures de la délinquance contre les deux couronnes (celle du Roi et celle de Dieu) à l’époque coloniale, ils devenaient des signes avant-coureurs de la lutte de libération nationale…
Cependant, ce changement de focale n’impliquait nullement une remise en question de l’organisation du récit que leur avait légué l’administration coloniale. Les rebelles devenaient des justiciers, les délinquants possédés par le Diable se voyaient parés a posteriori d’improbables vertus patriotiques, mais aucune révision n’était menée quant à la présentation des faits : elle restait l’apanage des agents de la « pacification ». On remarquera par ailleurs que cette « incantation indianiste » propre au moment des indépendances[8] fut de courte durée : la plupart des nouvelles républiques développèrent tout au long du XIXe siècle une politique de colonialisme interne destiné précisément à réduire l’insubordination des peuples indiens restés autonomes : que l’on pense seulement à la « guerre des castes » et à la « guerre yaqui » au Mexique, à la « Pacification de l’Araucanie » menée contre les Indiens mapuche du sud du Chili ou à la « Conquête du désert » lancée en Argentine contre les Indiens du sud du pays et du Chaco : autant d’appellations consacrées par leurs initiateurs, naturellement, et qui en disent long sur les attendus de leurs campagnes.
Le mot « révolte » a été beaucoup moins valorisé dans l’histoire nord-américaine. Ce sont plutôt les termes « massacre » ou « guerre » qui, dans les sources comme dans l’historiographie, se sont imposés pour qualifier les soulèvements guerriers amérindiens au nord du Rio Grande. Des historiens ont pu néanmoins consacrer le mot « révolte » dans quelques cas, que l’on songe à la « révolte des Natchez » (« Natchez Rebellion »), dans la basse vallée du Mississippi en 1729, ou à la « révolte de Pontiac » (« Pontiac’s Rebellion », « Pontiac’s Conspiracy »), dans les Grands Lacs et la vallée de l’Ohio en 1763. Le terme, sans surprise, apparaît aussi dans l’historiographie des colonies espagnoles d’Amérique du Nord (ainsi la « Yamasee Revolt » de 1597, dans l’actuelle Géorgie, ou la « Pueblo Revolt » de 1680).
Il ne s’agit pas de mobiliser ces catégories de façon acritique, simplement parce qu’elles sont constitutives du sens commun, mais au contraire de les interroger. Que nous disent-elles sur ceux qui les ont forgées ? Nous aident-elles à comprendre les logiques d’action des sociétés amérindiennes, ou, au contraire, nous égarent-elles par péché d’ethnocentrisme ? Dans le cas de l’attaque Natchez de 1729 contre les Français, par exemple, qui fait plus de 240 victimes, ou celle des Calchaquí du Tucumán, qui a causé en 1562 la destruction de presque toutes les villes de la province, est-il pertinent de parler de « révolte » ? Il s’agit au fond de comprendre la façon dont les acteurs européens, contemporains desdites « révoltes », ou les chroniqueurs plus tardifs, ont pu rendre compte et analyser les évènements compris sous cette appellation générique. Et il faut évoquer tous les acteurs repérables dans le contexte de ces soulèvements : les Indiens et les colons bien sûr, mais aussi les esclaves africains, susceptibles d’entrer en rébellion et de marronner.
Le but n’est donc pas de réifier un champ d’étude, celui des « révoltes indiennes », qui ferait pendant à celui des révoltes d’esclaves africains, voire à celui des « révoltes blanches » (étudiées par exemple par Charles Frostin dans le cas de Saint-Domingue), mais, pour mieux évaluer les soulèvements amérindiens dans leur diversité, de s’abstraire de ce champ de façon critique en restituant les logiques politiques autonomes qui présidaient à chacun de ces mouvements. En essayant de rendre les acteurs de ces « révoltes » les sujets de leur propre histoire, au-delà, précisément, du cadre contraint et souvent surdéterminé de la « révolte ».
À travers plusieurs études de cas, Les révoltes indiennes (Les Indes Savantes, 2021) donne l’opportunité de mettre en regard, à travers la thématique de la révolte, les différentes Amériques coloniales, notamment française, britannique et espagnole. Le livre analyse aussi la construction d’un régime d’altérité jouant sur l’invisibilisation politique et la stigmatisation ethnique des collectifs indiens-ruraux dans les jeunes républiques latino-américaines issues des indépendances du XIXe siècle, en Équateur, au Paraguay, en Bolivie ou en Argentine. Il explore enfin la synchronie de mouvements répondant à des pressions similaires, qu’il s’agisse de la résistance des communautés du nord du Pérou contre les compagnies minières transnationales, des mobilisations politiques équatoriennes, boliviennes ou péruviennes pour l’obtention de droits, ou encore de la construction de l’autonomie zapatiste au Chiapas face au pouvoir central mexicain et aux exigences néolibérales de l’ALENA.
[1] La littérature est abondante sur le sujet. On lira par exemple cette analyse de Myrna Villegas, directrice du Centre des Droits Humains de la faculté de Droit de l’Université du Chili : http://www.derechouchile.cl/comunicaciones/columnas-de-opinion/derechos-humanos-ley-antiterrorista-y-mapuchebrmyrna-villegas
[2] Voir Claudia Briones, « Luchas clasificatorias, memorias públicas y procesos hegemónicos: Reflexiones en torno a “la cuestión mapuch », in Giudicelli, Chrisotphe (coord.) Luchas de clasificación Las sociedades indígenas entre taxonomía, memoria y reapropiación, Rosario, Prohistoria Ediciones; Lima, IFEA, 2018, p. 287-318.
[3] Voir Manuela Libardi « Brasil : depredación y exclusión. El proyecto bolsonarista para el Amazonas », Nueva Sociedad, août 2019 https://nuso.org/articulo/brasil-depredacion-aborigenes-amazonas-bolsonaro/
[4] Il avait ainsi déclaré devant le parlement brésilien en avril 1998 : « Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens. » Bolsonaro fait l’objet d’une enquête du Tribunal Pénal International pour « génocide » contre les populations autochtones de son pays. https://www.cdhal.org/genocide-bolsonaro-devient-le-premier-president-bresilien-a-etre-soumis-a-lana...
[5] Voir Jill Lepore, The Name of War. King Philip’s War and the Origins of American Identity, Alfred A.Knopf, 1998.
[6] Christophe Giudicelli et Gilles Havard, (dir), Les révoltes indiennes. Amériques XVIe-XXIe siècle, Paris, Les Indes Savantes, 2021.
[7] Scarlett O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts in Eighteenth Century Peru and Upper Peru, Cologne, Bohlau Verlag & Cie, 1985.
[8] Rebecca Earle, The Return of the Native Indians and Myth-Making in Spanish America, 1810-1930, Durham, N.C., Duke University Press, 2007.
