« Nous ne sommes jamais dans les livres »
par Édouard Zambeaux
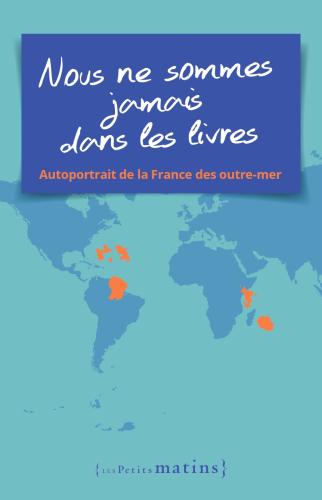
Depuis près de 10 ans, la Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) œuvre pour donner la parole à celles et ceux qui en sont privés, qui ne se sentent pas légitimes à être lus ou entendus. Pour le Groupe de recherche Achac cette semaine, son directeur éditorial Édouard Zambeaux présente Nous ne sommes jamais dans les livres – Autoportrait de la France des outre-mer, à paraître le 27 mars 2025, et co-dirigé avec Emmanuel Vaillant. Cet ouvrage collectif, qui résulte de 45 résidences d’écriture, rassemble les témoignages de plus de 600 ultramarins, âgés de 13 à 80 ans. Ces récits offrent un éclairage sur la réalité de leur quotidien : la splendeur des paysages, mais aussi les embouteillages incessants et les caillassages de bus, les traditions culturelles, mais aussi les agressions sexistes et les formes multiples de racisme. Ces témoignages sont d'autant plus précieux qu'ils permettent de donner une voix à des populations souvent invisibilisées dans le grand récit national. Dans la lignée des précédents ouvrages de la ZEP, Vies majuscules (Les Petits Matins, 2020) et Moi, jeune (Les Petits Matins, 2022), ce livre poursuit la mission de l’association : faire entendre des voix trop souvent marginalisées, et offrir un espace où ces récits, loin de se réduire à des clichés, se déploient dans toute leur diversité et leur complexité.
Qui est légitime à prendre la parole ? Qui a le droit de s’écrire ? Quels récits sont dignes d’être rendus publics ? Notre conviction, à la Zone d’expression Prioritaire, est que l’une des premières inégalités qui entretient et nourrit la fracturation de notre société est là. Entre celles et ceux qui ont accès à une expression et celles et ceux qui ne l’ont pas, entre celles et ceux qui s’estiment légitimes à être lu·es et entendu·es et celles et ceux qui s’en sentent empêché·es.
Pour cela, la ZEP tente en permanence de frayer dans les angles morts de la représentation médiatique pour y ouvrir des espaces d’écriture. Et les Outre-Mer restent souvent sous les radars dans leur quotidienneté.
C’est donc pour essayer de d’élaborer un récit, sous forme d’autoportrait, de ces territoires que nous avons entrepris d’installer des résidences d’écriture journalistique dans ces cinq départements : la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, la Martinique et la Réunion se sont donc succédé au cours de l’année 2024. Dix semaines de résidence d’écriture pour accompagner près de 600 habitants à « prendre la plume » pour raconter leurs territoires. Dix heures de compagnonnage d’écriture pour que les journalistes de la ZEP aident les idées à émerger, les angles à s’affiner puis des textes à se formaliser.
Une question centrale : que pourriez-vous raconter qui éclaire la réalité qui est la vôtre et qui nous aide à mieux la saisir ? C’est ainsi qu’est né ce livre qui a mobilisé aussi bien les journalistes permanents de l’équipe que des journalistes fortement implantés dans chacun de ces départements qui nous en ont apporté leur connaissance intime qu’ils en ont.
L’année 2024 a vu se succéder les crises majeures dans les terres d’outre-mer. De la crise de l’eau qui a touché Mayotte et les iles des Antilles, à la multiplication des évènements climatiques particulièrement virulents dans l’océan Indien, des opérations Wambushu ou place nette aux couvre-feux qui se sont succédé, de l’épidémie de choléra mahoraise aux incendies de bidonvilles en Guyane, la chronique des Outre-Mer aura cette année été exceptionnellement fournie. Nous nous sommes employés et sans passer à côté de ces faits majeurs à accompagner les ultramarins dans des récits de ce qui fait la vie quotidienne, de s’attacher aux signaux faibles.
Les 600 participants à cet exercice d’écriture se font donc les guides précieux, précis, méticuleux et souvent enthousiastes de vies que nous avons souvent l’habitude de voir avec les yeux de l’Europe. Ils se racontent telle vivent au quotidien. A travers des récits individuels, que nous avons aidé à élaborer, ils dressent un panorama impressionniste mais bien vivant de la réalité des cinq départements que nous appelons d’outre-mer.
Ils sont donc des interprètes des 2 millions d’ultramarins. Ils nous conduisent à la découverte des paysages uniques qui sont leurs décors quotidiens, nous éclairent sur les façons d’être et de vivre ces territoires, nous embarquent dans leurs déplacements journaliers, nous livrent des clés de leurs cultures, nous alertent sur les problématiques auxquelles ils doivent faire face et nous interpellent sur les inégalités criantes qui leurs sont faites et sur la fréquente âpreté qu’il y a à vivre dans la « carte postale » qui n’en est souvent une que pour le voyageur de passage.
Le sentiment d’appartenance à la communauté nationale n’est jamais bien loin. Le grand écart permanent entre la quête du droit commun et la réalité du régime dérogatoire qui s’applique à ces territoires, la débrouillardise comme marque de fabrique du quotidien devant les pénuries ou les carences font de ces départements des entités qui ne sont ni ne se sentent ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. « Nous ne sommes pas des provinces françaises. Nous sommes des peuples-nations, avec des équations historiques, culturelles, existentielles et créatives uniques », affirmait Patrick Chamoiseau en 2024 dans Le Monde. Aussi français qu’ils soient ces départements sont aussi et d’abord Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, Mahorais et Réunionnais.
Nous souhaitons avec ce livre répondre modestement à ce cri du cœur lancé dès le premier atelier d’écriture à Cayenne par une adolescente exhibant son manuel d’histoire en nous interpellant d’un « Nous ne sommes jamais dans les livres » ! En invitant les Ultramarin.es des cinq départements à participer à nos ateliers d’écriture, nous avons justement souhaité les inviter dans les livres, et dans celui-là pour commencer en partageant leur vie quotidienne, les parfums, les gouts, et les images de ces terres et de leurs habitants.
