Tant mieux si la route est longue
Par Louis-Jean Calvet
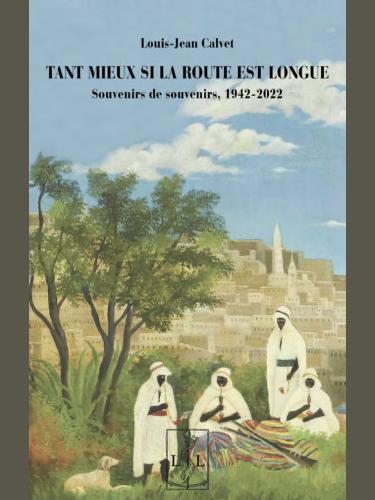
Louis-Jean Calvet est un linguiste et sociolinguiste originaire de Bizerte en Tunisie. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, il est considéré comme l’un des fondateurs de la sociolinguistique française depuis la parution de son ouvrage Linguistique et colonialisme (Payot, 1974). Dans son dernier essai Tant mieux si la route est longue. Souvenirs de souvenirs (1942-2022) publié en septembre 2022 aux Éditions Lambert-Lucas, il analyse comment l’utilisation de la linguistique a participé à soutenir des systèmes coloniaux. Il met ainsi en perspective un certain nombre de ses écrits en racontant les sources d’inspiration – la plupart du temps des expériences de terrain dans le cadre de ses voyages en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, de ses travaux journalistiques ou théoriques sur la chanson et de ses recherches sur les langues dans leurs rapports avec la société.
Ma ville natale, Bizerte, était plurilingue. On y parlait bien sûr l’arabe tunisien – le tounsi –, le français, langue de l’administration et de l’école, mais on y entendait aussi dans la rue le maltais, le sicilien, l’espagnol des réfugiés antifranquistes, et même le russe des Russes blancs qui avaient fui la Révolution soviétique à la fin des années 1910. Du côté́ espagnol, il y avait en particulier monsieur Marcote, que j’appelais Don Marcote, un ancien commissaire politique de Barcelone, réfugié à Bizerte et devenu réparateur de batteries, que j’allais voir parfois en revenant du lycée et qui m’apprit des rudiments d’espagnol et, surtout, essayait de m’expliquer ce qu’était un fasciste ou un franquiste.
Plurilinguisme, donc, mais réparti de façon très inégale. Un jour, en 1958 ou 1959, un professeur d’histoire du lycée de Bizerte, il s’appelait Rescoussier, arrivant de France et jetant sur la situation tunisienne un autre regard que le nôtre, m’avait dit : « Les Arabes parlent français mais les Français ne parlent pas arabe. » J’avais seize ou dix-sept ans, mais cela m’a fait réfléchir. Avec le recul, je me rends compte que c’est à cette même époque que Charles Ferguson rédigeait son célèbre article, « Diglossia », paru en 1959. Mais la diglossie avait pour lui lieu entre des formes linguistiques génétiquement apparentées, katharevoussa et demo-tiki en Grèce par exemple, ou fusha et masri en Égypte, alors qu’il s’agissait à Bizerte de rapports de force entre français et arabe, deux langues non apparentées génétiquement, un autre type de diglossie, celle que définira plus tard Joshua Fishman dans son célèbre article « Diglossia with and without bilingualism, bilingualism with or without diglossia ».
En quelque sorte, nous étions nés dans un exemple de sociolinguistique, la diglossie, et nous vivions un exemple de ce que j’appellerais plus tard la glottophagie. [...] J’ai rapporté cette remarque à mon frère Alain, et il me dit aujourd’hui qu’elle est sans doute à l’origine de Linguistique et colonialisme – un livre que j’écrirais près de vingt ans plus tard [...] Si j’évoque ces quelques souvenirs, c’est parce qu’on m’a souvent demandé si mon métier ne découlait pas de la situation linguistique dans laquelle j’ai passé mon enfance et mon adolescence.
Un journaliste m’a une fois fait remarquer que nous étions trois linguistes français de quelque notoriété nés en Tunisie, Henriette Walter, Claude Hagège et moi-même, et qu’il devait y avoir une raison à cela. Peut-être, mais à ce compte tous les Tunisiens de ma génération pourraient être sociolinguistes.
