Groupe de recherche Achac : 35 ans d’engagement pour la connaissance et la diffusion de savoirs sur l’histoire coloniale et les zoos humains
Par Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Emmanuelle Collignon et Pascal Blanchard
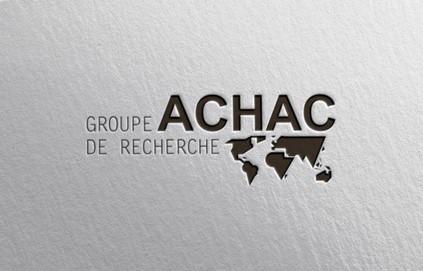
Le Groupe de recherche Achac s'est consacré depuis 35 ans à l'étude de l’histoire (dont celle des zoos humains) et des représentations coloniales (dont la culture coloniale) ainsi qu'aux flux migratoires extra-européens. À travers divers programmes tels que « Histoire & culture coloniale », « Mémoires combattantes », et « Sport & diversités », le Groupe de recherche Achac cherche à diffuser ses recherches auprès du monde académique et du grand public. L’anniversaire de ce collectif, composé de chercheurs, universitaires, écrivains et journalistes, est l’occasion de revenir sur ses nombreuses réalisations, notamment dans l'édition de livres, la conception d'expositions et la production de documentaires. Parmi leurs travaux notables figurent des ouvrages sur les décolonisations françaises, la culture coloniale, les zoos humains, la propagande coloniale auxquels le Groupe de recherche Achac a consacré très tôt des travaux d’envergure. Les expositions, souvent en partenariat avec d’autres institutions telles la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme, ou encore le musée du quai Branly-Jacques Chirac, visent à vulgariser des sujets complexes et parfois oubliés de l’histoire coloniale française…
Créé en 1989, le Groupe de recherche Achac travaille depuis maintenant 35 ans sur les représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et postcoloniaux, ainsi que sur les flux migratoires extra-européens à travers différents programmes de recherche : Histoire & culture coloniale, Mémoires combattantes, Racisme & zoos humains, Portraits de France, Sport & diversités, Immigrations des suds et Sexe, altérité & corps colonisés. Sa démarche consiste à mettre en œuvre et à diffuser ses travaux de recherches auprès du monde académique comme du grand public (notamment dans les régions ultramarines, les QPV mais aussi à l’étranger) sur quatre axes : l’édition de livres, la conception d’expositions, la proposition de documentaires, et l’organisation de manifestations scientifiques.
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur les projets de ce collectif de chercheurs.ses, d’universitaires, d’écrivain.e.s, de collectionneu.rs.ses, de documentaristes et de journalistes, et plus particulièrement sur les dernières réalisations.
Au sein du programme Histoire & culture coloniale, le Groupe de recherche Achac a produit ou participé à la réalisation de nombreuses éditions, expositions et journées d’études cherchant à décrypter les représentations des mondes coloniaux et les mécanismes de propagande par l’image, qui ont irrigué la société française de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux toutes dernières décolonisations. La propagande et la culture visuelle de l’époque ont, à la fois, persuadé la société française des bienfaits de la colonisation et fixé dans les esprits des représentations des populations colonisées qui ont largement participé à la construction d’un regard spécifique sur l’« Autre ».
Trois ouvrages récents participent de cette ambition.
En 2020, les trois historiens, Nicolas Bancel, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne (UNIL), Pascal Blanchard, chercheur associé au CRHIM à Lausanne et Sandrine Lemaire, professeure agrégée en classes préparatoires au Lycée Jean Jaurès à Reims, rédigent l’ouvrage Décolonisations françaises. La chute d’un empire (La Martinière, 2020). Préfacé par Benjamin Stora et postfacé par Achille Mbembe, ce livre revient sur les multiples facettes et contradictions du processus de décolonisation, depuis les premiers soulèvements en 1944 jusqu’aux dernières indépendances au milieu des années par des épisodes d’une violence inouïe, mais aussi accompagné de réformes et d’accords bilatéraux. Ce qui se traduit, des décennies plus tard, par une forte dépendance des pays décolonisés vis-à-vis de la France. Les auteurs décryptent l’un des plus grands basculements de l’histoire récente et posent un regard renouvelé sur les deux faces du miroir colonial.
Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire et Pascal Blanchard se retrouvent deux années plus tard, accompagnés de Dominic Thomas et Alain Mabanckou, tous deux professeurs à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) pour Colonisation & Propagande. Le pouvoir de l’image(Le Cherche Midi, 2022). Pendant plus d’un siècle, de la IIIe République naissante à la dernière décolonisation en 1980, la propagande coloniale a fait partie du quotidien des Français. Affiches touristiques ou de recrutement militaire, expositions universelles et coloniales, manuels scolaires et protège-cahiers, couvertures de livres et de magazines, presse illustrée et brochures de propagande, photographies et cartes postales, jeux de société et bandes dessinées, publicités et films, monuments et statues, peintures et émissions de radio… tous les supports ont participé à cette apologie de la « Plus grande France ». Au cœur de cette dynamique, l’image a été un vecteur essentiel du message colonial, portant un regard paternaliste et raciste sur ceux que l’on appelait les « indigènes ». Ce livre analyse et replace dans son contexte cette incroyable production, permettant de comprendre les mécanismes de l’adhésion du plus grand nombre à l’Empire et la construction de l’univers symbolique structurant l’imaginaire sur la colonisation. Il permet de comprendre comment le discours sur la « mission civilisatrice » s’est imposé et comment se sont bâties les grandes mythologies de la « République coloniale ».
La même année, en 2022, soixante ans après les accords d’Évian sur l’Algérie (1962), le Groupe de recherche Achac propose l’important ouvrage de référence « Histoire globale de la France coloniale » (Philippe Rey, 2022), dirigé par Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Dominic Thomas, réunissant une centaine de textes rédigés par des chercheurs et spécialistes de la colonisation française pour offrir une vision à 360° sur l’histoire, l’idéologie et la culture coloniales. L’ouvrage permet de reprendre le parcours complet de la colonisation : les débuts de l’utopie dès la fin du siècle des Lumières ; l’expansion à marche forcée au XIXe siècle ; l’apogée de l’Empire au XXe siècle ; l’émergence des premières contestations ; les indépendances ; l’après-Empire et la persistance des effets de la colonisation dans la société contemporaine. Cette édition a été conçue comme un outil indispensable pour comprendre cet épisode majeur qui a profondément marqué la France et le monde. Car c’est en nous confrontant à toutes les facettes de notre passé que nous pourrons enfin, au XXIe siècle, l’intégrer dans notre mémoire collective.
Conjointement à ces projets d’édition ambitieux, le Groupe de recherche Achac développe des expositions permettant la circulation de la recherche mais aussi sa vulgarisation auprès du plus grand nombre, autant d’un public scolaire que d’un public plus averti. Dans cet esprit, on retiendra particulièrement trois expositions : « Images & Colonies en France » en 2016, « Les indépendances. 35 ans de décolonisations françaises » en 2020 et « Colonisation & Propagande » en 2022.Ces expositions, d’une grande richesse visuelle, permettent d’aborder de manière didactique des passages souvent méconnus ou oubliés de notre histoire.
Conçue à partir de l’ouvrage Décolonisations françaises. La chute d’un empire, l’exposition « Les indépendances. 35 ans de décolonisations françaises » retrace ainsi sur 15 panneaux comme autant de chapitres, l’histoire des décolonisations, conflit le plus long de la France au XXe siècle, faisant près d’un demi-million de victimes, des millions de blessés et de civils déplacés, et provoquant des traumatismes dans plus d’une quarantaine de pays et de territoires ultramarins. « Colonisation & Propagande », inspiré du livre éponyme présenté plus avant, s’attache à analyser les images véhiculées lors de la colonisation pour en analyser les effets, en s’intéressant plus spécifiquement à la période allant de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle. Elle a été conçue dans la continuité de l’exposition « Images & Colonies en France », créée en 2016 en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme et dont la vocation était de traduire les mécanismes de fabrication des images depuis les premiers temps de la colonisation, au milieu du XVIe siècle, jusqu’aux guerres de mémoire actuelles. En effet jusqu’en 1970, le discours de glorification et les images ont été les puissants alliés de l’entreprise coloniale française. Un véritable socle sur lequel l’État s’appuie pour légitimer son œuvre outre-mer. Les discours et les images ont mis en scène le « destin civilisateur de la France », et ont diffusé dans la société une réelle culture coloniale. Il s’agissait de comprendre quelles traces ces images ont laissé dans notre inconscient collectif et dans nos sociétés contemporaines.
Dans le documentaire « Décolonisations, du sang et des larmes », réalisé par David Korn-Brzoza et Pascal Blanchard en 2020 avec France Télévisions, le processus de décolonisation est approfondi avec la mise en scène d’images d’archives en grande partie inédites et mises en couleur, ainsi que la parole des témoins, acteurs et victimes de cette page douloureuse de notre histoire ainsi qu’à leurs descendants. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et durant trois décennies, la République s’est acharnée à conserver ses colonies par tous les moyens. Une histoire peu connue faite de sang et de larmes, d’espoirs et de renoncements qui a laissé des traces encore profondes aujourd’hui.
Un autre phénomène encore trop méconnu et inextricable de la colonisation, celui des zoos humains, a bénéficié d’un programme de recherche du Groupe de recherche Achac, dont les nombreux ouvrages dédiés à la question ont permis la maturation d’un certain nombre d’expositions parmi lesquelles « Exhibitions. L’invention du sauvage » au musée du quai Branly – Jacques Chirac en 2011. Conçue en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme par un trio de commissaires regroupant Lilian Thuram, qui préside la Fondation Éducation contre le racisme, Pascal Blanchard et Nanette Jacomijn Snoep, anciennement conservatrice au musée du quai Branly, et actuelle directrice des musées ethnographiques de la Saxe, l’exposition mettait en lumière l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique, exhibés en Occident à l‘occasion de numéros de cirque, de représentations de théâtre, de revues de cabaret, dans des foires, des zoos, des défilés, des villages reconstitués ou dans le cadre des expositions universelles et coloniales. Un processus amorcé à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle dans les cours royales et qui va croître graduellement jusqu’au milieu du XXe siècle en Europe, en Amérique et au Japon. Cette exposition a rencontré un grand succès et a voyagé en outre-mer et en Europe, permettant à chaque itinérance de réactualiser son propos à l’aune des recherches les plus actuelles mais aussi en s’intéressant au contexte local, comme cela a été le cas par exemple à Tervuren à l’AfricaMuseum en Belgique en 2022, ou encore au Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe en 2018, à la Cité Miroir à Liège en 2016... Finalement, pour pouvoir la faire connaître au plus grand nombre, un format itinérant et pédagogique de l’exposition a été conçu, « Zoos humains. L’invention du sauvage ». Disponible en plusieurs langues, cette exposition est visible cette année à Dublin en Irlande, mais aussi au musée Raymond Poincaré à Sampigny dans la Meuse, ou encore à l’université de Poitiers cet automne. Sous une autre forme, le film Sauvages au cœur des zoos humains (Arte/Bonne Pioche, 2018), réalisé par Bruno Victor-Pujebet et Pascal Blanchard, avec les commentaires d’Abd al Malik, complète ces actions de diffusion en racontant par le documentaire l’histoire de ces personnes maltraitées, humiliées, déshumanisées et traumatisées à travers des archives inédites et les témoignages de leurs descendants.
